En juin dernier, aux éditions Passé Composé, a paru la traduction de « Gengis Khan et les dynasties mongoles », ouvrage de référence rédigé dix-huit ans plus tôt par l’anthropologue Jack Weatherford. Ce dernier est un spécialiste des peuples nomades, ayant des relations très approfondies avec la Mongolie grâce à ses nombreux séjours et contacts multiples.
Le livre se concentre sur la vie de Gengis Khan, mystérieuse par bien des aspects. En effet, peu de sources mongoles nous permettent de connaître son règne, à l’exception de « l’Histoire secrète des Mongols », rédigée pour la famille impériale après la mort du grand Khan en 1227, mais qui fut longtemps difficile à traduire, car seuls des résumés en Ouighour étaient accessibles. Les autres sources sont souvent postérieures et viennent des peuples se heurtant aux conquêtes de la grande armée : sur ce point, Weatherford opère une déconstruction judicieuse de l’image de sauvages dont sont affublées les tribus nomades centre asiatiques.
« Gengis Khan et les dynasties nomades » est divisé en trois grandes parties.
La première reconstitue, à la façon d’une mosaïque, la jeunesse de Témoudjin. Weatherford met bien en avant certaines incertitudes planant sur l’enfance de ce dernier mais, par son appréhension des tribus d’Asie centrale, tente de cerner ce qui apparaît comme une adolescence chaotique, marquée par la violence des luttes entre les peuples de la steppe (les Bordjigin, les Merkit, les Tatars etc). Le lecteur y découvre des sociétés marquées par l’enlèvement des femmes ; la mère de Témoudjin, Hoelun, comme sa future femme, Bortë, en seront victimes. L’auteur insiste sur la mise en place de réformes pour constituer ce qui deviendra le peuple mongol, à savoir, l’agrégation de peuples soumis parmi lesquels les meilleurs éléments peuvent connaître une ascension sociale. L’unité mongole est donc constituée par des êtres humains s’identifiant à une forme de patriotisme nomade, dont l’armée est le creuset. Il est amusant de noter que les lois du désormais Grand Khan (« quriltaï » de 1206) se mettent en place au début du XIIIème siècle, comme le fait Philippe Auguste dans le royaume de France.
La deuxième partie s’attache à l’expansion territoriale du pouvoir de Gengis Khan au-delà des limites de la steppe et du rôle de ses fils, ainsi que des femmes de la famille, dans la direction du futur Empire. Après avoir combattu et rassemblé les différentes tribus nomades voisines, Gengis Khan s’affirme auprès de sociétés sédentaires plus lointaines. Ainsi, les Djourtchètes de la dynastie Jin, basés à Zhongdu (ancien nom de Pékin) sont les premiers à se heurter à la déferlante mongole entre 1210 et 1215. C’est dans cette partie que l’auteur développe l’originalité de l’armée mongole : un regroupement unique de cavaliers armés, voyageant sans intendance et se déplaçant de façon assez éparpillée pour assurer suffisamment de pâturages aux bêtes. La communication y était exclusivement orale, les soldats répétant les messages sous forme de chansons afin de les mémoriser de façon précise. Gengis Khan, pour déstabiliser des cités fortifiées dont il est difficile de faire le siège, joue la carte de la diversion, en créant la confusion chez son ennemi puis en l’effrayant pour briser son moral.
Enfin, en troisième partie, Weatherford prolonge son étude en s’attachant à Khoubilaï Khan, petit-fils de Gengis Khan, à l’apogée d’un Empire mongol s’étendant de la péninsule coréenne à la Mer Noire. L’auteur opère des comparaisons entre les deux souverains, en présentant le problème principal auquel chacun est confronté : comment créer une unité de peuples disparates, sur des distances aussi étendues ? L’édification de l’État passe par une appartenance ethnique centrale, mais le centre de gravité change : de mongol sous le Conquérant, celui-ci devient chinois sous Khoubilaï. Ce dernier est le souverain d’un Empire rayonnant, dont la stabilité s’avère influente jusqu’en Occident (« Pax Mongolica »). Celle-ci transparaît à travers les récits et mentions de Marco Polo comme de Geoffrey Chaucer dans ses « Contes de Canterbury ».
L’ouvrage, long de près de 400 pages, se lit pourtant facilement. En effet, s’il est parfois peu aisé de s’y retrouver dans l’entourage de Gengis Khan de par l’exotisme des noms mongols, la traduction est fluide et est lisible comme un roman. En ce sens, la critique du Washington Post, proposée en couverture de l’ouvrage et qui le compare à l’Iliade, est plutôt juste, car un brin d’épopée parcourt sa composition. Le lecteur suit avec plaisir l’ascension du jeune Témoudjin et s’y attache comme un héros. Weatherford opère des rappels judicieux tout au long du livre concernant certains titres et l’organisation de cette société mongole en mutation.
De plus, l’ouvrage est riche de multiples précisions sur Gengis Khan, sur le contexte de la fondation de son empire nomade, mais aussi, sur la culture centre asiatique dans son ensemble. En effet, le lecteur a vraiment l’impression d’un monde peu connu qui s’ouvre à lui, avec non seulement des thématiques développées (la composition, le renouvellement et les spécificités de l’armée du Khan par exemple), ainsi qu’une foule de détails sur la pensée mongole. Ainsi, l’on apprend que le « süld », la bannière militaire symbole des esprits gardiens, est le dépositaire de l’âme de son propriétaire. Plus que le corps mort, c’est l’esprit qui demeure à travers cet objet. Au décès de Gengis Khan, son « süld » est précieusement gardé et protégé à l’abri dans un monastère. Malheureusement, cette bannière qui aurait traversé le temps sera victime des vagues de violence stalinienne que connut la Mongolie, et c’est à partir de 1937 qu’on en perd sa trace.
Néanmoins, le contenu du livre pêche parfois par là où il brille. En effet, il est parfois difficile pour un historien de se suffire de la narration, Weatherford, qui s’appuie sur « l’Histoire secrète des Mongols » pour conter le parcours de Gengis Khan. De par son statut d’anthropologue et sans doute aussi de par une méthodologie américaine différente, Weatherford opère peu de références bibliographiques, du moins, dans les premiers chapitres. Ceci peut paraître parfois déconcertant pour un lecteur français spécialisé en Histoire, car dès lors, il est difficile de démêler ce qui se réfère aux connaissances tirées des manuscrits du XIIIe siècle des interprétations de ses spécialistes ou des déductions personnelles propres à Weatherford, fin connaisseur de cette culture. Une bibliographie est cependant proposée, afin d’approfondir certains aspects pour les plus curieux des lecteurs.
Par ailleurs, Weatherford nourri une bienveillance et une admiration pour le jeune Témoudjin qui peut sembler peu objective. L’auteur, s’il cherche à comprendre la particularité de cette ascension hors-du-commun, tombe parfois dans une complaisance pour son sujet d’étude qui gommerait presque les caractéristiques moins reluisantes du personnage. Car si la légende noire du Conquérant est intéressante à décortiquer, celle-ci prend aussi naissance auprès de peuples qui ont été en contact direct d’une violence, certes calculée, mais qui n’en demeure pas mois marquante pour des sociétés démantelées.
Cette publication est en soi une vraie réussite et l’on espère que les Éditions « Passés composés » continueront à transcrire des ouvrages tout aussi envoutants que ce « Gengis Khan et les dynasties mongoles ».

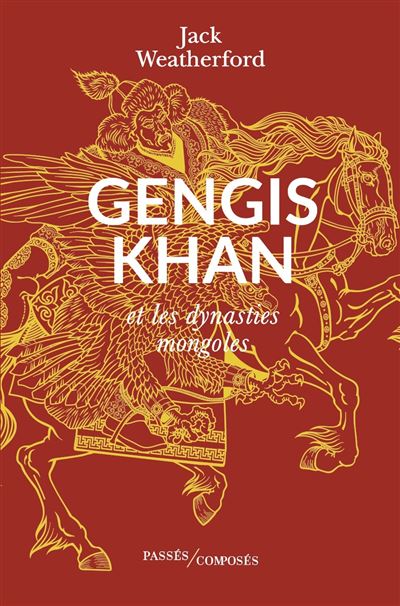


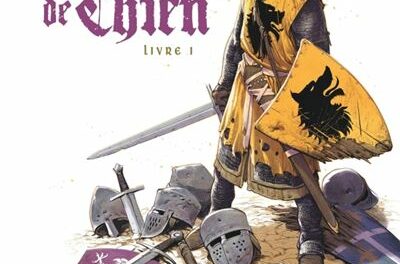










Un excellent compte-rendu que je découvre un peu tardivement et qui donne vraiment envie de revoir ses présupposés sur Gengis Khan. Merci Typhaine !