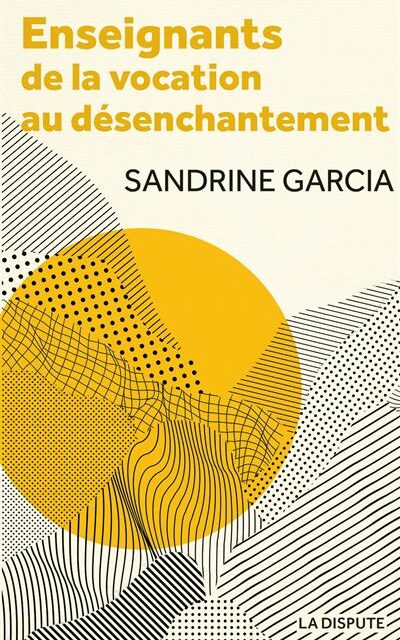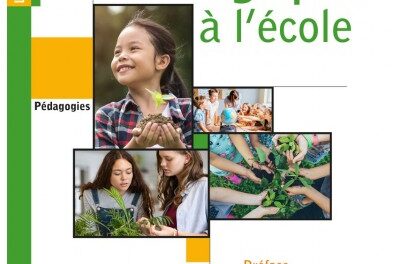Comment expliquer la crise actuelle de la vocation pour l’enseignement ? Sandrine Garcia met en relation les expériences vécues par des enseignants du premier degré et les transformations des conditions d’exercice liées aux réformes de la profession. Elle montre que les processus en cours au sein de l’Éducation nationale témoignent d’un contexte plus large de redéfinition des relations entre l’État et les professions chargées d’assurer le service public.
Le fossé entre l’investissement professionnel exigé par l’institution et les satisfactions que les enseignants peuvent eux-mêmes escompter de leur métier se creuse, comme en témoignent les entretiens réalisés auprès d’une soixantaine de professeurs et professeures des écoles ayant démissionné. Loin de concerner uniquement les nouveaux entrants de la profession, le désenchantement frappe les enseignants à toutes les étapes de la carrière.
Qui est Sandrine Garcia ?
Sandrine Garcia est professeure de sociologie à l’université de Bourgogne. Ses travaux actuels, selon sa page universitaire, portent « sur la médicalisation et la psychologisation de l’échec scolaire, l’analyse des démarches pédagogiques et des inégalités d’apprentissage (en particulier dans le domaine des « savoirs premiers »), la naturalisation des inégalités sociales d’apprentissage, en particulier par l’expertise neuropsychologique et psychologique, les pratiques familiales d’accompagnement à la scolarité, la sociologie du travail enseignant et le marché de l’édition scolaire et parascolaire, les formes de domination scolaire à l’encontre des classes populaires ».
Publié à la fin du mois de janvier 2023, cet ouvrage s’est retrouvé rapidement au centre des débats. Par un étrange hasard, le premier trimestre 2023 a coïncidé avec plusieurs faits d’actualité qui, coup sur coup, ont rendu cette lecture non seulement nécessaire mais urgente. D’abord, il y a eu la baisse structurelle des candidatures aux concours de recrutement, que ce soit dans le premier ou le second degré, dont même la Cour des Comptes s’émeut. Puis, la très large déception à l’écoute des annonces de revalorisation du ministre de l’Éducation, dont ni le « Socle », ni le « Pacte » n’ont été jugés suffisants pour enrayer la précarisation du métier. Enfin, est venu, à la fin du mois de février, le dernier coup de tonnerre : le meurtre d’Agnès Lassalle, professeur d’espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Oui, ce métier expose à la violence, même dans des établissements a priori favorisés. Nul doute que le mois de mars, avec les grèves contre la réforme des retraites, montrera un fort niveau de mobilisation des enseignants.
La rationalisation gestionnaire clouée au pilori
Signalé dès les premières pages de l’introduction, le processus de « rationalisation gestionnaire », défini comme l’adaptation à des logiques marchandes, serait le principal responsable. Si la lutte contre les inégalités sociales est toujours là, ses nécessités et contraintes sont toutefois soigneusement ajustées désormais, de telle sorte qu’en dehors de ce périmètre, le désengagement de l’État s’exprime à plein, même au sommet du pilotage éducatif. En témoignent la montée en puissance des cabinets privés de conseil dans l’aide à la décision politique et gestionnaire, quasiment parallèle au reflux organisé des moyens d’intervention des syndicats.
Sur un autre plan, l’inflation des missions exigées des enseignants vise non seulement à accroître leur productivité mais aussi à maintenir, voire à amplifier formellement, un certain nombre d’engagements vis-à-vis des familles, sans que cela pèse sur les moyens de fonctionnement de l’école. En bout de chaîne, c’est donc à l’enseignant de déployer des solutions pédagogiques pour que l’édifice tienne encore.
Et pour s’assurer du fonctionnement du système, une panoplie d’indicateurs dans tous les domaines étalonnent les performances des unités d’enseignement et des enseignants. À la clé, les premiers peuvent espérer allocations de moyens, les seconds l’avancement de carrière. Coincé entre des exigences institutionnelles et des difficultés d’exercice en hausse, des moyens et une reconnaissance en baisse, l’enseignant n’a guère de quoi entretenir sa vocation.
Cette dénonciation de ce que certains connaissent sous le nom du « New Public Management » est la principale thèse de l’ouvrage et pour tout dire, c’est là un de ses principaux intérêts. En effet, il est souvent convenu, dans le tableau du malheur enseignant, d’épingler la violence dans les classes, l’image dégradée du métier dans le grand public, voire la crise civilisationnelle de l’autorité. Or, si chacun de ces éléments mérite qu’on s’y arrête, trop souvent ils ont tendance à minorer les obligations de l’employeur, à le rendre tout aussi victime des travers qu’il accueille en son sein. Ici, Sabine Garcia n’évoque pas cet arrière-plan social car il n’est pas le réel motif de la démission.
Elle note que les entretiens menés avec les enseignants sont saturés de ce sentiment insupportable : devoir se satisfaire dans la pratique de « tenir sa classe », qu’elle ait deux ou trois niveaux, avec des profils d’élèves très hétérogènes et dont certains souffrent d’un handicap, tout en participant à un exercice de communication collectif autour d’un « travail pour la réussite des élèves » dénué de toute réalité. Ce dernier exercice occupe d’ailleurs un temps de plus en plus considérable en tâches bureaucratiques et réunions en tout genre.
Les facteurs secondaires de crise
Sandrine Garcia identifie plusieurs facteurs secondaires. J’en retiens deux pour les besoins de ce compte-rendu. Le premier tient à la dévalorisation particulière et déjà ancienne des instituteurs dans le monde enseignant, que la réforme vers le titre de « professeurs des écoles » n’a pas complètement réglé. Le second tient aussi aux effets pervers de la fin des redoublements.
L’auteur, précisons-le, ne regrette nullement le redoublement mais s’étonne que les effets du passage automatique dans la classe supérieure ne soient jamais interrogés. La parade institutionnelle consiste à parler « différenciation pédagogique » et à soumettre de fait les enseignants à des contraintes d’organisation insoutenables. Immanquablement, l’enseignant doit abaisser ses exigences, ce qui ne peut que nuire aux enfants des milieux populaires qui n’ont aucun autre lieu que l’école pour « s’élever ». Sur ces points, là encore l’analyse de l’auteur est confirmée par ce qui s’observe dans le second degré. On peut d’ailleurs ajouter que plus les retards s’accumulent d’un niveau à l’autre, plus ils sont impossibles à récupérer. On en voit les résultats tous les jours dans nos établissements : démobilisation, problèmes de comportements et décrochage.
Plan de l’ouvrage
I. Présentation du corpus d’entretien et du profil des enseignants enquêtés.
II. La rationalisation des moyens de travail (services, contrôles, contraction des dépenses, responsabilisation, situation des stagiaires, etc.).
III. Les effets du pervers du « il n’y a pas de recettes » et des injonctions à l’innovation pédagogique (solitude, auto-dépréciation, surcharge de travail, ambiguïtés et limites des formations des enseignants, etc.)
IV. Le rapport à la hiérarchie
V. Le rôle de la dynamique des aspirations parentales et individuelles dans les démissions.
Parmi ses nombreuses qualités, le livre a le grand mérite de présenter de nombreux témoignages bruts, sans tomber dans le piège du recueil pur qui éparpillerait les conclusions entre les différentes voix des intervenants.
Que se passe-t-il quand un enseignant envoie sa démission ?
Un des passages les plus violents du livre à mon sens se situe entre les pages 55 et 64 quand il s’agit d’aborder la réaction institutionnelle quand l’enseignant envoie sa démission. Je m’attendais, comme l’auteur et les enseignants concernés du reste, à ce qu’il y ait plusieurs entretiens « avant départ », à cette espèce de moment de vérité où la première ligne parlerait à l’arrière, où peut-être d’ailleurs il y aurait un effort pour dissuader l’enseignant de partir. De fait, après tant d’années d’études, de sacrifices pour arriver devant une classe, pour tenir, n’est-ce pas un véritable enjeu de ressources humaines que d’éviter ce qui est, je reprends le terme de l’auteur, une « forme de suicide professionnel » ?
La réponse est sidérante mais il n’y a pas forcément d’entretien et quand entretien il y a, l’enseignant se sent traité « comme un numéro ». Pour Sara (p. 56), première de sa promotion, c’est la douche froide de voir que tout s’est réglé très vite, avec une inspectrice rencontrée une fois et qui n’a d’ailleurs pas précisé si sa démission était acceptée. Pour Clémence (p. 57), sa conseillère pédagogique, présente au rendez-vous avec l’IEN, lâche cette formule terrible: « je vous en ai mis plein la gueule [lors de ma visite] parce que je pensais qu’à 40 ans, vous ne pouviez pas démissionner ». On imagine la réaction de Clémence.
La conclusion de l’auteur est que ce moment de la démission vient comme une confirmation du diagnostic de l’enseignant : « il n’était vraiment rien ». Terrible.
Mon avis :
L’ouvrage comporte plusieurs biais méthodologiques et pourra certainement être attaqué sur cette base par quelques esprits chagrins, soucieux de jeter un voile pudique sur les immenses difficultés traversées par l’Éducation nationale. De fait, l’échantillon choisi comme base d’étude au « désenchantement enseignant » est assez limité, tant dans le nombre d’enseignants enquêtés que dans leur représentativité géographique. De même, il ressort qu’un certain nombre de situations intermédiaires (travail à temps partiel, mise en disponibilité, rupture conventionnelle…) peuvent s’apparenter à des manifestations de ce désenchantement. Or si elles sont évoquées, elles n’ont pas justifié une enquête vers ces collègues particuliers. Cela manque. Les analyses en auraient été renforcées. En effet, la démission est la forme la plus grave de rupture mais aussi, vraisemblablement, la plus minoritaire, dans une profession qui offre assez peu de possibilités de reconversion. L’auteur d’ailleurs évoque longuement toutes les « fuites » qui permettent à l’enseignant en activité, sinon de se ménager, de « tenir ».
Toutefois, ces remarques ne visent nullement à déprécier le travail de Madame Garcia, remarquable pour toutes les raisons déjà évoquées et qui s’inscrit d’ailleurs dans une chaîne déjà longue de publications. En effet, ce que dit ce texte confirme dans une très large mesure les dizaines de témoignages qu’un enseignant a pu croiser, soit à son travail, soit parmi ses anciens collègues de l’IUFM, soit en lisant tout simplement la presse sérieuse ou des ouvrages dédiés. Moi-même en parcourant certains passages sur la formation des enseignants, sur la difficulté à mettre en œuvre la différenciation pédagogique ou l’accueil des enfants atteints d’un handicap, j’ai eu plus qu’un sentiment de déjà-vu. En fait, il s’agit surtout de demander à l’ auteur d’envisager ces points dans son prochain travail et, pourquoi pas, d’aller voir aussi du côté du second degré !
En guise de conclusion, je me permets de joindre un rapport réalisé cette fois-ci sur le moral (en berne) des cadres de l’Education nationale. Cette étude a été menée par Georges Fotinos et José Mario Horenstein (CASDEN/MEN), en 2015-2016, c’est-à-dire avant le Covid. Elle démontre que le désenchantement exprimé par le versant enseignant dans l’ouvrage de Madame Garcia est partagé par le versant des IEN, dans des termes suffisamment semblables pour justifier une sévère remise à plat du fonctionnement de l’école.
Quand ni les enfants, ni les enseignants, ni les cadres ne vivent bien à l’école, c’est qu’il est urgent d’agir.