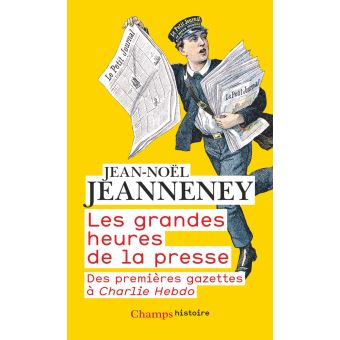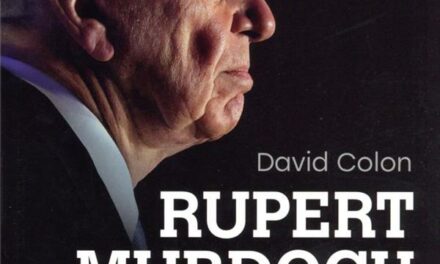Jeanneney est professeur des universités, ancien ministre, auteur de nombreux ouvrages documentaires sur l’histoire politique, culturelle et des médias. Il écrit pour le théâtre. Ancien président de Radio France, RFI et de la BNF, l’émission « Concordance des temps » sur France Culture.
Dans cet ouvrage paru dans une collection de poche, il s’agit ni plus ni moins de résumer l’évolution de la presse française. On y évoque les prémices, les personnalités hautes en couleur, comme Théophraste Renaudot, mais également les mutations de la société ainsi que les inventions techniques qui l’accompagnent, les défis que la presse a dû affronter, de l’oppression politique ou policière, de l’argent.
Mais, l’auteur précise bien qu’il s’agit aussi pour le lecteur d’une occasion d’une « une réflexion sur l’une ou l’autre des questions majeures que soulève tout système politique du côté de la circulation de l’information : sa véracité, sa promptitude, les dissimulations et les débusquages, sa capacité à renforcer un régime ou au contraire à l’ébranler ». Le fil conducteur de cet ouvrage est lié à la question de la relation qui s’organise toujours entre la tentation du mensonge chez les dirigeants et l’inspiration chez les citoyens à une transparence, immédiate et absolue de la vie publique.
Dans une première partie, Jeanneney évoque les fondateurs avec le personnage haut en couleur de Renaudot, qui lance la gazette le 30 mai 1631. Il s’agit bien d’une presse à parution régulière. À titre anecdotique, l’auteur évoque le fait que le gouvernement de Vichy avait déboulonné, en décembre 1941 et en août 1941, les deux statues de Renaudot que la IIIe République avait érigées en 1893 et 1894, l’une à Paris, l’autre à Loudun, sa ville natale, dans la Vienne. Jeanneney représente le fait comme étant évocateur d’un geste métaphorique un toutes les libertés, et surtout celle de l’information, par haine également des auteurs de la loi libérale du 29 juillet 1881, la presse étant alors considérée « comme un pilier essentiel d’une démocratie vivante dans les citoyens serait ainsi éclairé pour opiner à bon escient, et pas seulement dans les urnes : au quotidien de leur vie civique ».
C’est un 30 mai 1631 que Renaudot obtient pour ses enfants et lui, le privilège de « faire imprimer et vendre, par qui et où bon leur semblera [it], les nouvelles et récits de tout ce qui s’est passé et se passe tant dedans que dehors le royaume », avec un brevet qui lui donnait le droit d’imprimer et de diffuser son journal « à perpétuité exclusivement de tous les autres ». C’est un homme de 45 ans, d’âge mûr à l’époque, un médecin formé à Montpellier ; il est d’origine protestante, mais s’est converti prudemment au catholicisme. On le présente comme généreux et âpre au gain, il est aussi entreprenant, inventif, énergique, on le dit ayant le goût et le sens des relations humaines, se souciant tout à la fois du malheur des pauvres, de la puissance des grands, un homme, somme toute éclairé sur la complexité du monde où il évoluait.
S’ensuit une description de sa Gazette et des problèmes que la presse va connaître au long des âges : les relations avec les pouvoirs publics (on apprend ainsi se mit au service du gouvernement de toucher une pension de 800 livres ; en échange, il faisait preuve de « souplesse »), la question des rumeurs et de la liberté du journaliste envers elle, et donc de son rapport à la vérité, le poids des intérêts privés très lourds dès le départ.
Dans une seconde partie, Jeanneney présente Voltaire contre les journaux en 1756.
On y apprend que Voltaire, dans l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, se chargea, en 1756 des entrées « gazette » et « gazetier ». Pour Rousseau, un journal se définit comme « un ouvrage éphémère, sans mairie et sans utilité, dans la lecture, négliger et mépriser par les gens les crient, ne sert qu’à donner aux femmes au sens de la réalité sans instruction, et dans le sort, après avoir brillé sur la toilette, et de mourir le soir dans la garde-robe [sous-entendu le cabinet de toilette] ». Voltaire se gausse de Fréron et le dote du sobriquet de frelon dans un quatrain célèbre. Et c’est pourtant l’auteur d’une Année littéraire de 1754 jusqu’à sa mort en 1776. On ne peut qu’observer la des philosophes des Lumières envers ses presses qui s’affirme, surprenant pour des hommes qui se battent pour la liberté de conscience et d’expression, Jeanneney citant l’exemple de Voltaire qui n’hésita pas à demander au lieutenant de police, en 1749, d’enjoindre plus de modération à Fréron et au besoin de l’enfermer à Bicêtre. S’agit-il de jalousie face à des prospérités matérielles auquel les écrivains ne sont pas supposés accéder ? Ou bien d’une hostilité aux idées nouvelles affichées par la presse ? Il s’agit probablement du pouvoir de la critique. Diderot se charge lui, des articles « journal » et « journalistes » dans l’Encyclopédie, y écrivant ; « on a trouvé qu’il était plus facile de rendre compte d’un bon livre que d’écrire une bonne ligne, et beaucoup d’esprits stériles se sont tournés de ce côté […]. On achète ou on laisse un livre après le bien ou le mal qu’ils en disent ; moyen sûr d’avoir dans sa bibliothèque presque tous les mauvais livres qui en parlent, et qu’ils ont loué, de n’en avoir aucun des bons qu’ils ont déchirés […]. La Harpe, ami de Voltaire, se plaignait du nombre excessif de périodiques rendant compte des écrits savants.
Mais, Jeanneney saisit l’ambivalence des esprits les plus modernes de ce temps envers la montée de l’«esprit public ». Condorcet se méfie ainsi les débordements incontrôlés des mouvements de l’opinion.
Dans une troisième partie, c’est le surgissement formidable de la presse libre au temps de la révolution qui nous est présentée. L’auteur évoque alors la mort de Marat : il lui attribue une valeur symbolique dans l’histoire de la presse révolutionnaire. Il contextualise en reprenant les événements de la Terreur dont le Comité de salut public qui finit par interdire les dernières pages libres. L’ami du peuple, fondée le 12 septembre 1789, s’est distingué dès l’origine par sa violence verbale, ces dénonciations de tous les pouvoirs en place, cet appel aux «secousses violentes» et aux mesures extrêmes – tribunal révolutionnaire, exécutions populaires redistribution des terres – et qui représente la grande question des limites admissibles ou nécessaires à la liberté d’expression. Au début, les hommes de 1789, défendent le principe d’une presse libre, car à leurs yeux, le secret défend le maintien des privilèges et des méfaits de l’absolutisme, tout ceci dans un contexte où les révolutionnaires rêvent de faire naître un forum, s’inspirant de la Rome antique, où se rassembleraient les citoyens. Ils y verraient également la presse comme un ressort primordial des événements. Bonaparte rejettera tout cela, mais cette période révolutionnaire présente les périls qui menacent la presse.
Nous voici alors dans la partie suivante à encore évoquer la révolution des journalistes, à travers la scène du 27 juillet 1830, au fond d’une cour de la rue de Richelieu, où se situent les bureaux des ateliers du Temps. Un commissaire de police, se présente pour exécuter un arrêté du préfet de police qui enjoint de « mettre hors service » les presses des quotidiens parus à l’aube sans autorisation. Il trouve porte close, cet appel à un serrurier, puis un autre, tout ceci en présence d’une population indignée. L’émeute est en marche à Paris, et bientôt la révolution qui, au terme des trois glorieuses, les 27,28 et 29 juillet, va conduire au renversement du trône et à l’avènement de Louis Philippe.
Charlie X, roi de France et de Navarre, avait privé la presse périodique de toute liberté par ordonnance. Les journalistes réagissent alors, rédigent une protestation collective « la situation nous somme placés, l’obéissance cesse d’être un devoir […]. Par solidarité, les autres titres paraissent le lendemain sans autorisation et, attire la curiosité du public : la liberté de la presse est devenue, depuis la chute de l’Empire, le premier objet des luttes politiques.
Jeanneney s’attache alors à nous évoquer des épisodes qui nous présentent des épisodes célèbres et passionnants : l’adoption de la loi du 29 juillet 1881, tout en se faisant l’écho des querelles des hommes politiques, des faits de société, avec le célèbre article « j’accuse ! » du 13 janvier 1898, il s’agit bien entendu de la célèbre interpellation, longue et vibrante, adressée par Émile Zola au président de la république Félix Faure, et publiée en première page du quotidien l’Aurore du 13 janvier 1898. Jeanneney le présente comme un tournant décisif dans l’histoire de la République, à une époque formidable de puissance des quotidiens, qu’il n’hésite pas à présenter comme un âge d’or marqué par la domination de quatre grands journaux populaires, le Journal, le Petit Journal, le Matin, le Petit Parisien, qui représentent 40 % du marché français à eux seuls.
Il est fait mention des journaux politiques qui, ne présentent pas une position médiane comme ces derniers ; il s’engage, comme l’Humanité fondé en 1904, par Jaurès. L’auteur reprend ainsi également le poids d’une célèbre caricature « le dîner en famille » du 14 février 1898. La partie qui évoque le personnage célèbre d’Albert Londres est remarquable : on n’y présente certes son talent de, son mépris du danger, l’acuité de son regard, son sens des relations publiques ; le prix qui porte son nom et qui est né en 1933 récompense chaque année les reporters les plus valeureux.
À juste titre, Jeanneney présente les époques de guerre comme les plus favorables à l’expression d’une liberté en marche qui s’oppose à un patriotisme exacerbé. « Notre rôle n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ». Mais, les mensonges patriotiques ont des conséquences dramatiques sur l’autorité des journaux ensemble : ils peuvent être vénaux.
Au cours de l’histoire du XXe siècle, l’ancien ministre s’attache à présenter la vénalité de cette presse soumise à caution, les fausses nouvelles qu’elle peut porter, les appels au meurtre avec l’exemple de Maurras le 9 avril 1935, la violente diatribe contre Léon Blum, ou le haro sur les « 200 familles » du Crapouillot, le 1er mars 1936.
Mais, la presse se fait aussi l’écho de la révolution des femmes avec la naissance de Marie-Claire en 1937 ; elle appelle à la résistance en octobre 1940, s’engage dans la clandestinité, avec plus de 1000 titres, s’enfonce dans l’ignominie avec le « je suis partout », la caricature de Ralph Soupault, en date du 16 août 1944. On n’y voit Roosevelt enlaçant un gros juif au nez crochu, fumant cigarette et portant gibus, et lui murmurant, à propos de Camille Chautemps – leader important de la IIIe République auquel on prête le projet de jouer sa carte après la Libération. Mais la presse, c’est aussi Combat, qui le 21 août 1944, porte fièrement le numéro 59, quatrième année. « Il a fallu cinq années de lutte obstinée et silencieuse aucun journal ni de l’esprit de résistance, publié sans option à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte… ».
C’est alors la naissance du Monde 18 décembre 1944, expression officieuse de la diplomatie française, de la coopérative Magnum, où l’aristocratie du reportage, Jeanneney nous les présentant comme des hommes qui parcourent la planète, souvent à grand risque, pour en donner à voir les soubresauts et les bouleversements ; mais, c’est aussi la naissance de France-Soir, les liens avec le pouvoir, les querelles intestines de la presse française, les grandes pages, somme toute, de notre histoire jusqu’à Wikileaks, en 2010. Rappelons les faits : plusieurs grands journaux du monde occidental, tous fort bien considérés, décidèrent de concert de donner accès à des documents américains qui, confidentiels, venaient d’être soustraits à la vigilance des autorités. L’ouvrage s’achève par le drame de Charlie hebdo en date du 7 janvier 2015, révélateur d’une foudroyante barbarie, une attaque contre la liberté d’expression, qui montre qu’à l’homme rien n’est jamais acquis, en reprenant les vers de Louis Aragon. À la presse pas davantage.
Un ouvrage à mettre entre toutes les mains qui rappelle à quel point la presse est glorieuse, quand elle ne rend pas un culte au veau d’or.