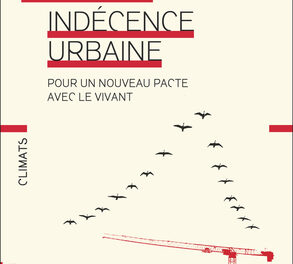A l’heure où l’éducation au développement durable prend toute sa place dans les nouveaux programmes de cinquième et de seconde, il est apparu nécessaire de sortir une nouvelle édition de ce numéro d’Etudes, publié il y a quatre ans. Trois chapitres nouveaux ont été intégrés à cette édition 2010. Sept auteurs, essentiellement des économistes, ont écrit les textes. Un seul géographe, Denis Chartier, maître de conférences à l’université d’Orléans, appartient à l’ensemble.
A l’heure où l’éducation au développement durable prend toute sa place dans les nouveaux programmes de cinquième et de seconde, il est apparu nécessaire de sortir une nouvelle édition de ce numéro d’Etudes, publié il y a quatre ans. Trois chapitres nouveaux ont été intégrés à cette édition 2010. Sept auteurs, essentiellement des économistes, ont écrit les textes. Un seul géographe, Denis Chartier, maître de conférences à l’université d’Orléans, appartient à l’ensemble.
Si l’enseignant d’histoire – géographie ne veut pas enseigner le développement durable à la manière de Yann Arthus – Bertrand ou de Nicolas Hulot en jouant sur l’émotionnel, il se doit de lire des analyses d’un bon niveau, comme cet ouvrage, qui replace le concept dans une histoire des idées. Si le ton alarmiste de l’introduction de ce numéro d’Etudes peut effrayer, cette impression s’atténue rapidement grâce à une analyse rigoureuse des trois piliers du développement durable (économie, social et environnement), bien mise en perspective dans le contexte de la crise économique de 2008, de ses conséquences sociales et environnementales.
Il ressort de l’étude menée par les auteurs que le développement durable, qui est officiellement défini en 1987 avec le rapport Brundtland, est à replacer dans une optique historique bien plus large : John Stuart Mill, Malthus, Marx mais aussi Keynes, par leurs approches économiques de la croissance et du capitalisme, s’interrogent déjà sur la durabilité d’un tel phénomène, bien avant les rapports Halte à la croissance et Meadows de 1972. La théorie du développement, (et son parallèle inverse : le sous-développement) mise en avant dans les années 1940 – 1950 par les économistes et les politiques, est clairement distinguée de la croissance. Le développement doit être possible sans la croissance. Lors de la conférence de Stockholm en 1972, le concept d’éco développement est lancé. I. Sachs, avec cette idée, estime que la croissance est nécessaire mais non suffisante au développement. L’Etat doit redistribuer les fruits de la croissance aux moins aisés. De plus, il s’agit pour les pays du Sud, en particulier, de concilier développement et questions environnementales. Ces idées sont reprises vingt ans plus tard à la conférence de Rio de 1992 qui suit la publication du rapport Brundtland. Les économistes travaillent sur l’idée de croissance durable c’est-à-dire « la transmission aux générations futures d’une capacité à produire du bien être économique au moins égal à celle des générations précédentes. » Amartya K. Sen propose un nouvel outil pour appréhender le développement, basé sur l’évaluation du bien être des individus mesuré non seulement par la possession de biens mais aussi sur leurs capacités de faire et d’atteindre des « états d’ être » donnés (se déplacer, se loger, être en bonne santé, être socialement reconnu et respecté). Ses détracteurs estiment que les dimensions écologiques ne sont pas assez présentes.
Au-delà du récit analytique de la mise en place du concept de développement durable, l’ouvrage fait le point, sans indulgence, sur les grandes conventions sur le climat et la biodiversité. Ce bilan est d’autant plus nécessaire que le protocole de Kyoto arrive à échéance en 2012 – 2013. L’échec du sommet de Copenhague (décembre 2009) a montré à quel point il était difficile de rallier les grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud ou Russie) à l’idée de réduire quantitativement leurs émissions de GES. La proposition de fusion des groupes de réflexion (pays du Nord avec pays du Sud) est à l’origine du blocage de Copenhague. Les mécanismes de mises en œuvre institutionnelle du développement durable sont, eux aussi, décortiqués. Il apparaît qu’il existe un décalage entre les discours politiques volontaristes des institutions et la réalité des changements sur le terrain. Les disparités spatiales entre collectivités territoriales l’emportent : certains font, à l’heure actuelle, le bilan de dix ans d’action alors que d’autres en sont à initier leur développement. Les différentes appellations du ministère de l’environnement et les limites de ses compétences montrent le flou dans ce domaine. Les ONG internationales, souvent initiatrices de changement, semblent aujourd’hui s’installer dans un rôle institutionnel qui rend leur discours et leurs actions moins efficaces. Elles semblent être devenues des acteurs comme les autres. Les entreprises, quant à elles, « surfent de plus en plus sur la vague verte », sans perdre de vue que leur finalité est de gagner de l’argent.
L’ensemble du texte est parsemé d’encadrés qui font le point sur des éléments ciblés fort utiles à la compréhension du sujet (exemple : le rapport Sterns). La complexité des enjeux liés au développement durable n’est pas occultée. Les auteurs ont le souci, dans un langage clair, de montrer ce que telle position implique. Ainsi, ils analysent le premier sommet mondial des peuples autochtones sur les changements climatiques (Anchorage, avril 2009) comme la tribune des revendications identitaires à partir d’un objet d’inquiétude environnementale. La parcellisation et l’empilement des textes ne facilitent pas leurs mises en œuvre. Il apparaît que seule la mise en place d’un green New Deal semble recueillir les soutiens des acteurs économiques, mais aussi sociaux des pays riches. Les pays du Sud, quant à eux, ne veulent pas hypothéquer leur croissance au nom de la durabilité. La conciliation des intérêts des uns et des autres est loin d’être possible. Pourtant, pour les auteurs, il semble que le changement climatique marque une rupture significative dans la manière dont les hommes pensent leur société à long terme. Ils espèrent que l’urgence de la situation obligera à une prise de mesures applicables et appliquées.
Copyright Les Clionautes