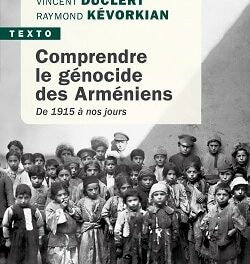Georg Simmel (1858-1918) fut un des sociologues et philosophes allemands des plus influents entre 1890 et 1914, fortement inspiré de Kant et de Nietzsche. La guerre de 1914-1918 arrive à la fin de sa vie, et dans cet opuscule d’une centaine de pages, le germaniste Jean-Luc Evard rassemble tous les textes de Simmel écrits entre 1914 et 1916 au sujet de la guerre, ou du moins fortement marqués par la guerre et ses conséquences sur l’esprit allemand et l’idée d’Europe. Fatigué et sans doute catastrophé par la tournure future des événements, Simmel, qui croyait en la victoire allemande, n’écrira plus de 1916 à 1918, et il meurt le 26 septembre, peu de temps avant la fin des combats.
Les huit textes présentés ici ne le sont pas dans l’ordre chronologique et, comme je ne suis pas sociologue ni philosophe de formation, je me suis permis de les lire dans l’ordre chronologique :
« Éclairer l’étranger » (octobre 1914), « Bergson et le cynisme allemand » et « Transmutation de l’âme allemande » (novembre 1914), « L’idée d’Europe » ((février 1915), « Deviens ce que tu es » (juin 1915), « L’Europe et l’Amérique » (juillet 1915), « La crise de la culture » (février 1916) et enfin « La dialectique de l’esprit allemand » (septembre 1916). Ces textes sont complétés par une contribution de Jean-Luc Evard en fin d’ouvrage qui permet d’éclairer les propos de Simmel, notamment sur ses relations face au philosophe français Henri Bergson, sa peur des États-Unis et son patriotisme angoissé.
Lire Simmel reste difficile pour le profane, à la fois parce que la langue allemande est particulière dans ses tournures mais aussi parce que Simmel expose une pensée très complexe, dans la droite ligne de la pensée kantienne, et il faut parfois revenir à deux fois sur certains passages du texte pour en comprendre le sens final.
Ce qui est intéressant pour l’historien, c’est de lire ici le point de vue d’un intellectuel face à la guerre, mais aussi de le comparer avec le trajet parallèle de Bergson, de un an son cadet, en France. Pour Simmel, la guerre est une épreuve dont l’Allemagne sortira transformée, rajeunie, revigorée et débarrassée d’une culture matérialiste que Simmel rejette. Il en convient, l’Allemagne est isolée, incomprise, objet de propagande éhontée de la part des alliés. Toute une partie de son travail consiste donc à expliquer pourquoi l’Allemagne fait la guerre et qu’elle n’est en rien « cynique » comme l’affirme Bergson au lendemain de la violation de la neutralité belge. Le cynisme, au contraire, aurait été de refuser la guerre. C’est donc en belliciste assumé que Simmel se présente, mais toujours avec une pointe d’inquiétude et d’angoisse. Simmel n’est pas vraiment dans l’action, mais dans la contemplation de ce qui arrive. Il souhaite la victoire allemande, la transmutation de son esprit, le renouvellement de sa culture mais, contrairement à son homologue français Bergson, ne s’investit pas dans le combat avec ses moyens d’intellectuel. Bergson, lui, est allé jusqu’aux États-Unis afin de rencontrer Woodrow Wilson et le convaincre d’entrer en guerre. Simmel reste à Strasbourg, à la marge, clairement ostracisé par ses collègues berlinois pour des raisons qui touchent à sa judaïté.
Au fur et à mesure de l’évolution du conflit, il mesure les difficultés persistantes de l’Allemagne, et se désole de voir que les Français font la guerre sans motivation philosophique apparente en dehors d’une resucée du débat ancien Fichte/Renan, de constater le progrès de la culture matérialiste américaine, du panslavisme et de la place de plus en plus importante donnée à une arme qui pour lui est déloyale, la propagande. Ses derniers textes s’inquiètent sur l’idée d’Europe, une Europe trop influencée par le mode de vie américain, une Europe qui perd son identité dans ce conflit mondial.
En ce sens, Simmel reste un bon exemple de l’Allemagne wilhelmienne, à la fois brillante, cultivée et fourmillante d’idée, mais aussi peu apte à s’adapter au monde nouveau qui arrive, celui de la mondialisation des idées et de la marginalisation des postures d’honneur et de bravoure.