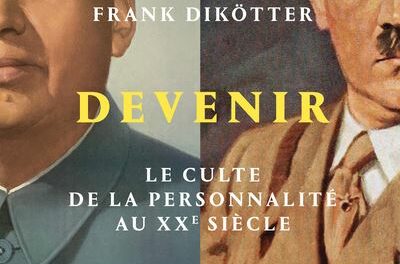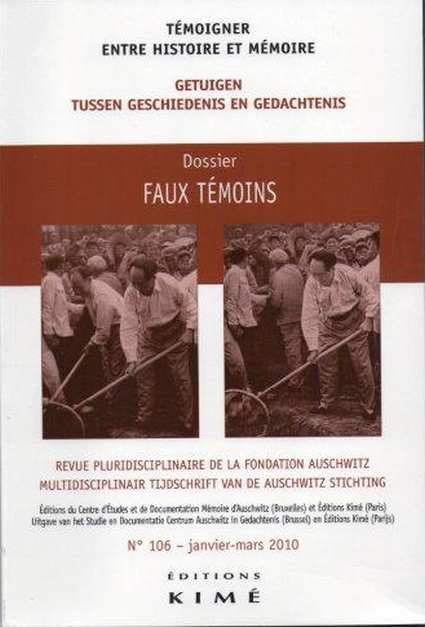
Il y a quelques mois, un scandale éclatait autour du best-seller de Misha Fonseca, « Survivre avec les loups », qui venait d’être adapté au cinéma par Véra Belmont. L’auteur du livre avouait qu’elle avait tout inventé, et n’avait jamais traversé, comme elle le racontait, une partie de l’Europe dans les années 1940, à la recherche de ses prétendus parents juifs déportés. Stupeur des réelles victimes de la Shoah, angoisse que de tels « faux témoins » donnent du grain à moudre aux négationnistes s’engouffrant dans la brèche : ce n’était pas pourtant la première fois la première fois qu’un tel scénario se déroulait, et là comme par le passé, rares ont été ceux qui pointaient les incohérences et invraisemblances pourtant nombreuses du récit : l’histoire d’une victime, innocente enfant parmi les loups au sens propre et figuré, frappait les cœurs, laissant les esprits comme anesthésiés dans leur réflexion.
Ce dossier de la revue de la fondation Auschwitz rappelle et analyse plusieurs de ces affaires, qui concernent principalement la seconde guerre mondiale mais aussi d’autres champs historiques (l’Afrique contemporaine, la guerre de 1914-1918), et tente de comprendre quels mécanismes permettent aux différents « faux-témoins » de s’exprimer, d’être écoutés et susciter un engouement très fort, qui d’ailleurs persiste parfois après que la supercherie a été démasquée. Mais il présente aussi différentes catégories de ces faux témoins, révélant un phénomène plus complexe qu’il n’y paraît.
« Vrai comme seule la fiction peut l’être »…
Trois affaires en particulier, qui ont défrayé la chronique en leur temps et concernent l’extermination des juifs, sont retracées de façon détaillée : celle d’abord d’un texte étrange, paru dès 1946 en yiddish dans une obscure revue argentine, puis promu à une célébrité mondiale : Yossel Rakover s’adresse à Dieu . Sorte de plainte d’un rescapé de la shoah sur le modèle de celle de Job dans l’Ancien Testament, ce très beau poème se présentait bien à l’origine comme une fiction, et son auteur Zvi Kolitz, juif de Lituanie immigré en Palestine, qui s’engagea dans l’Irgoun, avant de devenir journaliste, ne cachait nullement son identité. Mais, à la faveur d’une redécouverte (sans nom d’auteur) de ce texte dans les années 1950, et de son succès mondial, salué par des auteurs comme Thomas Mann ou Elie Wiesel, l’authenticité du témoignage jugé emblématique ne fut plus mise en cause avant longtemps, bien que Zvi Kolitz eut essayé plusieurs fois de faire connaître sa paternité sur le texte. C’est comme si le public avait préféré que le texte fût authentique, ou, comme l’a écrit Emmanuel Levinas à son propos, « vrai comme seule la fiction peut l’être ».
Deuxième exemple, celui d’un autre texte appelé au succès « L’oiseau bariolé » publié en 1965 par Jerzy Posinski, jeune juif polonais immigré à New-York. Ce récit poignant de l’itinéraire d’un enfant de six ans, caché par ses parents qui craignent la déportation, puis abandonné par sa protectrice et errant pendant la guerre d’un village à l’autre, en butte à la cruauté et aux sévices des adultes qu’il rencontre, allait vite frapper les lecteurs et devenir un classique de la « bibliothèque de la shoah », l’auteur laissant longtemps planer l’ambiguïté sur le caractère autobiographique ou non de son récit, en réalité éloigné de sa propre expérience. Intéressantes sont ici les déclarations successives qu’il fit, dénotant les changements de sensibilité au fil du temps : en 1976, il affirmait avoir voulu faire œuvre pédagogique et aider les jeunes Européens à mieux connaître la shoah, alors que lors de sa sortie, il disait s’interroger sur l’enfance, la souffrance et la façon dont le langage relate le traumatisme, sans aucune référence au contexte historique. Pour Alexandre Pristojevic, qui analyse l’affaire, il est frappant de constater également l’ « effet d’optique » qui a faussé la lecture de ce roman. Le lecteur croit et veut y trouver un témoignage authentique, phénomène préfigurant la « puissante lame de fond qui secouera l’Europe et l’Amérique du Nord à la fin du (XXe) siècle : celle de la « testimonalisation » des récits de fiction réalisée par un public de plus en plus attiré par l’autobiographie et le témoignage authentique ».
Enfin, plus tardivement, il y eut le succès lui aussi mondial de Fragments, une enfance 1939-1945, paru en 1995 et présenté cette fois très fermement comme les souvenirs authentiques d’un rescapé d’Auschwitz, Binjamin Wilkomirski. On apprendra trois ans plus tard que l’auteur n’a en fait aucun lien avec la communauté juive ou l’Europe de l’Est comme il l’affirmait, qu’il s’appelle Bruno Grosjean et a été adopté par une famille suisse. Sa connaissance de la Shoah est donc purement livresque ou scolaire. Mais par sa forme fragmentaire, inachevée, par la « mémoire de la chair » invoquée par l’auteur pour compenser le manque de précisions dans les lieux, les dates et même les faits, par la comparaison établie, comme un fil directeur du livre, entre le monde concentrationnaire et la Suisse de l’après guerre présentée comme une extension du camp, par la reprise de tous les grands motifs de la littérature de la shoah des années 1960 et 70, le livre du faux témoin n’avait pas été mis en question. Pour les trois œuvres en question, l’étonnante réception favorable dont elles ont bénéficié pourrait bien s’expliquer parce qu’elles « comblent l’attente du public en lui renvoyant, au niveau subconscient , sa propre image ».
faux témoins contraints, faux-témoins fabriqués…
On se souvient aussi peut être d’une affaire retentissante, celle d’Enric Marco, combattant républicain pendant la guerre d’Espagne, dont on découvrit en 2005 qu’il n’avait jamais été interné dans les camps de Mauthausen puis de Flössenburg jusqu’en 1945 comme il l’affirmait depuis les années 1970 au fil d’innombrables conférences, d’autant plus écoutées qu’il était président de l’amicale des déportés espagnols. En réalité, il avait été volontaire pour le travail en Allemagne puis avait fait un séjour dans les prisons de la Gestapo jusqu’à sa libération en 1943. La révélation de la forfaiture, explicable par le faible nombre de survivants espagnols des camps et la faiblesse de la recherche sur ce sujet, donna lieu à des attitudes contrastées : d’un côté la révolte des victimes bernées depuis tant d’années et regrettant le tort que Marco leur causait, ouvrant une brèche aux révisionnistes, et de l’autre une certaine tolérance et même parfois une admiration pour sa capacité à jouer un rôle pendant si longtemps.
Les autres exemples qui complètent ce dossier se situent un peu à la marge par rapport à la thématique du faux témoin : Aminata Niang et Sylvie Thiéblemont-Dollet présentent la falsification de la vérité à propos de la fusillade du camp de Thiaroye au Sénégal, où périrent en novembre 1944, 35 tirailleurs maliens : ces anciens prisonniers des stalags, regroupés à la périphérie de Dakar avant de retourner dans leurs régions d’origine, s’étaient rebellés à propos de primes non versées et de vexations, et le général responsable de la division fit ouvrir le feu sur eux. Parce que les faits ont été longtemps occultés, et qu’aucun témoignage des tirailleurs ne fut autorisé au moment du procès, les deux chercheuses montrent qu’un film de 1988, très librement inspiré des événements, mais reçu généralement comme un documentaire, et des témoignages apocryphes fantaisistes, tant sur les chiffres des victimes que sur le déroulement des faits, ont réussi à s’imposer dans les mémoires des Sénégalais, en Afrique et dans l’immigration, comme « la » réalité incontestable.
Alpha Ousmane Barry, lui, se penche sur la dictature guinéenne de Sékou Touré, de 1958 à 1984, et montre comment le pouvoir imposa une « torture morale », en exigeant régulièrement des témoignages de fidélité, où les citoyens étaient littéralement forcés de demander eux mêmes une politique de répression dans leur région, leur administration, ou même leur famille, lors des périodes d’épuration commandées par le dictateur. En leur faisant endosser ainsi la volonté sanguinaire du pouvoir, on les plaçait dans une situation inextricable ; ces « faux-témoignages »-là, escroqués, étaient l’un des piliers les plus solides sur lesquels le régime s’appuyait.
Plus inattendue, plus discutable aussi, est la contribution du dossier qui analyse avec une grande sévérité une émission de télévision consacrée aux tranchées de 14-18, diffusée lors de la commémoration de 90e anniversaire de l’armistice. Dans ce « docu-fiction » qui faisait intervenir un poilu imaginaire censé parler au nom de tous les soldats de la Grande Guerre, sur fond d’images d’archives colorisées et sonorisées, le message transmis reprenait très largement celui d’Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau (thème de la guerre consentie et intériorisée par les combattants). Pour Julien Mary, représentant de l’autre « école », celle du CRID 14-18, mettre ainsi, 90 plus tard, dans la bouche d’un personnage fictif un discours construit à partir d’une thèse discutée par d’autres historiens revient à une manipulation de l’histoire et à la construction d’un « imposteur qui avance sous le masque du témoin ». Plus largement, cette controverse interroge le développement du genre « docu-fiction » qui se banalise à la télévision, sans que le public sache toujours où passe la limite entre histoire et reconstitution, et la responsabilité des historiens, sollicités par les médias, dans la construction et la diffusion d’un savoir légitime.
Finalement, que peuvent nous apprendre ces divers « faux-témoins » ? Pour Jacques Walter, professeur à l’université de Metz, qui a coordonné ce dossier, le faux témoin est peut être un « analysateur du rapport entretenu au témoin », parfois considéré comme un « danger absolu » et parfois comme « une extraordinaire aubaine » : danger absolu, car il ouvre la porte aux doutes sur l’authenticité d’un événement, et dans le cas des faux témoins de la Seconde guerre mondiale, aux négationnistes qui ne se privent pas d’une telle occasion pour mettre en doute l’ensemble des témoignage. Mais, d’un autre côté, le surgissement du « faux témoin » et l’accueil souvent très ouvert qu’il reçoit n’a-t-il pas à nous dire paradoxalement plus sur l’état de notre société et ses « horizons d’attente », que sur l’événement concerné lui même ? Dans des sociétés demandeuses de témoignages et sacralisant les victimes, dont, implicitement, le récit n’a pas à être mis en question, et fonctionnant beaucoup sur l’émotion, le faux témoin ne trouve-t-il pas le cadre idéal à sa réception ?
© Nathalie Quillien
(site de la fondation Auschwitz : www.auschwitz.be)