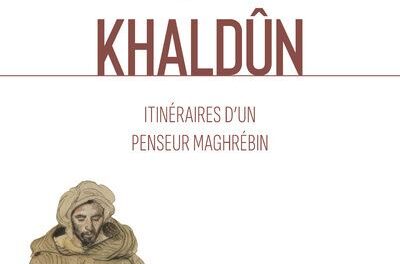Ce gros (et lourd) volume s’inscrit dans la collection dirigée par Joël Cornette, dont les premiers tomes sont parus en 2009. Pour ceux qui ne se seraient pas familiers avec cette série, il peut être utile de la présenter en quelques mots, avant de revenir sur certains aspects de ce volume.
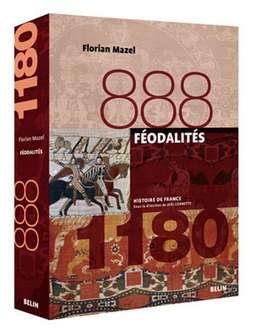
Une réussite éditoriale
Outre son poids, le premier élément qui saute aux yeux lorsqu’on consulte l’ouvrage est la quantité des illustrations. Elles sont abondantes, variées et leurs riches commentaires fournissent souvent des pistes pour une utilisation en classe. Seuls les documents écrits ne sont pas commentés et c’est un des rares bémols que l’on peut apporter. Ces illustrations sont de plus très bien insérées dans le texte, venant « reposer » le lecteur, tout en suivant le fil de l’exposition : pas besoin de se reporter x pages plus loin, tout coule de source.
L’absence de notes et le renvoi dans un chapitre final (« l’Atelier de l’historien ») de la présentation des débats universitaires, par exemple sur la mutation de l’an Mil, évite également de ralentir par trop le rythme de lecture. Ceci ne signifie pas que les critères scientifiques soient délaissés, bien au contraire : le texte est aussi précis et nourri des travaux récents que possible.
La notion même de « France » pose évidemment un problème à l’époque. La solution retenue est de prendre le territoire actuel comme référence, sans s’y tenir absolument : ne pas parler de Bruges à propos des villes flamandes n’aurait évidemment aucun sens. La conséquence de cette approche est une moindre importance accordée à l’histoire politique événementielle : mieux vaut en connaître les grandes lignes avant de se lancer dans la lecture, d’autant que, dans la deuxième partie, le chapitre consacrée à l’évolution idéologico-politique se situe après les autres.
Une très grande diversité de situations
Il est évidemment difficile de résumer en quelques lignes une synthèse de 700 pages et on s’en tiendra donc ici à quelques remarques générales, laissant de côté entre autre l’influence pourtant décisive de la réforme grégorienne. L’auteur divise la période en deux, le milieu du XIe siècle marquant plus une évolution progressive qu’une rupture.
Nombre d’ouvrages consacrés au Moyen Âge se concentrent sur la situation du nord de la France, qui devient plus ou moins consciemment la norme à l’aune de laquelle mesurer des « divergences » et des « écarts ». L’auteur évite cet écueil par une très bonne connaissance de la situation du Midi, en particulier méditerranéen : plus densément urbanisé dans tous les sens du terme (il y a à la fois plus de villes et de villages, et ces derniers sont plus denses, rejetant les jardins et vergers à l’extérieur), il subit plus tôt et plus intensément l’influence du droit romain. On y remarque en particulier la présence durable de chevaliers dans les villes, alors qu’au nord ils tendent à s’installer dans les campagnes à partir du XIIe siècle.
Mais l’auteur met aussi en exergue une division est-ouest, surtout au début de la période, entre les territoires d’Empire et ceux du roi de France. Les premiers sont caractérisés par une plus forte influence des évêques sur les villes, qui en sont souvent aussi les comtes, une situation que l’on ne rencontre que rarement dans les villes du second. Les monastères sont également plus étroitement soumis aux évêques dans l’Empire qu’à l’ouest, où les tensions sont bien plus fortes.
Après les carolingiens
La fin du IXe siècle l’Empire carolingien se disloque en plusieurs principautés. L’horizon se réduit puisque les grandes familles, comme les monastères, perdent les possessions qu’elles avaient à travers les différentes régions de l’Empire et doivent se concentrer sur un espace restreint. En revanche, ces familles acquièrent une plus grande liberté dans la transmission de leurs offices, considérés comme des biens patrimoniaux : comme le remarque l’auteur, la nouveauté n’est pas qu’un fils de comte deviennent comte à son tour, mais que le roi n’ait pas son mot à dire, et qu’il ne puisse plus choisir un autre membre de la famille comme c’était le cas auparavant. Ces familles fondent leur pouvoir sur les châteaux qu’elles érigent, plus lentement toutefois et de manière moins anarchique qu’on ne la cru, ou qu’elles font aménager : d’anciens palais carolingiens, dépourvus de défense, sont ainsi fortifiés, car le lieu de pouvoir par excellence est maintenant la fortification.
L’important est moins de contrôler des espaces que des hommes, qui sont peu nombreux, et dont les différences de statut s’atténuent depuis l’époque carolingienne dans beaucoup de régions : les hommes libres se trouvent soumis à des obligations qui les rapprochent des serfs. Ce contrôle des hommes est vital pour profiter de la croissance agricole, dont les prodromes se font sentir dès l’époque carolingienne.
Un douzième siècle revisité
L’auteur souligne que le XIIe siècle ne fut pas, contrairement à ce qu’on a longtemps pensé, marqué par une baisse des prélèvements seigneuriaux, bien au contraire. Il montre que les seigneurs, laïcs comme ecclésiastiques, ont très bien su s’adapter au contexte de croissance pour satisfaire leur soif de luxe en multipliant leurs sources de revenus. Ils ont ainsi, par des politiques très actives, attiré sur leur territoire les marchands ou en fondé des villes nouvelles. La croissance générale de la production a rendu la hausse des prélèvements tolérable pour les paysans, dont certains ont même pu acquérir une réelle aisance et progresser jusqu’au statut de chevaliers. Cette croissance explique le développement d’un artisanat rural et la multiplication des marchés ruraux, liée à une forte monétarisation des campagnes.
Le XIIe siècle ne fut pas non plus le siècle de la femme, bien au contraire : les douaires diminuent et les veuves n’en ont souvent que l’usufruit. Aliénor d’Aquitaine est une exception dans un monde où le rôle politique des femmes s’efface. La concentration sur le lignage, au détriment de la famille élargie et surtout de la famille de l’épouse, participe de cette exclusion de femmes des décisions.
En revanche, le XIIe siècle fut celui de la réaffirmation du pouvoir royal, surtout dans sa seconde moitié, sous les règnes de Louis VII, Henri II et Frédéric Barberousse. La réforme grégorienne a plutôt affaibli les princes, mais les compromis trouvés durant la première moitié du siècle au sujet des investitures reconnaissent le pouvoir du roi, voire le renforcent : en France, l’association de la royauté avec Saint-Denis procure à chacun un surcroît de prestige. Les souverains (r)établissent leur autorité sur les princes : pour la première fois, au XIIe siècle, le comte d’Aquitaine et celui de Toulouse font hommage au roi. Celui-ci dispose d’une administration de plus en plus étoffée, qui remplace progressivement les grands officiers et qui est à même de mieux gérer ses droits – bien que la monarchie française soit plutôt en retard par rapport à ses voisins.
Ces remarques ne peuvent donner qu’un aperçu de la richesse de l’ouvrage, encore une fois très bien écrit et aussi lisible que peut l’être un volume de cette ampleur. On ne peut donc que le recommander, entre autres pour la préparation des nouveaux programmes.