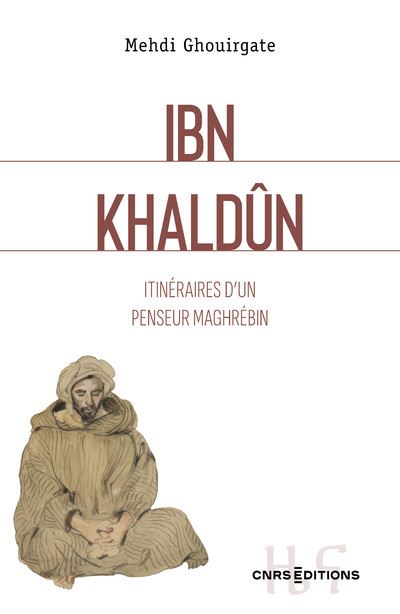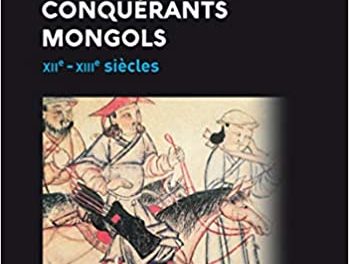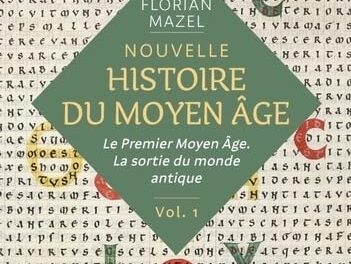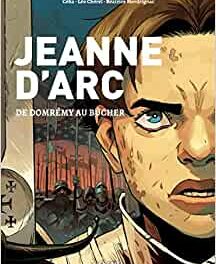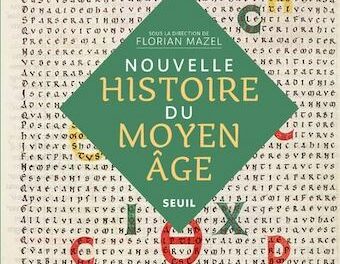« Ibn Khaldûn a conçu et forgé une philosophie de l’histoire qui est sans aucun doute la plus grande œuvre de ce type jamais créée par un esprit en tout temps et en tout lieu ». C’est par cette phrase d’Arnold Toynbee que Mehdi Ghouirgate, professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne et professeur associé à l’université Mohammed VI de Rabat, débute son enquête sur le penseur Ibn Khaldûn.
C’est que le penseur médiéval (1332-1406), natif de Tunis, jouit aujourd’hui d’une aura exceptionnelle.
Certains politiques contemporains ont pu se réclamer de sa pensée en Occident et les « Sud-s émergents » ont pu faire de même. Les premiers parce que les Prolégomènes (al- Muqaddima) au Livre des Exemples d’ Ibn Khaldûn seraient encore à même d’éclairer actuellement l’histoire et l’économie ; les seconds par ce qu’Ibn Khaldûn pouvait apparaître comme une alternative à la domination politico-intellectuelle de l’Occident.
Les études « khaldûniennes » sont légion et le penseur est « devenu un sujet « globalisant » autour duquel s’organise, désormais, une grande partie de l’histoire de la pensée du monde islamique et de la réflexion sur l’État et l’Empire. La chatoyante bigarrure de sa pensée fournit, de facto, la matière à de multiples analyses et suscite une fascination toujours renouvelée (p.16) ».
Ibn Khaldûn est ainsi devenu une référence en matière historique, sociologique, ethnologique et même économique. De fait, écrit Mehdi Ghouirgate (p.18), « Ibn Khaldûn expose, dans une œuvre monumentale, Kitâb al-ibar ou Livre des Exemples, une théorie de la civilisation qui constitue, probablement, la première tentative jamais réalisée d’une approche scientifique aussi rigoureuse que systématique de la société humaine ».
En une quinzaine de chapitres, Mehdi Ghouirgate se propose de rattacher Ibn Khaldûn a son époque et à l’espace dans lequel il vécut, de « situer sa vie dans son œuvre, et non pas l’inverse », et ce pour mieux saisir les cheminements internes de sa pensée.
Heurs et malheurs des ancêtres
Le chapitre 1 évoque tout d’abord le Ta’rif, un récit qu’offre Ibn Khaldûn de certains éléments de sa vie. Texte relativement court (quarante-quatre feuillets), il ne comporte rien qui touche à l’intime du penseur ou à son ressenti. Il ne contient pas plus de description physique. Mehdi Ghouirgate écrit que ce texte, « sert à justifier un acte de création d’une singulière ambition, la fondation d’une « science nouvelle», d’ailleurs probablement accueillie avec froideur par ses pairs (p.29) ».
Le propos se poursuit et présente la généalogie d’Ibn Khaldûn et l’importance de cette dernière pour le penseur des Prolégomènes . La trajectoire suivit par Ibn Khaldûn peut aussi s’apprécier à l’aune de celle de ses ancêtres.
La jeunesse d’un notable tunisois et la sénescence du monde
Le chapitre 2 débute sur la formation d’Ibn Khaldûn. Son éducation fut axée sur l’apprentissage de la langue arabe et il bénéficia d’un enseignement religieux. Ibn Khaldûn goûtait également la poésie et il composa lui-même des vers. Il se devait de maîtriser l’adab, c’est à dire la « politesse et (la) culture écrite profane (p.45) ». Il reçoit l’enseignement d’al-Abilî qui lui assure des connaissances en mathématiques, en logique, en droit et en philosophie.
Dans les années 1348 et 1349, Ibn Khaldûn connaît deux évènements de nature désastreuse qui change radicalement sa conception du monde.
Le premier est l’épidémie de peste noire. L’éminent historien fait quasiment débuter sa Muqaddima par cet épisode. Mehdi Ghouirgate écrit (p.55) que « dans sa vision du monde, la peste est simultanément le symptôme et la résultante de la sénilité du monde ». Plus loin, il écrit encore (p.58-59) : « aux yeux d’Ibn Khaldûn, la « Peste destructrice » introduit une césure nette dans le cours des choses, dans l’histoire. Elle dévoile la sénescence du monde ».
L’autre catastrophe aux yeux d’Ibn Khaldûn est la défaite du sultan mérinide Abû l-Hasan qui démontre « l’impossibilité d’unifier le Maghreb sous la houlette d’un seul pouvoir dynastique (p.60) ».
Les apprentissages d’un homme de lettres au service des dynasties
Le chapitre 3 évoque les ambitions d’Ibn Khaldûn mais également ses revers en la matière. Ibn Khaldûn se voit d’abord nommé «secrétaire du paraphe » auprès du sultan. Ce poste ne lui suffisant pas, il décide de quitter Tunis et de se rendre à Fès où il va parfaire sa formation scientifique. A Fès il obtient également la fonction de « secrétaire-greffier » en charge de la collecte des « placets » des sujets du sultan. Soupçonné d’avoir été mêlé à un complot, il est arrêté et jeté en prison pendant deux années. Libéré de prison, il trempe dans un complot menant à la mise sur le trône du prince Abû Sâlim. En remerciement, il est nommé secrétaire particulier, chargé de la correspondance et de la rédaction des ordonnances du souverain. Il obtient par la suite une charge judiciaire. En 1362, il quitte Fès et se rend à Grenade.
De Grenade à Séville, le retour sur la terre des ancêtres
Le chapitre 4 débute par la rencontre (et l’admiration ) d’Ibn Khaldûn pour un autre grand lettré de son époque, Ibn al-Khatîb et évoque l’arrivée du penseur à Grenade. En 1363, il est envoyé par le sultan Muhammad V à Séville afin de conclure un traité de paix avec le roi castillan Pierre le Cruel. Il reçoit par la suite l’ordre de partir pour Bougie.
De bougie à Biskra
Le chapitre 5 évoque donc tout d’abord le passage par Bougie d’Ibn Khaldûn. Bougie, écrit Mehdi Ghouirgate (p.101) est alors « le deuxième centre politique, économique et intellectuel de l’ancien califat hafside ». A Bougie, Ibn Khaldûn obtient la charge de Chambellan (il exerce donc de fait les pouvoirs du gouvernement) et il est nommé prédicateur de la mosquée de la Citadelle. Mehdi Ghouirgate écrit (p.103) que « la politique qu’il chercha à mettre en œuvre consistait, sans grande originalité, à maintenir la domination du pouvoir de Bougie sur les espaces jugés vitaux pour son commerce (…) ». Il n’occupe que peu de temps cette fonction (onze mois) et part se réfugier à Biskra, dans la province du Zâb. Il refuse un poste de vizir à Tlemcen. A Biskra, Ibn Khaldûn enseigne, entretient une longue correspondance avec Ibn al-Khatîb et observe les mœurs des habitants du Zâb (ce qui lui servira dans le cadre de la rédaction de sa Muqaddima).
Retour à Fès, dans le giron mérinide
Le chapitre 6 évoque son retour, forcé (à la suite de revers) dans le giron mérinide. Il retourne ensuite à Biskra puis à Fès. Il intercède auprès des Mérinides pour que son ami Ibn al-Khatîb ne soit pas exécuté mais en vain. C’est durant son séjour à Fès qu’Ibn Khaldûn rédige probablement son ouvrage (un livre de mystique) intitulé La Guérison de celui qui demande à aplanir les problèmes. Dans ce chapitre, il est également fait mention de l’attitude d’ Ibn Khaldûn qui appelle à l’autodafé d’œuvres qui ne lui semble pas correspondre à sa vision de la religion. Mehdi Ghouirgate écrit, avec causticité (p.127), qu’ « il va s’en dire que cet aspect d’un Ibn Khaldûn, prompt à faire appel à la violence exercée par une dynastie pour régler un problème doctrinal, ne peut être mis à l’actif d’un auteur perçu comme un précurseur des sciences humaines… ».
Qal’at Ibn Salâma : l’élan créatif
Le chapitre 7 est dédié au lieu de la rédaction de la Muqaddima, Qal’at Ibn Salâma (la localité correspond probablement aujourd’hui au village de Taghzawet en Algérie. Le lieu a fait l’objet d’une récupération politique contemporaine de la part du pouvoir algérien qui cherchait à exalter le parcours d’Ibn Khaldûn dans ce pays) et au processus de création de cette dernière. Ibn Khaldûn réside pendant plus de trois ans à Qal’at Ibn Salâma, de 1375 à 1378, et c’est en ce lieu que, habité par « une force créatrice », il conçoit « une science proclamée comme nouvelle, basée sur une méthode aussi singulière qu’inédite (p.138) ». Mehdi Ghouirgate écrit encore (p.139) : « sans livre sous la main, sa réflexion transforme l’empirisme et le pragmatisme borné en accouchant d’une science nouvelle. L’isolement dans une grotte, dans un milieu ambiant d’une grande austérité, s’est avéré propice à l’expression d’une incontestable originalité. Les Prolégomènes du Kitâb al-’ibar sont une œuvre charnière qui s’apparente, de par la somme des faits qu’elle met en lien en les rassemblant, à une synthèse du savoir humain, doté de règles et de lois, que lui seul semble avoir discernées ».
Tunis et le départ vers l’Orient
Le chapitre 8 mentionne le retour d’Ibn Khaldûn à Tunis. Consacrant sa vie à l’enseignement, il est victime de l’exécrable réputation qui est désormais la sienne et se voit contraint de quitter sa ville natale pour le Caire.
Une pensée du décentrement
Le chapitre 9 insiste sur l’importance des voyages et exils d’Ibn Khaldûn dans la construction de son modèle historique et dans l’élaboration de sa pensée. Mouvement, mobilité et don de l’observation ont eu un impact central sur sa conception de l’Histoire et Mehdi Ghouirgate écrit (p.173) que « fondamentalement, le mouvement, l’omniprésence du danger, l’immersion contrainte dans un milieu exogène au sien ont agi en profondeur sur son corps et donc sur sa capacité à penser, avant de l’amener à produire une œuvre. On comprend dès lors comment les connaissances induites par la mobilité et le décentrement forcé par rapport à son milieu d’origine, doublées d’un sens exceptionnel de l’observation, ont produit des effets incommensurables sur Ibn Khaldûn (…) ».
Le Caire ou le temps de la « civilisation urbaine
Le chapitre 10 évoque l’arrivée d’Ibn Khaldûn en Égypte. Il présente ce pays comme la « quintessence de la civilisation urbaine » et offre un portrait dithyrambique de la ville du Caire. Ibn Khaldûn y donne des cours à la mosquée Al-Azhar et y obtient la charge de grand cadi du rite malikite. Mais son intransigeance lui vaut une disgrâce et c’est seulement 14 ans après cette dernière qu’il retrouvera la même fonction (il mourra d’ailleurs en charge). Il connaît un drame épouvantable avec la mort d’une large part de sa famille et tombe une nouvelle fois en disgrâce après avoir trahi le sultan qu’il servait.
Tamerlan, entre fléau et puissance régénératrice
Le chapitre 11 traite des dernières années de la vie d’Ibn Khaldûn et de la geste de Tamerlan. Alors que Damas est assiégée, Tamerlan demande à voir Ibn Khaldûn qui s’y trouvait également. Mehdi Ghouirgate écrit que « cette rencontre éphémère n’eut pas de suite (p.206) ». Ibn Khaldûn rentre en Égypte en 1401 et y décède en 1406.
La réception d’Ibn Khaldûn au Maghreb et en Orient
Les chapitres 12 et 13 traient de la réception d’Ibn Khaldûn au Maghreb et en Orient.
Mehdi Ghouirgate écrit (p.211) qu’ « au Maghreb, l’intérêt pour Ibn Khaldûn se portait tout particulièrement sur la chronique, le Kitâb al-’ibar sans que la partie plus théorique de son œuvre, la Muqaddima, ne soit totalement absente des bibliothèques ». En Orient, Ibn Khaldûn a fait l’objet d’un intérêt, même s’il est de nature différente de celui suscité sur sa terre natale.
Deux relais essentiels : Al-Maqqari et Jean-Léon l’Africain
Le chapitre 14 mentionne la diffusion de l’œuvre d’Ibn Khaldûn par Al-Maqqari (auteur originaire de Tlemcen ayant réalisé une grande anthologie consacrée à l’Occident musulman), qualifié de « grand diffuseur de la pensée khaldûnienne » et par Léon l’Africain (auteur de l’ouvrage Description de l’Afrique), « premier diffuseur en langue européenne, non seulement du nom d’Ibn Khaldûn, mais aussi et surtout de sa pensée et de sa vision de l’histoire (p.243) ».
La révolution scientifique et ses implications
Le chapitre 15 mentionne pour finir le développement de « l’orientalisme » en France, la création de l’École des langues orientales et la réception, dans ce contexte, d’Ibn Khaldûn avec le personnage d’Antoine-Isaac Silvestre de Sacy qui « plus que tout autre, (…) fonda l’orientalisme, alliant une impressionnante œuvre scientifique riche de près de 434 travaux à son entregent politique et académique (p.257) ». La fin du chapitre s’intéresse à la réception de l’œuvre d’Ibn Khaldûn dans le cadre du colonialisme.
Dans sa conclusion, Mehdi Ghouirgate écrit (p.273) qu ‘ « à l’instar de tous les grands penseurs, Ibn Khaldûn est tour à tour adulé et dénigré, glorifié et stigmatisé. Loin de laisser froid, il est capable de susciter, plus que jamais de l’intérêt ». Plus loin, il ajoute que « sa pensée se présente comme une philosophie de l’homme fondée sur les données de l’existence, dans et à travers l’histoire ».
L’ouvrage de Mehdi Ghouirgate est d’une très belle érudition, écrit avec une grande clarté et il s’adresse autant aux spécialistes qu’aux néophytes.
On chemine avec grand plaisir en la compagnie d’un grand penseur à la lecture des pages de ce beau livre, dont la démonstration concernant le rôle du voyage et de l’exil dans la construction de la pensée d’Ibn Khaldûn, emporte l’assentiment.