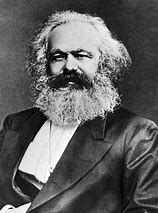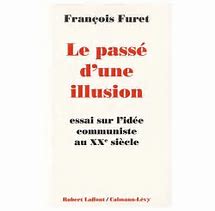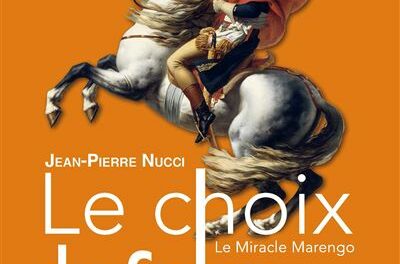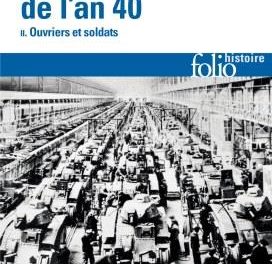La biographie est un genre délicat et ce d’autant plus quand on n’éprouve guère d’inclination pour son sujet. L’auteur confesse ses réticences premières vis-à-vis de François Furet. Réticences nourries des préjugés et préventions que l’historien pouvait provoquer. Or, se faisant biographe, Christophe Prochasson est passé d’une réelle réserve à la bienveillance. C’est pourquoi, à la lecture, nous éprouvons le sentiment de l’accompagner dans sa découverte du « spécialiste de la Révolution ». Avec lui nous cheminons dans la construction d’une biographie (ce qui peut expliquer certaines répétitions) qui, au final, se révèle certes bienveillante mais sait également rester critique. Ainsi sont éclairées les contradictions du personnage dont l’auteur souligne cependant la cohérence du parcours intellectuel. De même, Christophe Prochasson en profite pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues concernant François Furet. Au final, l’auteur souhaite que sa biographie soit reçue « comme une contribution à l’histoire politique et intellectuelle de la seconde moitié du XXe siècle ». L’ambition avouée est donc plus large que la simple étude de la vie de François Furet même si, dans le cas présent, œuvre et vie se confondent pour offrir, de fait, cette contribution à l’histoire de l’énigmatique XXe siècle. Christophe Prochasson nous invite tout d’abord, dans une première partie, à découvrir François Furet historien tandis qu’une deuxième partie analyse sa trajectoire politique. Toutefois, le biographe nous laisse à penser que cette économie de l’ouvrage peut se révéler quelque peu artificielle tant histoire et politique sont mêlées chez cet intellectuel que fut François Furet. L’auteur nous entraîne ainsi dans la fabrique de l’historien en nous présentant sa formation, son parcours professionnel et, en filigrane, sa personnalité.
27 janvier 1995. Sur le plateau de « Bouillon de Culture » François Furet, venu présenter son dernier ouvrage (« Le Passé d’une illusion »), répond à Bernard Pivot que son mot préféré est « mélancolie ». A première vue cela a de quoi surprendre tant sa personnalité est faite de force de caractère, de clarté d’esprit, d’aisance et d’assurance voire d’arrogance et de brutalité. Or, à bien y regarder, la mélancolie hante toute l’œuvre de l’historien et, en particulier, ses analyses du terrible XXe siècle, siècle des guerres et des massacres, des illusions et de l’irrationnel. La mélancolie chez Furet se révèle source de lucidité et repose sur une contradiction : il faut changer le monde mais ce changement ne peut que provoquer de nouvelles catastrophes. Son monde intellectuel aussi est peuplé de mélancoliques : Chateaubriand et Tocqueville ; Elie Halévy et Raymond Aron. L’épisode de « Bouillon de Culture » est à retenir car, le plus souvent, F. Furet appréciait peu de se livrer. Peut-être pensait-il, secrètement, en évoquant ce mot surprenant, que cela conduirait à porter un regard différent sur son œuvre. Ce caractère peu enclin aux confidences personnelles explique que son enfance et sa jeunesse soient restées entourées de « mystère », mot qu’il affectionnait tout particulièrement.
La fabrique de l’historien
Formation et parcours professionnel
François Furet (1927-1997) connaît une jeunesse bourgeoise et évolue dans un milieu progressiste (Georges Monnet, son oncle, a été député socialiste, proche collaborateur de Léon Blum et ministre de l’Agriculture du Front populaire). Le futur historien traverse l’Occupation comme lycéen mais, en juin 1944, le jeune bachelier Furet rejoint un maquis FFI dans le Cher avant d’être intégré à l’armée de Libération qu’il quitte brutalement. F. Furet, excellent élève, se destine à l’ENS et est inscrit en Hypokhâgne et Khâgne au lycée Henri IV. Après son échec à l’ENS il se réfugie à la Sorbonne mais l’histoire qui y est alors enseignée le séduit peu. Il obtient par ailleurs une Licence de Lettres (1949) et une Licence de Droit (1951). Politisé, il est alors communiste, le futur historien entre à l’UNEF, tout comme son camarade Emmanuel Leroy Ladurie. Cependant, durant ces années de formation, Furet doit lutter contre la tuberculose alors en pleine recrudescence. Il se joint néanmoins à un petit groupe d’agrégatifs communistes où il se crée des amitiés durables : Mona et Jacques Ozouf, Alain Besançon, Maurice Agulhon, Emmanuel Leroy Ladurie. Cette petite troupe d’étudiants est séduite par Ernest Labrousse avec qui Furet fait son DES consacré à la Nuit du 4 août. Par la suite Furet sera en rupture politique et historiographique avec celui qu’il appelait le « grand historien marxiste ».
Pour l’heure, les cellules communistes étudiantes représentent un monde social, culturel et amical très fort, voire une seconde famille, dont il semble très difficile de s’extraire. Ainsi, Annie Kriegel, passant le relais, fait entrer dans la rédaction de « Clarté », revue étudiante communiste, son frère Jean-Jacques Becker de même que Furet et Leroy Ladurie. F. Furet évolue donc dans un climat intellectuel très idéologisé ce qui explique largement la vigueur de son rejet ultérieur. En 1954 Furet obtient l’Agrégation d’histoire. Il enseigne, sans plaisir, durant deux ans dans le secondaire puis, délaissant sa carrière de professeur de lycée, il s’engage dans une carrière de chercheur au CNRS et au Centre de recherches historiques (CRH) de la sixième section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) où il est affecté grâce à l’appui d’Ernest Labrousse et de Fernand Braudel. Parallèlement, Furet se fait journaliste en collaborant avec « France Observateur ».
Au sein de l’EHPE, Furet est tout d’abord chef de travaux (1961) puis maître de conférence (1964) et enfin directeur d’études (1965). Dans cette institution Furet travaille au sein d’une véritable communauté scientifique qui effectue un travail collectif. Jusqu’au début des années 1960, période dominée par Braudel, les orientations de la recherche sont très économiques. Furet est alors un homme de fiches participant aux grandes enquêtes collectives de l’histoire économique et sociale. Il apparaît comme un élève zélé et appliqué de l’histoire quantitative comme en témoigne son ouvrage de 1961, « Structures et relations sociales à Paris au XVIIIe siècle ». De 1965 à 1995 Furet a assuré un séminaire qui semble être l’espace principal d’élaboration de son œuvre. En 1970, ayant pris la tête du CRH, Furet infléchit quelque peu l’approche historiographique du centre. En effet, ce qui passionne Furet est moins la collecte documentaire que l’analyse et la construction problématisée des sources. Déjà se profilent une histoire plus conceptuelle et politique ainsi qu’une pensée rétive à tout déterminisme et à tout dogmatisme. Par ailleurs, l’historien en formation voue un véritable culte aux livres et aux auteurs avec lesquels il entretient un dialogue permanent et quasiment charnel. Ainsi fait-il siens quelques grands auteurs parmi lesquels émergent prioritairement les figures de Marx et de Tocqueville. Dans son panthéon Furet fait donc se côtoyer le socialiste allemand et l’aristocrate libéral !
Marx et Tocqueville sont donc ses premiers guides. Le second ayant sans conteste sa préférence, il se fait spécialiste de Tocqueville dont l’œuvre lui semble un moyen de renouveler l’étude de la Révolution. L’influence de Tocqueville marque le travail et l’enseignement de Furet. Tocqueville se révèle être un objet de connaissance mais également un inspirateur et un exemple. A l’origine critique vis-à-vis du spécialiste de la démocratie, Furet finit par en faire son modèle. Tocqueville est un intuitif et cela le rassure. Ainsi, « deux hommes peuvent être séparés par le temps et vivre dans le même univers intellectuel ». Tout est dit. Au-delà d’une réelle complicité intellectuelle, Furet partage avec Tocqueville bien des traits de caractère et cette proximité, de cœur et d’esprit, n’est pas sans engendrer un certain mimétisme. Ils communient tout deux dans l’étude approfondie de la démocratie et partagent la même volonté de faire œuvre d’écrivain. Furet a, comme son modèle, l’obsession de la forme, lui pour qui l’intelligence ne saurait s’affranchir de l’élégance du style. Enfin, ils ont en commun l’intérêt pour l’Amérique, l’attirance déçue pour la politique, la passion pour le présent, la solitude et le même décalage dans le temps.

Chez Tocqueville Furet trouve tout d’abord le lien consubstantiel entre démocratie et égalité et comprend que cette dernière est fondamentale pour appréhender la passion révolutionnaire dont elle est la matrice. L’égalité, dans les démocraties, fonctionne comme un horizon idéal mais toujours inatteignable. Furet se servira de l’analyse du processus égalitaire, qui alimente les passions, pour considérer le communisme comme une dérive de la démocratie. De fait, l’historien, très attentif au rôle des idées et des représentations mentales qui configurent la démocratie, sonde « L’Institution imaginaire de la société » (Cornélius Castoriadis). Dans ce véritable échange avec Tocqueville, l’intimité de la relation nouée avec l’œuvre de ce dernier est frappante et a peut-être, nous dit son biographe, fait naître chez Furet l’espoir d’être un nouveau Tocqueville. Néanmoins, Furet reproche à son modèle d’avoir trop négligé la dimension économique de la Révolution. Où l’on s’aperçoit que pour avoir développé une histoire politique, intellectuelle voire culturelle, Furet n’a pas méprisé pour autant les apports de l’histoire sociale et économique. Il a simplement, à partir des années 1970, utilisé d’autres outils que ceux de l’histoire quantitative et sérielle.
Furet ne s’est pas privé de signifier que la récupération politique de Tocqueville par les libéraux des années 1980 lui paraissait illégitime. En effet, l’auteur de « L’Ancien régime et la Révolution » est bien trop complexe pour être réduit à un courant politique. De même, le préjugé répandu faisant de Furet un adversaire de Marx se révèle inexact. Marx a eu les premières faveurs du jeune Furet, alors communiste, et reste, aux yeux de l’historien confirmé, l’un des grands penseurs du XIXe siècle qu’il fréquentera toute sa vie. Par ailleurs, Furet sera très critique vis-à-vis des tentatives, selon lui stupides, de remettre en cause intégralement Marx et son œuvre. Si les historiens communistes, d’ailleurs jugés plus jacobins ou léninistes que marxistes, sont la cible de Furet, Marx, lui, est épargné. Ainsi, Furet apparaît comme un marxologue non marxiste. Il estime que le courant de pensée se prévalant de Marx n’a fait que dévitaliser la pensée de celui-ci et l’a figé dans un dogme infaillible. Sur cette question, Furet est dans la lignée de Georges Sorel et, plus tard, de Raymond Aron, c’est-à-dire une approche critique des écrits de Marx. Comme à son habitude, Furet replace Marx dans la longue durée : la pensée du philosophe allemand prend racine dans le XVIIIe siècle, fleurit au XIXe et se prolonge, sous des formes dégradées, au XXe.
Furet a souvent associé Tocqueville et Marx qui, à ses yeux, sont complémentaires car, estime t-il, ils se posent les mêmes questions mais empruntent des voies divergentes et apportent des réponses différentes. Tocqueville est obsédé par la politique là où Marx préfère l’économique, même si « la pensée de Marx est plus variée, à cheval sur trois cultures, l’allemande, la française, l’anglaise. Elle est historique, économique, encyclopédique au fond. Elle veut atteindre une conception globale de l’histoire. Elle est beaucoup plus sophistiquée que celle de Tocqueville ». Furet reproche cependant à Marx de soumettre le social à l’économique (rapport des forces de production) quand Tocqueville s’installe au cœur du social, c’est-à-dire le culturel, soit les représentations collectives qui s’expriment dans l’ordre du politique. Tocqueville pense l’égalité en termes de représentation et de passion ; Marx la considère de manière très concrète. Là où Tocqueville regarde « le système de croyance égalitaire », Marx analyse le prolétariat et la misère de son temps et réduit la politique à une « illusion ». L’auteur du « Capital » dénonce l’inégalité réelle, la contradiction entre les faits et les valeurs, l’illusion de l’égalité bourgeoise (« égalité formelle »).
Lorsqu’il s’agit de l’analyse marxiste de la Révolution, Furet est radical : en réalité, selon lui, c’est une analyse léniniste et Lénine n’est qu’un piètre penseur qui a dévoyé la pensée de Marx. Furet veut sauver Marx des « marxistes », c’est-à-dire des lectures bolcheviques de ses écrits, et le laver de la « contamination soviétique » : « L’œuvre de Marx, dans ce qu’elle a d’important, peut et doit être distinguée du communisme du XXe siècle ». De plus Furet distingue plusieurs Marx : le philosophe, l’historien, l’économiste, le révolutionnaire, le scientifique. Enfin, Marx s’inscrit dans la longue tradition de l’émancipation. Intellectuellement Furet est toujours resté fidèle à l’auteur du « Capital » dont la pensée lui semble incontournable. Aussi est-il étonné par l’attitude des « nouveaux philosophes » qui oublient Marx ou, pire, voient dans sa pensée les origines du Goulag (André Glucksmann). Pour Furet les choses sont claires : on ne saurait rendre Marx responsable de l’utilisation dont sa pensée a fait l’objet. De « La Révolution française » (1965) à « Marx et la Révolution française » (1986) l’empreinte du philosophe allemand est visible dans l’œuvre de Furet. En un clin d’œil malicieux aux épigones de Marx, Furet dit du penseur socialiste : « Il peut avoir l’esprit faux, il n’a jamais l’esprit court ».
Si Tocqueville et Marx, les « géants », ont une place privilégiée, Furet n’en a pas moins d’autres références parmi lesquelles, Quinet, Jaurès et Elie Halévy. Ces trois intellectuels ont en commun d’avoir pensé la démocratie et, avec d’importantes différences, d’être de gauche : un républicain idéaliste et donc critique, un républicain socialiste et un républicain libéral. Or, ces trois positions composent l’arc-en-ciel idéologique de Furet nous dit Christophe Prochasson. L’historiographie révolutionnaire de Quinet, politique, antirobespierriste, critique de la Terreur et de l’inachèvement de la Révolution séduit Furet. Quinet, qui divisa la gauche en posant la question de la Terreur (« La Révolution », 1865), n’a pas bonne réputation chez les jacobins. Il a été accusé d’affaiblir la cause républicaine, tout comme Furet le sera de désarmer la gauche. En ce qui concerne Jaurès, Furet estime qu’il est l’auteur de la dernière histoire monumentale de la Révolution, dans la veine du XIXe siècle. L’œuvre du leader socialiste est militante et savante, politique et sociale. Pour son analyse sociale Jaurès emprunte à Marx et à Barnave, déjà la volonté de synthèse, et affirme l’autonomie du politique. On trouve chez Jaurès et Furet la même allergie aux dogmatismes, la même volonté de comprendre la complexité du phénomène révolutionnaire et l’espoir d’une gauche de progrès. Cependant, toujours critique, Furet reproche à Jaurès de faire sienne la césure classique de l’historiographie révolutionnaire : avant, le féodalisme ; après, le capitalisme. Néanmoins, Furet admire chez Jaurès la capacité à être à la fois un intellectuel et un homme politique. Rêve que Furet a certainement caressé si l’on en croit son biographe.
A la fin de sa vie et en préparant « Le Passé d’une illusion » où il compare le nazisme, le fascisme et le communisme, Furet se tourne vers les observateurs des années 1930. C’est alors qu’il fait d’Elie Halévy l’un de ses plus proches compagnons intellectuels. Halévy est utilisé dans l’ouvrage de Furet tout d’abord comme témoin de la Grande Guerre. Halévy est un autre intuitif dont les fulgurances fascinent Furet. En 1914-1918, il a compris que disparaissait sous ses yeux la civilisation libérale de l’Europe occidentale. Furet se sert également du Halévy théoricien qui, en 1936, mit en parallèle les « trois tyrannies ». Là encore, Furet est séduit par le libéral, au sens large du terme, rétif aux dogmatismes, inscrit dans la tradition des Lumières, homme de gauche et non-conformiste. Ainsi se rêve Furet : inclassable, incompris, ne cédant à rien et poursuivant son œuvre dans son atelier. Atelier dans lequel Christophe Prochasson nous invite à pénétrer.
Dans l’atelier de l’historien
En 1975 la sixième section de l’EHPE devient l’EHESS dont Furet, succédant à Jacques Le Goff , devient président en 1977 et ce jusqu’en 1985 date à laquelle il commence un enseignement aux Etats-Unis (Université de Chicago notamment). A la tête de l’EHESS l’historien de la Révolution renforce son autorité scientifique, favorise le recrutement d’intellectuels dont les travaux sont aux marges des centres d’intérêt de l’EHESS (Marcel Gauchet, Pierre Rosanvallon) et rapproche la philosophie et l’histoire. Ainsi, on le voit, Furet a traversé plusieurs âges historiographiques et changé sa façon de travailler car, entre 1950 et 1997, l’histoire a beaucoup évolué et l’historien a progressivement déserté l’histoire quantitative et sérielle qui caractérisait les « Annales », pour développer une histoire politique et conceptuelle. Cependant si Furet s’est peu à peu détaché des grandes enquêtes de l’histoire quantitative, il a toujours reconnu à celle-ci sa force probatoire. Enfin, à la tête de l’EHESS, Furet a pu libérer son goût pour la polémique historiographique. Ce goût pour la controverse apparaît chez lui comme une seconde nature mais surtout comme une compensation à un militantisme déçu. Dans la vie de François Furet les dimensions affective, politique et intellectuelle sont très imbriquées. Christophe Prochasson, à partir du fonds d’archives privé de Furet, s’attache à brosser un portrait plus intimiste de l’historien afin d’éclairer ses textes et le sens de sa démarche intellectuelle. Si Furet a connu des ruptures historiographiques et intellectuelles, il a cependant conservé une ligne, gardé un cap. Si en France politique et histoire vont ensemble, ce mariage est incontestable chez l’historien de la Révolution.
Ch. Prochasson souligne que Furet s’est peu penché sur l’épistémologie. On notera cependant sa participation à l’ouvrage dirigé par J. Le Goff et P. Nora, « Faire de l’histoire » (1974) et son ouvrage personnel, « L’Atelier de l’histoire » (1982). Toutefois, à l’éternelle question de savoir si l’histoire est une science, Furet répondait par la négative et précisait que celle-ci oscille « entre l’art du récit, l’intelligence du concept et la rigueur des preuves ». Son épistémologie est donc relative mais elle repose cependant sur quelques principes forts, en particulier la critique du déterminisme. Furet, en effet, rejette le postulat répandu de la nécessité de ce qui a eu lieu. Selon lui c’est une reconstruction a posteriori qui rend un évènement inévitable. Il est plus attentif aux accidents qui font de l’histoire une « énigme ». Toutefois Furet prend bien garde de ne pas trop exagérer les « hasards et leurs effets ». En effet, si l’histoire n’est constituée que de hasards « l’historien n’a plus rien à faire ». Il convient simplement, face à une situation, une époque, d’appréhender les diverses possibilités. Furet n’a de cesse de réintroduire incertitudes et imperfections dans le cours de l’histoire. Ainsi, l’épistémologie de Furet tend à mettre en avant la singularité des phénomènes historiques. L’auteur de « Penser le XXe siècle » déclare : « Le travail historique consiste dans une grande mesure à conjurer l’illusion rétrospective de la nécessité, et, à réintroduire dans l’étude du passé la part des circonstances et de l’invention humaine. De ce qu’un évènement a eu lieu, on ne peut conclure que lui seul était possible ».
Furet est en général assez critique à l’égard des différentes « écoles » historiques. Ainsi, dans les années 1970, il ne partage pas la fièvre pour la « nouvelle histoire » née du mariage entre l’histoire et les sciences sociales. Il est très réservé vis-à-vis des « Annales » et de l’irruption des sciences sociales dans le champ historique. L’historien flaire à la fois un retour des réflexes marxistes via le structuralisme et un penchant trop prononcé pour l’ « exotisme », c’est-à-dire l’insignifiant. De même, il est peu attiré par l’histoire des mentalités qui, selon lui, a tendance à une psychologisation excessive. Il ne se reconnaît pas non plus véritablement dans l’histoire culturelle qui devient très présente dans les années 1990. Enfin, Furet regrettait la prééminence d’une histoire trop gallo-centrée et récusait quelque peu ce qu’il convient d’appeler le « roman national » en des termes clairs : « En France tout particulièrement, l’histoire et la nation ont entretenu des relations incestueuses. La seconde a commandé à la première un récit, avec un début où l’on scrute les origines comme on le fait d’un individu dont on retrace le destin, et, sinon une fin, au moins un sens qui confère à l’histoire nationale une dimension téléologique. Selon cette fin, par exemple l’accomplissement du projet républicain en France, celui de la nation, du progrès, de la démocratie ou de la liberté, l’historien sélectionne des évènements et se mue ainsi en intellectuel organique de la nation ».
Au vu de ses nombreuses préventions et de ses multiples rejets, on est en droit de se demander quelle histoire trouvait grâce aux yeux de Furet. Après avoir été, nous l’avons vu, un élève appliqué de l’histoire quantitative et sérielle, Furet défend, à partir des années 1970, une histoire-problème qui diffère sensiblement de celle des « Annales ». Furet fait du politique l’instance la plus englobante et son histoire-problème n’est autre qu’une histoire conceptualisante. La création de l’institut Raymond Aron, décidé par l’EHESS en 1984 et dont Furet prend la présidence, illustre ce renouveau de l’historiographie. En effet, l’institut est conçu comme un club de pensée où se côtoient historiens et philosophes (Mona Ozouf, Alain Renaut, Tzvetan Todorov, Marcel Gauchet, Pierre Rosanvallon, Ran Halévy, Pierre Nora…). En 1992, l’EHESS crée le Centre de recherches politiques Raymond Aron, dirigé par Furet et Rosanvallon. Ce Centre, selon la volonté de Furet, qui l’imprègne de son itinéraire intellectuel, développe une nouvelle approche du politique fondée sur la rencontre entre historiens et philosophes.
L’histoire politique et conceptuelle envisagée ici n’est pas celle des luttes, des partis ou du catalogue d’idées, histoire par ailleurs représentée par René Rémond et ses élèves. Furet cherche à comprendre la force des idées politiques dans l’histoire, non à élaborer un annuaire doctrinal. Ainsi, « cette histoire raconte surtout, à travers le changement et le progrès, la liberté des hommes ». Il s’agit donc d’une histoire de l’émancipation et d’une approche culturelle (les représentations) des idées politiques. Il n’est donc pas surprenant dès lors de retrouver dans cette aventure l’influence de Cornélius Castoriadis, Marcel Gauchet, Pierre Rosanvallon et surtout de Claude Lefort dont la conception du politique, qui ne se réduit pas à l’idéologie mais est une force englobante de la société, séduit beaucoup Furet. Le Centre est véritablement l’atelier de Furet dont le désir est de laisser une œuvre irréductible et c’est là qu’il façonne cette marque inimitable qui, selon son biographe, ne peut être réduite à un courant, une sensibilité ou une école. L’historien, s’il n’est pas un marginal tant est grand son rayonnement, reste, selon la formule de Jérôme Grondeux, un « latéral ». Cette position est particulièrement nette dans son approche de la Révolution.
L’historien de la Révolution
« J’ai voulu rouvrir la « question » de la Révolution française, et je souhaite moins que tout la refermer sur une interprétation dogmatique ». Tout est dit, la passion historique et la préoccupation politique. Les émotions politiques peuvent se muer en passions intellectuelles et F. Furet a introduit toute l’ardeur d’un engagement politique dans l’historiographie de la Révolution : « L’ensemble des questions et des problèmes qui m’avaient porté à être communiste, je les ai réinvesti dans ma curiosité historique ». On ne saurait être plus clair. Pour paraphraser Clausewitz, l’histoire est ainsi la continuation de la politique par d’autres moyens. L’histoire de la Révolution est au cœur de l’œuvre, et de la vie, les deux étant étroitement mêlées, de Furet. Tout d’abord spécialisé dans l’histoire économique et sociale, il entre comme par effraction dans l’histoire révolutionnaire. Cette entrée dans une historiographie alors dominée par des historiens de gauche, universitaires et gardiens du temple, provoque rapidement des réserves. Furet se voit reprocher son illégitimité (il n’est pas issu du sérail) et son incompétence (il ne maîtrise pas les sources).
La Révolution est tout à la fois un objet historique et un objet politique et faire son histoire correspond, très souvent, à un engagement idéologique. Songeons à Chateaubriand, Lamartine, Tocqueville, Michelet, Blanc et tant d’autres. Furet, n’échappant pas à cette règle, apporte « sa participation personnelle au concert idéologique ». Se voulant au-dessus de la mêlée politico-historiographique il plonge toutefois dedans. L’histoire de la Révolution est politisée depuis ses origines. Le Centenaire de la Révolution avait témoigné de cette politisation extrême. Toute une lignée d’historiens républicains, jacobins, socialisants puis marxisants ont occupé à partir des années 1880 le devant de la scène historiographique grâce à la chaire d’Histoire de la Révolution de la Sorbonne (Alphonse Aulard, Albert Mathiez, Georges Lefebvre). Si, au départ, Mathiez et Soboul restent pour Furet des intouchables, celui-ci commet l’irréparable en publiant avec Denis Richet (ami et beau-frère) « La Révolution française » en 1965-1966. L’ouvrage déclenche la fameuse controverse autour de la Révolution en provoquant un tollé chez les universitaires spécialistes de la période.
Le « Furet-Richet » suscite deux critiques principales : ce sont de jeunes historiens, dépourvus de thèse, non issus du sérail et qui viennent braconner dans une chasse gardée ; c’est une offensive anticommuniste. Surtout, la notion centrale de l’ouvrage (la thèse du « dérapage » de 1792-93, moment où l’on passe de la « bonne » à la « mauvaise » Révolution) est fortement remise en question. Cela peut surprendre car l’ouvrage reste largement dans la lignée de l’historiographie classique et de l’approche économique et sociale (les auteurs écrivent ainsi : « Tout part de la crise financière »). D’ailleurs Furet, revenant sur l’objet de la controverse, jugera le livre « très marxiste » tout en faisant quelque peu marche arrière quant à la notion de « dérapage » (« Penser la Révolution française », 1978). Ce qui ne l’empêche pas de s’amuser du débat provoqué en confessant une certaine désinvolture dans l’écriture et une volonté de secouer les tenants de l’orthodoxie. La controverse n’est pas simplement d’essence intellectuelle, elle recouvre des querelles politiques, des affrontements générationnels et des concurrences institutionnelles.

F. Furet plaide non pas pour une objectivité absolue, qui reste inatteignable, mais pour une neutralisation des affects car il constate que la gauche et ses historiens ont avec la Révolution une relation passionnelle. Selon Furet, cette relation implique un aller-retour permanent entre le passé (la Révolution) et le présent (l’attente de l’émancipation) et donc une analyse de type analogique et non compréhensif. La gauche espère de la Révolution des « lendemains qui chantent », aussi veut-elle rejouer l’évènement mais ne cherche pas réellement à le comprendre dans toute sa complexité. Enfin, sans doute conduit par son inclination naturelle à la polémique, Furet déclare que « la Révolution est terminée ». Dans son esprit cela signifie que les valeurs de 89 ne sont plus sujettes à débat dans la société française, ce qu’il explique par l’expression « la Révolution entre au port ». Avec ce positionnement et ce genre de propos l’entrée de Furet sur la scène du Bicentenaire ne pouvait qu’être tumultueuse.
Le Bicentenaire a été préparé par Jean-Noël Jeanneney (Mission du Bicentenaire) et Michel Vovelle (Commission de recherche historique). Furet siège au Comité exécutif de la Commission qui est dominée par des historiens « jacobino-marxistes » (Godechot, Agulhon, Mazauric…) mais associe également des historiens de droite (Jean Tulard, Jean Favier). Les relations avec Vovelle sont moins houleuses qu’avec Mazauric et Furet signifie qu’il ne voit aucun inconvénient à ce qu’il dirige la Commission tout en regrettant de n’avoir pu se mettre d’accord sur le sens à donner au Bicentenaire. Furet sera considéré par les observateurs comme le « vainqueur » du Bicentenaire. Il est vrai que Furet, habitué à l’exercice médiatique (télévision, radio, journaux), est omniprésent et occupe le devant de la scène. Au grand dam de certains, il devient « le spécialiste » de la Révolution. Cette omniprésence est toutefois savamment combinée avec une prise de distance vis-à-vis de la fièvre commémorative et l’historien se place au-dessus de la mêlée, choisissant la posture du « spectateur engagé » qu’il affectionne. De fait, Furet aurait souhaité un Bicentenaire plus scientifique, moins englué dans les normes de la commémoration et échappant à la récupération idéologique.
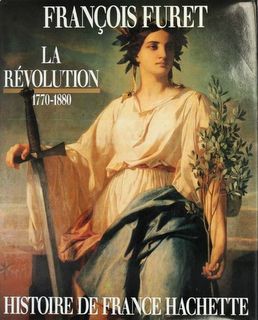
François Furet refuse ce qu’il considère être les paresses intellectuelles de la gauche. Ce faisant il prend le contre-pied de l’historiographie dominante, par exemple, en faisant voler en éclats la théorie des « circonstances » qui traditionnellement explique la Terreur. Le « Dictionnaire critique » de Furet-Ozouf présente également une historiographie très politique. Le terme « critique » est utilisé pour évacuer la dimension émotive, présente dans la pratique commémorative, et « refroidir » la relation à l’évènement. L’historien enfonce le clou de la provocation en opposant les historiens du XIXe siècle, « écrivains » talentueux, à ceux du XXe siècle, « professeurs » besogneux, fanatiques de l’érudition et aveuglés par l’idéologie. Il remet ainsi en cause l’histoire universitaire faite par la gauche intellectuelle dont il fustige la médiocrité conceptuelle. Il reproche également aux « universitaires » d’être prisonniers des faits et des archives comme un avocat des pièces de son dossier, de ne pas donner de dimension interprétative et philosophique. Les tenants d’une méthode historique classique, celle de l’accumulation et de l’exhaustivité, reprochent à Furet son manque de rigueur, sa légèreté et ses carences documentaires. A cela l’historien espiègle oppose, ce qui irrite, la nécessité de l’intuition et l’élégance du style même si ses propres archives montrent un réel travail documentaire. Son approche et son travail connaissent un réel succès lors du Bicentenaire car, en dépit de fortes critiques, la réception des deux ouvrages fait de Furet l’historien de référence de la Révolution.
Dans ces deux ouvrages Furet met beaucoup de lui-même et dévoile ses passions : l’histoire, la politique, la littérature, la philosophie. Son objectif est de livrer une analyse débarrassée du poids affectif et de la pression idéologique. Les historiens « jacobino-marxistes », ulcérés par l’omniprésence de Furet et le succès de ses thèses, lui reprochent de faire une histoire trop idéaliste et trop politique en méprisant les données socio-économiques. Furet est accusé de « révisionnisme » et de « centrisme » : il dirige l’Institut Raymond Aron et est l’auteur, avec Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, de « La République du centre. La fin de l’exception française » (1988). L’historiographie de la Révolution reste surchargée d’émotions politiques et Furet a l’outrecuidance de renvoyer la gauche à ses contradictions. Néanmoins, et en dépit de ce que certains détracteurs veulent faire croire, Furet ne développe pas une histoire réactionnaire. Il regarde vers Tocqueville ou Aron, non pas vers Taine ou Bainville. En témoignent, par exemple, ses prises de position quant à la guerre de Vendée : Furet récuse le terme de « génocide » véhiculé par une certaine historiographie. De fait Furet reste profondément admiratif de 1789, de sa modernité, de son libéralisme : « comme historien, et, comme citoyen j’ai le plus grand respect pour les hommes de la fin du XVIIIe siècle (…) ». Dans ces propos, une fois de plus, l’histoire côtoie la politique et c’est cette union que Christophe Prochasson éclaire dans la seconde partie de son ouvrage.
L’historien et la politique
De la « sortie » du communisme à la mélancolie
Durant sept années (1949-1956) F. Furet, quoique parfois critique, a été un fidèle militant et compagnon de route du PCF. Bercé par l’ « illusion » communiste, il est alors peu amène avec l’historiographie non-marxiste. Très engagé au sein du Parti, Furet va néanmoins suivre un parcours intellectuel et politique qui le conduit, comme de nombreux proches (Agulhon, Leroy Ladurie, Besançon…), à « sortir » du communisme et ce non sans douleur. L’historien fait le constat amer d’avoir été victime d’une illusion (thème qui sera celui de son dernier livre). Comme pour beaucoup d’intellectuels la rupture s’opère en 1956, date importante dans l’histoire du communisme européen (Budapest, XXe Congrès du PCUS et Rapport Khrouchtchev). Toutefois on ne se débarrasse pas si facilement de la « foi » communiste et la rupture profonde sera en réalité progressive (1956-1959). C’est une période fondamentale dans la construction de l’historien et du citoyen Furet. En effet, tout au long de sa vie il n’aura de cesse de réfléchir à son engagement et à son aveuglement. Son anticommunisme devient alors, en quelque sorte, son carburant intellectuel.
Une fois sortie du communisme une question se pose à la jeune génération : comment renouveler la gauche ? A savoir, donner naissance à une « nouvelle gauche » qui ne serait ni salie par les crimes du stalinisme (PCF) ni engluée dans les guerres coloniales (SFIO). Il s’agit donc de créer une gauche débarrassée des carcans idéologiques et non compromise par l’exercice du pouvoir. F. Furet s’inscrit alors dans l’aventure de cette « nouvelle gauche ». Dans les années 1954-1956, un pôle central de cette gauche est l’hebdomadaire « France Observateur » qui fonctionne comme un sas pour les communistes en rupture de ban et les sociaux-démocrates anticolonialistes. En 1958, avec l’appui du journal, est crée le Parti Socialiste Autonome (PSA) qui souhaite être un parti socialiste-communiste unitaire, ouvert à toutes les tendances de la gauche et pivot d’un mouvement ouvrier réunifié. Fusée mouillée, le PSA est remplacé par le Parti Socialiste Unifié (PSU) en 1960, toujours avec l’appui de « France Observateur ».
Le PSU et « France Observateur » accueillent les dissidents du PCF et de la SFIO et tout particulièrement les intellectuels dont l’indépendance d’esprit est toujours suspecte aux yeux des deux grands partis de gauche. De 1960 à 1964, F. Furet milite activement au sein du PSU où il est membre du comité directeur. Il est l’un des principaux chaînons reliant le PSU et « France Observateur ». Or, peu à peu, le militant Furet se démobilise, lassé et agacé par les luttes intestines d’un parti qui n’a rien d’unifié. Intellectuellement Furet ne juge plus le « jeu » stimulant… De fait l’historien reste un intellectuel pour qui la politique, aussi passionnante soit-elle, demeure un peu indigne. Pourtant il n’arrive pas à s’en affranchir totalement et chez lui l’histoire de la gauche, de la Révolution puis du communisme sont étroitement mêlées et son travail se révèle être souvent historico-politique, le tout reposant sur une réflexion générale sur la démocratie moderne (son passé, son présent, son devenir).
Il est vrai que l’historien vit et travaille dans une époque, le second XXe siècle, qui est une période cruciale dans l’histoire de la gauche marquée par sa puissance à la sortie de la guerre, la déliquescence puis la disparition du communisme soviétique, le retour du libéralisme et le déclin de l’ « Idée socialiste ». Furet, nous dit son biographe, s’est voulu l’analyste de ce moment et sa mélancolie s’y est d’ailleurs certainement complu. L’auteur du « Passé d’une illusion » a attaqué la gauche, sa famille, pour son impuissance à penser les changements en cours et sa complaisance envers un passé révolu : « La gauche se meurt de célébrer son passé au lieu d’y réfléchir ». Formule sans appel. Les relations entre Furet et la gauche, surtout à partir des années 1980, sont souvent tendues. Provocateur et perturbateur, l’historien met à mal les repères historiques de la gauche, déboulonne des statues et déroule une contre-histoire dans laquelle les évènements sacrés et intouchables ne le sont plus et où les grandes figures sont démythifiées.
F. Furet et la gauche au pouvoir
Furet entretient une relation compliquée avec une gauche au pouvoir qui perd ses repères idéologiques. Il constate que l’effondrement du communisme n’a pas touché uniquement le PCF mais également le PS qui ne profite guère de la faillite de l’idée communiste, étant lui-même, historiquement et pour partie, dépositaire de l’héritage marxiste. L’historien est très critique vis-à-vis des socialistes. A la fin des années 1950, lors de sa « sortie » du communisme il n’avait pu trouver refuge au sein d’une SFIO « mollétiste » et discréditée par la guerre d’Algérie. Dans les années 1980-1990, il reproche aux socialistes d’être passés rapidement d’une illusion révolutionnaire à un réalisme servile. Furet, qui observe la déroute idéologique de la gauche dans son ensemble, constate qu’elle est parvenue au pouvoir à un moment où son corpus idéologique devenait obsolète. La gauche trop arc-boutée sur son passé peine à proposer un avenir et Furet fait un réquisitoire sans indulgence de la gauche au pouvoir. Il n’est pas tendre avec François Mitterrand qu’il compare à Thiers. Si le premier septennat est, globalement, une déception, il perçoit le second comme une trahison. Il reconnaît toutefois que la période 1981-1986 a permis d’installer le socialisme français sur la scène sociale-démocrate européenne, au même titre que le Labour, le SPD ou la social-démocratie scandinave.
Cela étant Furet ne se prive pas de montrer une certaine férocité à l’égard des socialistes français et de Mitterrand dans un article intitulé « Chronique d’une décomposition » et repris dans « Penser le XXe siècle ». Pour lui les socialistes sont « devenus compétents en matière de gestion de l’économie capitaliste, et inexistants dans le domaine de la réflexion politique : le contraire de ce qu’ils croyaient être ». En réalité, Furet est préoccupé par l’essoufflement des passions politiques et cela entretient sa mélancolie. Il reste persuadé que la politique est faite de la combinaison de trois éléments essentiels : les intérêts, les idées et les passions. Il ne croit pas à la fin des utopies, des idéologies, ni à celle de l’histoire comme cela s’entend alors (notamment Francis Fukuyama, « La Fin de l’histoire et le dernier homme »). Furet, qui regrette la fin des passions politiques mais non les tragédies du XXe siècle, déclare : « Nous sommes tous un peu déprimés par le prosaïsme de notre vie politique mais ce serait tout de même trop triste de penser que les hommes ne peuvent se passionner que pour des utopies sanglantes ». Sans les passions, la démocratie est « désenchantée »… Mélancolique, il conserve néanmoins la passion de la politique.
L’analyste des passions
F. Furet est très sensible aux liens unissant les sentiments, les passions et les idées politiques et, de fait, il se fait historien des passions, la première de celle-ci étant la passion égalitaire, « passion mère de la démocratie moderne », d’où découle la passion révolutionnaire. De même la « passion nationale » a une position importante dans l’œuvre de Furet qui lui accorde un rôle déterminant dans l’explication de la Grande Guerre. Par ailleurs, Furet souligne la tension, voire la contradiction, qui préside au rapport entre liberté et égalité et entre égalité civile et inégalité sociale. L’égalité est le moteur essentiel de la démocratie et la passion pour celle-ci est inépuisable car son objet est, par définition, inaccessible. Il y a donc une distorsion entre égalité réelle et égalité formelle, pour reprendre une terminologie marxiste. Ainsi, les promesses d’égalité et de liberté, portées par la démocratie, exposent celle-ci à la surenchère démagogique et à la critique permanente. La passion égalitaire engendre la passion révolutionnaire qui repose sur la croyance de la toute-puissance du volontarisme politique et sur la nécessité de la « tabula rasa ». Cette passion révolutionnaire, invention de la Révolution, est la dynamique politique des XIXe et XXe siècles.
Furet se plonge ensuite dans l’histoire du communisme. Cependant, il ne prend pas part à la vague des « mémoires d’ex », à la différence d’Annie Kriegel, Leroy Ladurie ou Besançon. A une autobiographie de plus Furet préfère un essai de compréhension du phénomène communiste. Ce qui devait devenir « Le Passé d’une illusion » n’en est pas moins coloré par son expérience personnelle. Pour Furet la « sortie du communisme » fut une libération intellectuelle et il conçoit son ouvrage comme un « mea culpa » et surtout une tentative de favoriser les retrouvailles entre Europe de l’Ouest et de l’Est. Avant de constituer un ouvrage, les idées de Furet sur le communisme avaient pris la forme de textes pour des revues ou des journaux. « Le Passé d’une illusion » est un ouvrage qui a une double dimension : c’est une méditation historique et une invitation à penser le présent. De plus, il entend retracer « le parcours imaginaire de l’idée communiste dans les esprits du XXe siècle » et se veut « étude d’une représentation collective ».
Dans « Le Passé d’une illusion », Furet renverse un tabou en osant comparer le communisme avec le fascisme et le nazisme. Cette démarche fait de Furet, aux yeux de beaucoup, un homme de droite. Furet estime qu’il faut penser ces idéologies « ensemble » et qu’elles sont chacune des maladies de la démocratie moderne. Par ailleurs le dialogue entretenu par Furet avec Ernst Nolte, historien allemand très controversé, choque de nombreux historiens. Furet avoue vouloir combattre une historiographie trop marquée par l’antifascisme, en réalité l’instrumentalisation communiste du combat antifasciste. Il s’agit, une nouvelle fois, d’une provocation volontaire qui, en dépit du succès du livre, ne tarde pas à déclencher une polémique. Furet se place également dans le sillage de Zeev Sternhell qui trouve l’une des origines des « fascismes » dans le bouillonnement idéologique des années 1880 et en particulier dans la droite révolutionnaire qui va se développer après la Grande Guerre. Toutefois, Furet est très clair et se démarque de Nolte en soulignant qu’à ses yeux communisme et fascisme ne se valent pas et que les deux idéologies sont d’essence différente (« la première est universaliste, la seconde exalte le particulier »). Il souligne également la spécificité du nazisme qui réside dans son antisémitisme conduisant au génocide.
Aux yeux, enthousiastes, de Furet, l’effondrement du communisme permet le retour triomphal des idées de 1789 car « sur les ruines de ces tragédies survivent plus que jamais, au fondement de nos sociétés occidentales, les principes de 1789 (…) ». Enfin, et cela ne saurait étonner, en historien de la Révolution, Furet traque la filiation inventée en 1917. L’auteur de « Penser la Révolution française » estime que les deux évènements sont très différents même si l’on peut y déceler de nombreuses analogies, notamment le désir des Bolcheviks de s’inscrire dans la tradition démocratique née en 1789 et la volonté d’accomplir les promesses non tenues par celle-ci. Le livre connaît un succès retentissant, à la surprise de son auteur, et constitue un phénomène éditorial. Aussi, fort de ce succès, Furet multiplie les articles, les interviews et les conférences. Le contexte politique particulier du début des années 1990 explique non seulement l’écriture du livre mais aussi sa réception. Et, au vu des polémiques suscitées par le livre, une question se (re)-pose : Furet, historien de gauche ou de droite ?
Gauche ou droite ?
A cette question laissons répondre l’intéressé lui-même : « La gauche, c’est ma famille ». Cela a le mérite d’être clair. Pour autant cette affirmation n’est pas tenue pour vraie ou sincère par de nombreux historiens ou intellectuels de gauche. Il est vrai que la question est complexe et l’attitude souvent provocatrice de Furet comme certaines de ses relations ne facilitent pas la tâche. Si Furet, on l’a vu, ne regrette pas les utopies tragiques du XXe siècle, il constate, toujours mélancolique, que l’épuisement des utopies est celui des passions démocratiques. Le nouvel ordre libéral ne peut, selon lui, répondre aux attentes de l’homme démocratique. Dès lors, il ne se rallie pas à une famille politique, la droite, à laquelle rien ne le rattache et constate par ailleurs qu’il « règne à Paris une sorte d’arrogance de la pensée libérale qui me semble contradictoire avec l’esprit du libéralisme ». Si Furet peut être considéré comme un admirateur du libéralisme utopique, visiblement il n’en est rien quant au néolibéralisme. Il se tient à distance de la droite, redoutant une récupération de ses écrits (sur un plateau de télévision, Bernadette Chirac brandira le « Passé d’une illusion »). De plus, un certain détachement (dépit ?) politique est interprété à gauche comme une dérive conservatrice. Selon son biographe, son inclination à ne pas accepter les vérités communément admises a, de façon évidente, brouillé son image.
Furet ne comprend pas le discours visant à gommer le clivage gauche / droite : « La droite et la gauche ont à se définir en termes de belligérance contractuelle, et n’ont rien trouvé à substituer aux drapeaux éprouvés du libéralisme et du socialisme ». Néanmoins, il est vrai qu’à partir des années 1980, le théâtre d’ombres de la politique propose des controverses gauche / droite qui ne sont là que pour masquer l’acceptation commune de l’économie de marché. Comment opérer dès lors la distinction ? En dépit de cette réalité, Furet ne croit pas à la disparition de la gauche et de la droite. Par ailleurs il a des mots très durs pour le néolibéralisme triomphant qui engendre « l’hypertrophie des passions liées à l’argent », « l’individualisme égoïste généralisé », « un déficit d’esprit civique » ainsi que l’uniformisation et le conformisme. Furet ne cultive pas la nostalgie du passé mais considère l’avenir proposé par le libéralisme comme un miroir aux alouettes. On trouverait plus fervent défenseur de l’ordre néolibéral ! Ainsi, selon son biographe, aucune trace sérieuse d’un quelconque ralliement à la droite de la part de Furet n’est détectable.
Certes, on aurait pu s’attendre à une proximité avec la droite libérale mais ce serait oublier que le libéralisme de Furet relève plus d’un tempérament que d’une doctrine. Quant à la famille gaulliste elle ne peut être séduite par un historien clairement antigaulliste. En effet, pour Furet, de Gaulle représente une certaine idée de l’Etat et de la nation très éloignée de ses propres conceptions. Furet situe le gaullisme dans la lignée de la tradition plébiscitaire et bonapartiste, de surcroît teintée de maurrassisme. En outre la Ve République n’a pas les faveurs de Furet qui n’en supporte pas les institutions recèlant une contradiction entre la légitimité démocratique du pouvoir et son exercice de type monarchique. Pour Furet, la Ve République est une « monarchie républicaine ». La culture politique de Furet est faite de défiance envers l’Etat et de confiance en la société civile. Cette sensibilité le rapproche par conséquent de la Deuxième Gauche.
Or, s’il est vain de tenter de rapprocher Furet de la droite partisane, certaines de ses amitiés comme certains épisodes de son parcours soulèvent des questions. Ainsi de sa proximité intellectuelle avec Raymond Aron ou encore de sa collaboration avec Edgard Faure, ministre de l’Education après 68 pour lequel il prépare, avec Jean-Denis Bredin et Michel de Certeau, une grande loi d’orientation qui démocratise et libéralise l’Université. Furet fréquente donc des personnalités intellectuelles de droite et ce d’autant plus qu’il est un pestiféré pour nombre d’intellectuels de gauche. En réalité, Furet ajoute des amitiés de droite à ses fidélités de gauche. Cependant, dans les années 1980, il est accusé de conduire la gauche française à d’importants renoncements, de par sa lutte contre la sacralisation stérile du passé. Ces accusations se fondent essentiellement sur deux choses : la création de la Fondation Saint-Simon (1982) et la publication, avec Julliard et Rosanvallon, de « La République du centre » La Fondation a pour objectif, dans un contexte de déliquescence de l’idée communiste, voire socialiste, de refonder les bases doctrinales de la gauche. A ce titre elle fait se rencontrer, intellectuels, universitaires, chefs d’entreprise, hommes politiques et syndicalistes. La fondation, il est vrai financée par de grands groupes industriels (Saint-Gobain, Danone, Suez-Worms…), est perçue comme un groupe de pression. Dans un contexte de retour du libéralisme la Fondation livre toutefois des analyses très nuancées. La « Deuxième Gauche » et la mouvance de la revue « Esprit » y sont bien représentées et l’entourage de Michel Rocard et la CFDT sont sollicités. Furet et Rosanvallon, guidés par leurs références libérales (Tocqueville et Guizot), donnent à la Fondation une « idéologie » capacitaire (les élites intellectuelles, politiques et économiques de « bonne volonté »).
Enfin, dans « La République du centre », la critique ne se fait pas au nom de la droite mais au nom de la nécessité d’une nouvelle analyse face à un monde en changement que communistes et socialistes, englués dans leurs schèmes idéologiques, n’arrivent ni à interpréter ni à assimiler. La thèse de cet essai est la fin de l’idée révolutionnaire et des passions qui lui sont inhérentes et, partant, la fin d’une exception française. Une certaine conception de l a politique, particulière à la France, fait place à une politique de la gestion. L’opposition droite / gauche, et la guerre civile latente qu’elle suppose, s’essouffle en cette fin du XXe siècle et Furet, amer, constate : « La gauche a le goût des idées, c’est son honneur depuis deux siècles ; il faudrait qu’elle accepte d’en renouveler le stock ». Il résume là, en quelque sorte, le combat de sa vie. En effet, « persona non grata » dans sa propre famille, Furet a souligné que la gauche était, d’après lui, atteinte de psittacisme politique. Surtout il lui a reproché de ne plus partager sa volonté de « penser la démocratie ».
Tout au long de cet ouvrage, qui se présente en somme comme une monographie intellectuelle, Christophe Prochasson nous aura fait découvrir un François Furet dont il faut saisir la mélancolie pour comprendre l’œuvre. Cette mélancolie ne saurait être séparée des désillusions que porte la difficile histoire de l’émancipation. Personnalité quelque peu mystérieuse et très controversée, à qui l’on reprocha de cultiver avec délectation son statut atypique, François Furet s’amusa à brouiller les pistes, à provoquer et s’ingénia à créer la polémique. Historien au rayonnement international, journaliste complet, universitaire « hors les murs », homme de gauche rejeté par son camp, François Furet ne cesse d’interroger. Il laisse cependant une œuvre d’importance. Mais, qu’est-ce qu’une œuvre ? Question à laquelle l’historien répondait malicieusement : « Une question bien posée ». Avec un brin de mélancolie, « maladie de l’idéal » selon Freud…