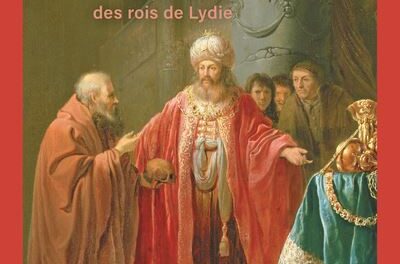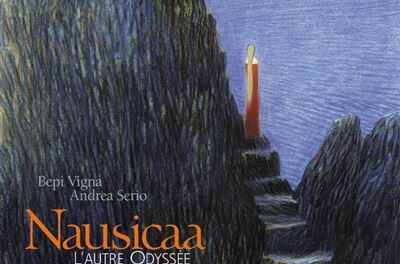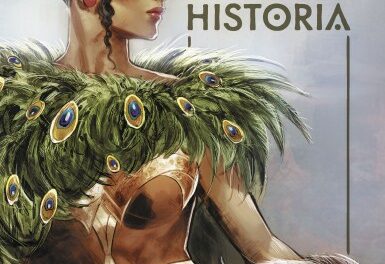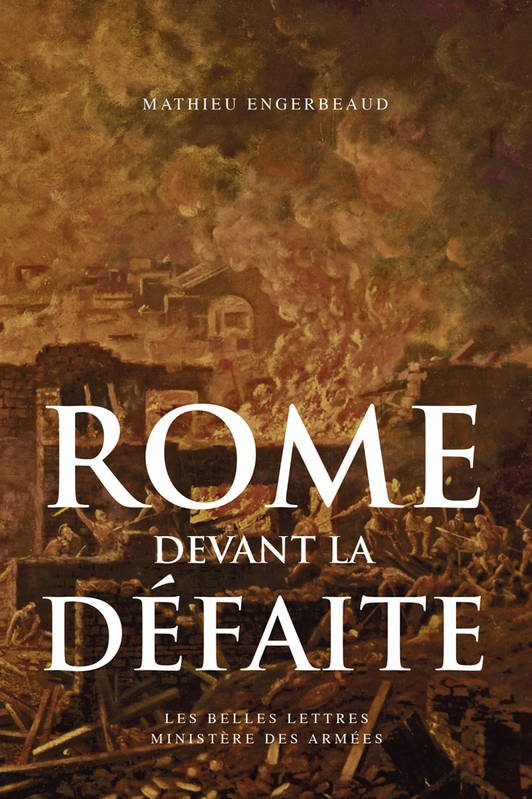
L’auteur évoque ensuite l’émergence d’un champ de la défaite dans l’historiographie, à la fois conjecturel ( L’étrange défaite de Marc Bloch en 1940, puis un écho de la crise de 2008 et d’un besoin de comprendre l’effondrement). En Histoire ancienne, une étude d’E. Levy (Levy E. Athènes devant la défaite de 404. Histoire d’une crise idéologique, Paris, 1976) met ce champ de la défaite au goût du jour. Pour l’histoire romaine, l’ouvrage fondateur de N.S. Rosenstein Imperatores victi (1990) inaugure une approche analysant l’impact de la défaite sur les carrières des généraux qui aura une influence méthodologique forte sur les travaux ultérieurs, qui se positionnent dans sa continuité où en contre-point. L’étude de M. Engerbeaud cherche dès lors à dépasser cette référence en plusieurs points dont : l’intérêt porté aux siècles archaïques de l’Histoire de Rome, jusqu’ici peu évoqués, la valorisation d’une multiplicité des points de vue dans les sources là où Tite-Live dominait et enfin le remaniement de l’appareillage conceptuel pour éviter les anachronismes. L’exemple donné par l’auteur est celui du terme de « défaite », qui n’apparaît dans les chroniques médiévales sous un sens militaire qu’au XVe siècle et qui recoupe en latin un lexique très varié (contrairement à la victoire, qui fait l’objet d’un lexique « univoque » : victor, vincere, la déesse Victoria).
Identifier les revers militaires du conquérant
Après cette introduction méthodologique, l’auteur aborde une première partie de son étude, qui apporte une première identification des défaites sur la période concernée. Les sources demeurent ainsi le problème principal. En effet, de prime abord, l’espace public républicain est occupé par une « autocélébration des élites romaines » d’où la défaite est absente. Pour la période royale et primo-républicaine, l’historien est dépendant des historiens grecs ou romains (principalement Tite-Live, extrêmement disert sur les événements des périodes sus-citées) et du nécessaire croisement entre eux. Toutefois, des exempla archéologiques, parmi lesquels la tombe François de Vulci (IIIe siècle av. J.C), éclairent ces sources sous un jour nouveau, si interprétés avec prudence. De plus, il convient de traquer l’information jusque dans les angles morts de ces sources : M. Engerbeaud rappelle ainsi que l’identification de certaines défaites est évidentes, mais que bien d’autres sont masquées ou passées sous silence, il faudrait alors identifier la « défaite invisible » au milieu des « traces de guerre », telles que des bornes frontières, traces de fortifications laissant voir une péninsule italienne archaïque livrée à d’importantes oppositions.
L’auteur rappelle ensuite la tendance de la propagande royale grecque puis républicaine et impériale romaine à amplifier le rôle du souverain ou du général victorieux («nikatôr »/ « victor »). Ainsi, Auguste, dans ses Res Gestae se vante d’avoir pacifié la Germanie malgré la défaite de Varus. La mise en scène de la défaite se fait essentiellement dans la tradition littéraire bien plus complexe et propre aux Grecs et aux Romains pour l’Antiquité. Sur ce phénomène en particulier, les sciences sociales apportent des éléments constructifs. M. Engerbeaud prend ainsi comme point de comparaison la société malgache, avec le sac d’un village révolté en 1947 : le souvenir de la défaite est mythifié, fait l’objet de « faux souvenirs » et de multiples versions coexistantes qui servent de « leçons » pour des précautions futures à prendre par la communauté. Il aurait pu en être ainsi, selon l’auteur, du sac de Rome par les Gaulois en -390.
De même, il faut s’interroger sur les sources des auteurs, qui se seraient basés sur des Annales officielles républicaines, non seulement disparues mais qui faisaient elle-mêmes, comme discours officiel, état d’une réécriture importante. Précisant ensuite ses propos introductifs sur la version de Tite-Live, qui est devenue une vulgate ayant, certes incomplètement, lissé les incohérences des sources antérieures, M. Engerbeaud explique ensuite l’intérêt d’exploiter en profondeur des auteurs grecs tels que Diodore de Sicile, Denys d’Halicarnasse, ainsi que les fragments parvenus par la tradition encyclopédique byzantine des VIIIe-IXe siècles.
Les sources anciennes donnent un vocabulaire latin particulier, plus complet que notre simple « défaite », auquel on peut ajouter un vocabulaire grec, pour ce phénomène. De plus, le concept moderne de défaite diffère d’un concept antique de l’échec.
Le latin des sources littéraires n’a pas d’antonyme militaire à vincere (vaincre). Même si dans d’autres circonstances, le latin utilise les verbes perdere et amittere, ces verbes sont absents chez Tite-Live, sauf en une occurrence pour perdere, ou il désigne une défaite samnite en -321.. Pour revenir au latin, les défaites sont souvent désignées par des substantifs détournés tels qu’indignitas ou infamia ou des syntagmes comme adversa pugna ou infelix bellum et évidemment le célèbre vae victis, mis dans la bouche du chef gaulois Brennus percevant le lourd tribut des Romains défaits en -390. Il est intéressant de constater que pour les défaites des guerres Puniques, en particulier contre Hannibal à la fin du IIIe siècle avant J.C, le vocabulaire est très factuel et se rapporte au désastre et au carnage (clades ou caedes) sans tâche d’infâmie, Hannibal étant considéré comme un adversaire digne de la force romaine et les défaites contre lui ayant été des nécessités, « des épreuves et des étapes dans la construction de l’hégémonie romaine »
Plus abstrait, le grec donne principalement le verbe essaô (être inférieur), employé à sa forme passive lorsqu’Appien parle de la défaite des Fourches caudines contre ces mêmes Samnites.
En bref, la défaite est évoquée de manière extrêmement polysémique en grec et en latin, de manière tant factuelle que morale. De plus, le lexique n’est pas le même selon qu’on parle de défaite des Romains et des ennemis de Rome. Ainsi, Tite-Live présente les défaites des peuples Italiens contre Rome comme des faits habituels, rattachés comme caractéristiques à ces peuples, évoquant ainsi des caesi Etrusci ou des devicti Sabini, respectivement pour les Étrusques et les Sabins. Denys d’Halicarnasse en fait de même en grec, ne rattachant jamais l’ethnonyme romain au concept de défaite.
Passant à une définition plus militaire, M. Engerbeaud rappelle que les seules défaites ou victoires militaires en bataille rangée ne forment pas l’ensemble du champ lexical étudié. D’autres configurations comme le siège, le coup de main réussi, le conflit dans la durée sont concernés. Des questions se posent ainsi : la défaite des alliés latins de Rome ou la reprise d’une place forte tenue par des garnisons romaines sont-elles réellement des défaites ? Chez Tite-Live, la première question demeure incertaine, dans la mesure où l’on connaît mal les équilibres de pouvoir dans les premières alliances entre cités latines, mais la seconde question est claire : le terme « clades » est utilisé pour une reprise de ville par les ennemis de Rome et les événements liés aux sièges (reprise mais aussi abandon d’un siège infructueux) composent 40% des défaites archaïques que M. Engerbaud recense chez Tite-Live. Paradoxalement, le pillage du territoire romain par l’ennemi n’est pas considéré comme une défaite, ce qui souligne les différences entre conceptions belliqueuses antiques et modernes (l’auteur de ce compte-rendu rappelle à cet égard le statut flou de la piraterie dans la Grèce archaïque, alors considérée comme une entreprise rentable, presque commerciale parmi d’autres, comme le veut l’étymologie du verbe peirateuo, courir sa chance).
Pour cette étude, les défaites rythment la conquête de l’Italie tout autant que les victoires. Les rois chez Tite-Live ne sont quasiment jamais vaincus et même les échecs comme la levée du siège de Gabies par Tarquin le superbe sont relativisés ou deviennent prétexte à valorisation, comme lorsque Romulus accepte le Sabin Titus Tatius comme co-roi. On peut toutefois les discuter à la lumière d’autres documents. Ainsi, ce même Tarquin le superbe a contre lui des sources d’interprétations compliquée mais évocatrice. M. Engerbeaud soumet à examen les fresques étrusques de la tombe François à Vulci (IVe siècle avant JC). Ces fresques représentent en effet des vainqueurs aux noms étrusques (dont les frères « Caile Vipinna » et « Avle Vipinna ») à des vaincus parmi lesquels on compte un « Cneves TerXunies RumaX », transcription étrusque de « Cnaeus Tarquin le Romain ».
Les premières défaites marquées apparaissent sous les premières décennies de la République, au début du Ve siècle avant J.C contre la cité étrusque immédiatement voisine de Véies. Elles sont vues comme des étapes menant à des traités de paix plus favorables. Dans les décennies suivantes, les défaites se font contre les Èques et les Volsques, peuples italiques voisins du Latium, qui sont alors présentés comme des antithèses des Romains, pillards, grossiers et provocateurs. Tite-Live peut être ici soupçonné de reconstruire les événements pour expliquer comment des ennemis ensuite inoffensifs et soumis retiennent l’expansion romaine pendant plus d’un siècle. Les défaites contre les Celtes, dont le siège de la cité en -390 fait consensus chez les auteurs autour de trois temps distincts, une défaite militaire identifiée à postériori comme celle de l’Allia, la prise de la ville et l’intervention « providentielle » de Camille, qui empêche le paiement du tribut du Vae Victis. À la reprise du conflit contre les Étrusques au milieu du Ve siècle avant J.C, Tite-Live décrit des événements particulièrement sanglants contre Tarquinia et Faléries. La suite des guerres samnites au siècle suivant mène à la terrible défaite des Fourches Caudines en -321, à l’issue de laquelle les Romains vaincus auraient du passer sous les armes croisées des Samnites de C. Pontius. Ici, la réécriture à posteriori concerne surtout la Pax Caudina, traité imposé par les Samnites dont la tradition ultérieure aurait peut être minimisé les clauses. Les années suivantes menant au début du IIIe siècle avant J.C et à la guerre contre Pyrrhus d’Epire permettent à M. Engerbeaud de rappeller que la version de Denys d’Halicarnasse lui paraît bien plus crédible, le Grec évoquant un statu-quo, là où la tradition romaine a voulu voir une victoire « à la Pyrrhus » mais significative pour Rome. Tous ces événements donnent à voir une construction systématique et idéologique de la défaite, comme transition avant les victoires, épreuves formatrices qui mènent chez les auteurs romains, un Grec comme Denys étant plus nuancé, à l’inévitable expansion péninsulaire.
Les récits des défaites romaines : réappropriations collectives et traditions divergentes
Par ces deux angles, celui des « réappropriations collectives » de la défaite la transformant et des « traditions divergentes », qu’elles proviennent d’autres auteurs classiques où au contraire de sources archéologiques, M. Engerbeaud reprend les éléments qu’il a présenté de manière événementielle dans le chapitre précédent.
Le premier procédé qu’il évoque est « l’attribution abusive de la victoire », ) des événements rien moins que certains comme la victoire de la jeune république en -509 contre la coalition étrusque, due au fait qu’il n’y ait eu qu’un mort de plus du côté des coalisés. L’étude parle ensuite de « mécanismes rhétoriques d’atténuations de la défaite », développant ce qui a déjà été vu dans l’introduction sur le vocabulaire, parfois jusqu’à la pure négation de cette défaite. Un exemple est celui du siège mis par Coriolan, renégat exilé de Rome suite à des tensions politique et devenu général des Volsques en -491. Il aurait assiégé Rome sans faire face aux troupes romaines : on voit ici que le récit est remanié pour éviter de mettre face à face deux généraux romains aux temps fragiles du début de la République. L’absence de capitulation formelle devant les Gaulois en -390 est également mise en avant par les sources d’une manière rien moins que fallacieuse. L’invocation de causes supérieures, telle que la fortuna divine ou la force supérieur de l’ennemi, comme c’est le cas du général étrusque Larth Porsenna, qui soutient le dernier roi Tarquin exilé, font également partie des procédés rhétoriques. La réécriture globale soude ensemble le corps des magistrats et des citoyens. Du point de vue d’auteurs de la fin de la République et du début de l’empire, elle est aussi utilisée pour donner une image de la cité archaïque idéale, si besoin modèle de référence.
Rome après la défaite : surmonter la crise militaire et politique
La défaite questionne également un point crucial pour M. Engerbeaud au delà de sa réécriture : comment contribue-t-elle à souder le corps civique, par une volonté de « maintenir la posture de victoire par delà la défaite ». L’étude introduit d’abord en retournant la vision, évoquant la manière dont les ennemis de Rome. Une realia unique est un ex-voto à Zeus retrouvé dans le sanctuaire de Dodone et consacré par Pyrrhus, qui revendique la victoire contre les Romains. En Italie, on trouve également des dépôts de « dépouilles opimes » avec des armes de différentes époques, dont plusieurs romaines, montrant la consécration de victoires par des peuples italiques contre Rome. Dans les sources, l’ennemi est souvent montré comme faisant preuve d’un mépris accompli dans la victoire, le Vae Victis du gaulois Brennus en -390 en est un exemple, comme celui du chef èque Coelius Gracchus qui engage en -458 les ambassadeurs romains venus négocier la paix de présenter leurs griefs à un arbre qu’il désignait.
Une autre source d’importance est la célèbre tombe François. La première lecture serait de dire qu’il s’agit d’une autocélébration d’un noble étrusque, Vel Saties, à qui appartenait la tombe, peut-être chef militaire d’une des dernières cités étrusques indépendantes liguées contre Rome. Toutefois, comment les interpréter suivant la perspective d’autres artefacts antérieurs, et surtout de la tradition historique romaine ? Ainsi, on peut la voir en regard avec une inscription du Ier siècle après J.-C, évoquée dans la deuxième partie de cette étude. Retrouvée à Tarquinia, ces Elogia tarquiniensia vantent les actions de l’Étrusque Aulus Spurinna, qui aurait pris des oppida latins, sûrement sous contrôle romain, même si le texte ne le mentionne pas. Pour l’auteur, une question se pose alors : dans quels mesure les événements représentés ont-ils un écho de l’histoire de la fin de la période royale (VI e siècle avant J.C) ? En effet, les frères Vipinna/Vibenna sont mentionnés chez Tite-Live, tout comme le personnage « Macstarna » serait peut-être Servius Tullius dans la Table Claudienne (on sait de même que l’empereur Claude avait composé une Histoire des Étrusques, perdue). En revanche, on ne connait aucun Cneves/Cnaeus parmi la famille d’origine étrusque des Tarquins, qui régna sur Rome juste avant la proclamation de la République.
Revenant ensuite à une analyse plus factuelle, l’étude s’intéresse à nouveau à l’attitude des vainqueurs puis, en cas d’échec, au comportement des soldats romains. La défaite par excellence est ici celles des Fourches caudines, où le camp est soumis à la désolation, luctus, lorsque l’humiliant traité signé avec le samnite Pontius est connu des soldats. En cas de défaite, les alliés peuvent également déserter, provoquant des retournements de figures dans les sources : Capoue, présentée comme l’allié fidèle et compatissant en -321, juste après les Fourches Caudines, est « l’archétype du traître » en -216, lorsqu’Hannibal y pénètre et jouit des « délices » consacrés par la formule.
Enfin, la défaite peut frapper de mauvais augure des endroits, comme la porte ouest de la muraille servienne et des jours comme le Dies Alliensis (défaite contre les Gaulois ayant engendré le sac et le siège du capitole en -390).
La défaite, un des fondements de la supériorité de Rome sur le monde antique ?
Les historiens grecs comme Polybe, qui a connu Rome de près pour y avoir vécu comme otage dans le cercle patricien des Scipii Aemilii, ou encore Denys d’Halicarnasse, voient l’empire romain comme un unicum. Même dans la défaite, Rome apprend et s’adapte. Ce point de vue est évidemment pleinement souscrit par les auteurs romains, Tite-Live le premier, celui-ci mettant en scène un fatum du dépassement de l’échec, parfois traumatisant, mais surtout porteur de leçons.
Un exemple de leçon est l’emprunt à l’ennemi pour le vaincre. L’apprentissage de la phalange hoplitique auprès des Étrusques aux VIe-Ve siècles avant J.C puis d’adoption de la tactique manipulaire auprès des voisins italiques, ou encore de la navigation auprès des Carthaginions marqueraient autant cette mutation adaptative de l’armée romaine que l’acquisition symbolique du bouclier scutum auprès des Samnites et du glaive d’estoc espagnol.
De même, les institutions auraient su s’adapter face aux situations d’urgence : ainsi, la dictature, magistrature suprême exceptionnelle, est un recours fréquent en cas de crise (59 dictateurs entre -509 et la première guerre punique, tous victorieux). De même, les procès des généraux vaincus sont systématiquement orchestrés par les tribuns de la plèbe, institution de contre-pouvoir stabilisée au début du Ve siècle avant J.C. Cette stabilité de l’adaptation institutionelle relève toutefois en partie d’une réécriture augustéenne, qui veut inscrire son pouvoir dans la continuité républicaine, tout comme la conservation d’une perpétuelle volonté romaine de vaincre. Dans cette même perspective, des défaites légendaires (la chute de Troie, ancêtre de Rome, dans l’Énéide) ou idéologisées (les « victoires à la Pyrrhus ») sont des fabrications idéologiques.
Intégrer les défaites archaïques a l’histoire romaine
Concluant par transition une analyse plurielle et complète, M. Engerbeaud met ici son travail dans une perspective plus globale, celle d’une intégration pleine et entière des défaites archaïques dans la construction de l’histoire et de l’identité de Rome dès la République.
Pour cette étude, les défaites entre Romulus (milieu VIIIe siècle av. J.-C.) et les decemvirs (milieu Ve siècle av. J.-C.) sont des défaites « étiologiques » ayant pour but d’expliquer l’origine d’autres événements. Ainsi, la contre-attaque victorieuse suivant une défaite contre les Sabins de P. Postumus en -503 est prélude à l’établissement du rituel de l’ovation, liée à la symbolique du triomphe. De même, la défaite de la Crémère en -477 doit expliquer le sacrifice des 306 Fabii livrant une guerre privée à Véie. Un clin d’oeil à une construction gentilice de la mémoire est possible lorsqu’on sait que Fabius Pictor, qui écrit une histoire de Rome en grec quelques siècles plus tard, voulait à l’origine la faire se dérouler en -480 et coïncider avec le sacrifice spartiate des Thermopyles.
De même, la défaite sert également à l’historiographie à favoriser l’émergence de figures de sauveurs, comme l’iconique Cincinnatus, appellé à la dictature en -458 et mettant fin en seize jours à la guerre contre les Èques. Un autre dictateur, M. Furius Camillus est ainsi à l’origine de la prise de la vieille ennemie étrusque, la cité de Veies, en -396. Le siège est ironiquement réécrit pour rappeler le siège de Troie, ayant duré dix ans comme lui.
La défaite peut aussi être un casus belli telle que celle de la guerre sous Romulus avec Albe, causée par la capture de Rémus dans une embuscade. La défaite navale contre Tarente en -282 est ainsi l’origine de la guerre avec cette cité et par là de l’intervention de Pyrrhus.
Entre l’époque décemvirale et les lois licino-sextiennes qui stabilisent le partage du consulat et les institutions romaines en -367, la défaite fait objet d’exempla pour critiquer la division du corps civique romain où encore les effets d’un mauvais gouvernement, telle la gestion désastreuse par les tribuns militaires du premier siège de Véies en -402, qui mène à l’appel à Furius Camillus précédemment évoqué. De manière plus littéraire, l’évocation de la défaite est un procédé littéraire pour « établir un climat d’incertitude » qu’on ne peut vaincre qu’avec disciplina.
De semblables divergences de lecture touchent la Tombe François doit il a été précédemment question. Revenant enfin à Tite-Live, dont il a bien démontré la nécessité de le soumettre plus spécialement à la critique et au croisement, M. Engerbeaud parle même d’une « fabrique livienne» des désastres, qu’on aperçoit particulièrement au prisme de deux événements : le sac de l’urbs par les Gaulois en -390 et la défaite des Fourches Caudines contre les Samnites. Chez Diodore, la guerre samnite se déroule sans Fourches Caudines. Chez Tite-Live, les Romains se rendent au contraire sans combats, ce qui justifie l’humiliation de la Pax Caudina.
L’étude s’achève ici en recommandant une salutaire pluralité des sources et un recul sur la « fabrique livienne » de la défaite. En effet, si Tite-Live demeure en termes de contenu la source première, le recul est rendu nécessaire par un décryptage poussé des mécanismes historiographique derrière son écriture. La fabrication livienne se voit par exemple dans la facture stéréotypée des interventions de membres illustres de la gens Postumia entre -503 et -216. Presque chaque fois (on saluera le tableau synthétique des occurrences p. 448, un procédé méthodique qui connaît une certaine fortune chez les Antiquisants depuis les années 1990), le général concerné conduit la guerre avec imprudence, tombe dans un piège, est parfois contraint à la paix, souvent se repent d’avoir entraîné Rome dans une défaite, redouble de patriotisme et est vengé par un autre général romain providentiel. La défaite de chaque Postumus se voit ainsi ritualisée, ayant ses rythmes propres, et devient pratiquement un topos historique et littéraire.
Ces propos concluent une étude riche et fournie, dans laquelle M. Engerbeaud a prouvé la possibilité et la nécessité de croiser et de critiquer des sources mais aussi toutes les interprétations possibles et l’appareillage conceptuel d’une histoire archaïque qu’on reléguait jusqu’ici dans l’incertitude ou dans le positivisme, plus complexe qu’il n’y paraît comme il l’a montré, de la « fabrique livienne » que l’auteur espère continuer, dans un travail ultérieur, son approche des défaites suite aux Guerres Puniques, une période prometteuse où l’événementiel est encore mieux connu et gagne en densité.