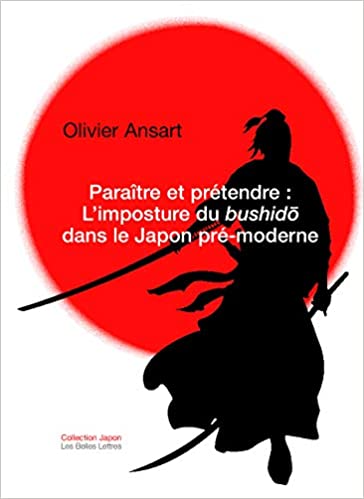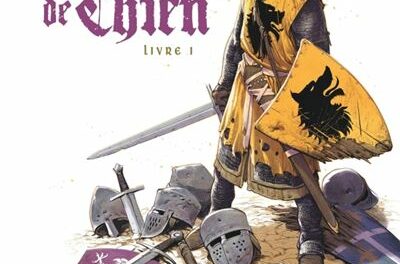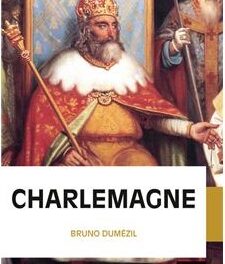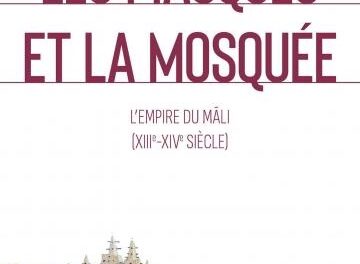Olivier Ansart, éminent spécialiste de l’histoire culturelle et intellectuelle du Japon pré-moderne, signe un livre relativement court mais d’une grande richesse tout entier consacré au discours exaltant la « voie des guerriers » (le bushidô) à l’époque des Tokugawa (1603-1868). Il s’agit en effet de saisir la « voie des guerriers » dans sa dimension normative, c’est-à-dire le discours issu des traités de conduite, des règlements et autres exhortations qui précisaient comment les guerriers (bushi) devaient se comporter en tant que vrais guerriers. Dès le début, l’auteur nous donne un aperçu cinglant de ce qu’il entend démontrer :
« Ces guerriers qui n’en étaient plus, mais ne pouvaient le faire voir, devinrent des serviteurs qui, sous le masque de la loyauté, complotaient contre leurs maîtres, des truqueurs sans vergogne de généalogies honorifiques, des tricheurs et menteurs en série, des amateurs de confort douillet qui brandissaient des armes qui n’étaient plus que des symboles vides. » (p. 13)
Le bushidô, une comédie
En bref : « La ‘voie des guerriers’ n’a jamais été qu’une comédie, […] le produit et le conduit d’illusions et de malentendus, autant que de manipulations. » (p. 16) La démonstration, parfois ardue, de ce constat est rondement menée.
Au prétexte que le terme de bushidô n’aurait guère été employé avant l’ère Meiji (1868-1912), de nombreux chercheurs ont avancé la thèse selon laquelle la « voie des guerriers » serait une création de cette époque, soit une « tradition inventée » (E. Hobsbawm). Olivier Ansart montre qu’il n’en est rien. Bushidô : même s’il n’est pas le seul à désigner la « voie des guerriers », ce terme est couramment utilisé sous les Tokugawa. Et l’auteur de poursuivre son exploration jusqu’à l’époque médiévale (XIIè-XVIè s.) pour repérer les premiers linéaments d’un discours sur une « voie des armes » entendue comme seule « activité militaire des guerriers », qu’on l’appelle, entre autres, « voie des hommes de guerre » (tsuwamono no michi) ou « voie de l’arc et des flèches » (kyûsen no michi).
La généalogie de ce groupe guerrier
Ce groupe des guerriers, qu’on connaît sous le terme de bushi, apparaît à l’époque de Heian (VIIIè-XIIè s.). Vouées initialement à la protection et à l’agrandissement de terres et de propriétés privées, ces bandes privées (bushidan) en viennent à accaparer le pouvoir politique : la réalité du pouvoir est alors le fait de gouvernements militaires, qualifiés de bakufu Littéralement « le gouvernement derrière la tenture », ce terme renvoie aux divers régimes militaires japonais, dont celui des Tokugawa., dominés par un shôgun Le chef des seigneurs de guerre de la coalition gagnante. confirmé par l’empereur du Japon résidant à Kyôto.
Au Moyen Âge, on peut schématiquement distinguer trois strates au sein du groupe des guerriers : les guerriers indépendants en mesure de mener des actions militaires (dont les plus puissants d’entre eux sont les seigneurs de guerre, dits taishô ou daimyô) ; d’eux dépend la catégorie des cavaliers qu’on qualifie bientôt de samouraïs Contrairement à l’auteur qui utilise la graphie « samurai », nous conservons « samouraï », comme le fait Pierre-François Souyri dans son remarquable ouvrage Les guerriers dans la rizière. La grande épopée des samouraïs, Paris,Flammarion, 2017, 385 p. (qui dérive du terme saburau signifiant « servir ») ; enfin, des gens du commun, pour l’essentiel des paysans mobilisés pour le combat quand c’est nécessaire. Retenons que ces guerriers forment alors « un groupe ouvert, où les promotions sociales et politiques [sont] toujours possibles » (p. 37), ce qui n’est plus le cas à partir des Tokugawa.
Deux valeurs structurent les premiers discours sur la « voie des guerriers » : la valeur martiale (faite de loyauté et de courage), qu’exigent de leurs subordonnés les seigneurs de guerre, et l’honneur (ou réputation), préoccupation centrale des guerriers (autrement dit ici des samouraïs). Car c’est bien à ces derniers que s’adresse principalement le discours sur la « voie des guerriers ». En effet, aucune loyauté absolue n’est attendue des seigneurs de guerre qui peuvent donc trahir sans que cela n’entraîne de conséquences néfastes pour eux. Si la loyauté martiale et l’honneur sont respectés et mis en œuvre, c’est que les guerriers en attendent une récompense, procurée par le seigneur.
Une identité redéfinie sous le shogunat
Le nouveau pouvoir shogunal qui s’installe au début du XVIIè siècle soumet les seigneurs de guerre et instaure une longue de période de paix, ce qui contribue à remodeler l’identité des guerriers, qui faute de guerre, n’en sont plus vraiment… Tokugawa Ieyasu Fondateur de la longue lignée des Tokugawa, il est shôgun de 1603 à sa mort en 1616. poursuit, pour la consolider, la politique de Toyotomi Hideyoshi Considéré comme le Second Unificateur, il dirige le pays de 1582 à 1598. visant à séparer les guerriers du reste de la population (il n’est dès lors plus question qu’un paysan soit mobilisé le temps d’une campagne militaire). On estime que le groupe des guerriers et de leurs familles forme alors environ 7% de la population japonaise.
La population de statut guerrier peut même atteindre 20% localement, comme c’est le cas du fief de Shimazu dans le Sud. L’auteur, dans des pages d’une grande richesse, met en lumière la diversité et la complexité de ce groupe des guerriers, tant en termes de pouvoirs, de richesse que de statuts. Mais ces guerriers voient, dans leur grande majorité, leur situation économique et politique se dégrader sous les Tokugawa : leur pouvoir d’achat se réduit et, dans ce contexte de paix, ils ne trouvent pas tous à s’employer. L’administration shogunale n’est en effet pas en mesure d’absorber les nombreux guerriers désormais privés de champs où déployer leur énergie combattante. Bon nombre deviennent des bureaucrates salariés, employés dans divers secteurs de l’administration (collecte d’impôts, police, justice, travaux publics, etc.). Dès lors, les liens émotionnels forts qui pouvaient exister entre le seigneur et ses guerriers en temps de guerre disparaissent et à la loyauté se substitue l’obéissance.
Sous les Tokugawa, les acteurs « naissaient dans la position subordonnée précise qu’avaient occupée leurs ancêtres, sans espoir d’en sortir, sans possibilité d’agrandir leur pouvoir et leur patrimoine, sans aucune chance de changer de seigneur. […] Pour l’énorme majorité, leur place dans l’appareil bureaucratique était scellée pour la vie. Comment dans ces conditions auraient-ils pu ‘trahir’ leur maître ? Mais si la trahison était impossible, comment la loyauté pouvait-elle encore signifier quoi que ce soit ? À la place de la loyauté, on voit donc apparaître cette vertu typiquement bureaucratique qu’est l’obéissance, mais donc aussi, dès lors que les circonstances s’y prêtent et que l’intérêt le demande, ses contraires, la désobéissance et la résistance. » (p. 128)
Dès lors que le guerrier sous les Tokugawa a fondamentalement perdu sa raison d’être, comment comprendre les notions de loyauté (martiale) et d’honneur toujours mis en exergue dans les discours sur « la voie des guerriers » ? Pour certains auteurs, comme celui de Hagakure Titre abrégé de Hagakure Kikigaki, « Notes entendues à l’ombre des feuilles ». C’est une oeuvre majeure de la littérature exaltant la « voie des guerriers », dictée au début du XVIIIè siècle à un certain Tashiro Tsuramoto (1678-1748) par un guerrier à la retraite de l’île de Kyûshû, Yamamoto Tsunetomo (1659-1719)., œuvre complexe qu’Olivier Ansart réinterprète magistralement à l’aune de la crise de l’identité guerrière consécutive à la Pax Tokugawa, la loyauté signifie une obéissance absolue et inconditionnelle.
Au contraire, pour Ogyû Sorai (1666-1728) Olivier Ansart a consacré à cet auteur un livre érudit : L’empire du rite. La pensée politique d’Ogyû Sorai : Japon, 1666-1728, Droz, 2009., figure de proue d’un courant de pensée hostile à la « voie des guerriers » (la notion de bushidô étant, selon lui, une ‘mauvaise chose héritée des guerres civiles’), les guerriers doivent abandonner « leur identité proclamée de guerriers » et reconnaître « leur statut de fonctionnaires civils » (p. 90). Ogyû Sorai demande donc une réinterprétation radicale de la loyauté : conscient que le guerrier de son époque n’a plus rien à voir avec celui d’avant 1603, sa loyauté ne peut s’approcher que de « la conscience professionnelle. » (p 84) Comme ces critiques restent toutefois confinés dans les cercles intellectuels, ni la culture ni les autoreprésentations des guerriers ne sont modifiées : le guerrier doit servir son maître au risque de sa vie. Car, pour l’auteur de Hagakure : ‘La voie du guerrier se trouve dans la mort’, et sous la forme la plus douloureuse qui soit : le rituel de l’éventrement (seppuku).
« L’éventrement prouvait finalement l’existence sous la Pax Tokugawa […] des guerriers comme personnes identifiées par la loyauté et l’honneur. L’éventrement fournissait en effet à son auteur et victime la seule occasion possible de démontrer loyauté et honneur dans le sens ancien, même si leur démonstration l’envoyait dans le néant. C’était la seule occasion de manifester le courage martial, même si la seule victime était son auteur même, puisque, par une curieuse mais très raisonnable ironie, le seul exercice légitime de la violence sous les Tokugawa était celui qui la tournait vers son auteur. Et l’éventrement prouvait bien sûr la loyauté du guerrier qui semblait s’exécuter sur un simple mot de son maître. » (pp. 154-155)
Toutefois, tout cela relève du registre des apparences car l’éventrement est souvent mimé : le « courageux » guerrier est armé d’une dague, plus souvent d’un petit couteau en bois inoffensif; quand il s’apprête à se saisir de l’instrument destiné au suicide, l’assistant (kaishaku) qui se tient derrière lui sait qu’il n’a plus qu’à lui trancher le cou avec son sabre… Un registre des apparences qui s’étend à tout ce qui fait l’identité visible du guerrier, à commencer par le(s) sabre(s). Alors que les armes à feu sont d’une efficacité bien supérieure au sabre, elles sont, paradoxalement, marginalisées. Le sabre reste attaché à ce qui fait la fonction guerrière dans le Japon pré-moderne. C’est l’une des marques et des symboles du statut du guerrier. Se développe d’ailleurs sous les Tokugawa une pratique, esthétisante, aujourd’hui appelée iaidô : le maniement du sabre sans adversaire de façon à répliquer des mouvements propres à des situations de combat.
Des guerriers sans combats, attachés à la réputation et aux apparences
Sous les Tokugakawa, loyauté et honneur restent valorisés : faute de bataille, les guerriers n’ont plus que les querelles privées (kenka) pour prouver leur valeur. Les guerriers sont alors encore très attachés à leur réputation (héritée des ancêtres) qui fonde leurs privilèges. Pour justifier d’une ascendance héroïque ou prestigieuse, on manipule le passé par la fabrication de généalogies.
L’apparition d’écrits hostiles au bushidô et le recours accru au registre des apparences sont les signes indiscutables de la crise de l’identité guerrière sous les Tokugawa. Or, si la classe des guerriers n’est pas en mesure de se réinventer, il lui faut entretenir la fiction de son utilité en tant que guerriers et de la nécessité du maintien de ses positions et privilèges : sinon, c’est reconnaître que d’autres qu’eux sont tout autant, sinon plus, capables de remplir les fonctions administratives qui leur ont été dévolues… On est donc bien en présence d’une crise d’identité « de guerriers qui n’en [sont] plus mais ne [peuvent] le reconnaître. » (p. 94)
Nous n’avons donné qu’un bref aperçu de la richesse de l’ouvrage d’Olivier Ansart et sans doute gommé la subtilité de son exploration de discours et de réalités complexes. Laissons aux spécialistes le soin de discuter tel ou tel point du livre, mais convainquons-nous du fait que :
« Les guerriers savaient très probablement qu’ils mentaient quand ils mentaient. Ils savaient que les généalogies, qu’ils affichaient publiquement et dont ils étaient si fiers, étaient fausses. Ils savaient où était leur intérêt, et voyaient qu’ils agissaient en conséquence. Ils savaient que les sabres, qui représentaient publiquement leur identité, étaient essentiellement des symboles. Et pourtant, […] ils devaient être imprégnés d’un fort sentiment d’identité de guerriers et convaincus de l’importance de leur rôle. Etaient-ils donc victimes d’une autoduperie collective ? » (p. 146)
A la lecture de cet opus, la réponse à cette question ne semble pas faire de doute…