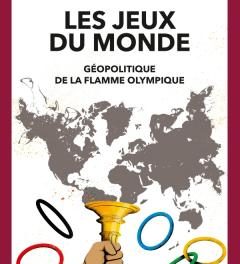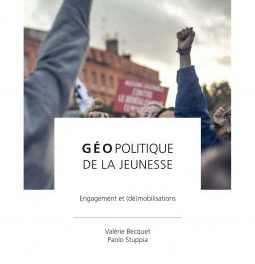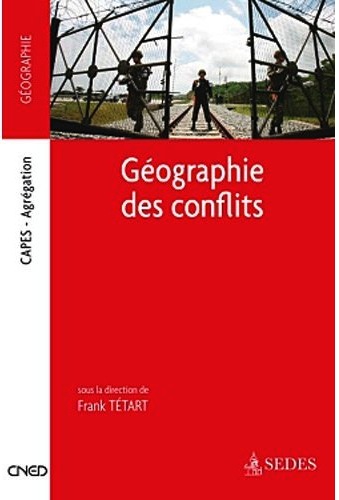
La polémologie en perspective
Cela nous ramène également à l’envers du conflit qu’est la paix. Cet aspect qui ne semble pas central lorsqu’on pose ce sujet se révèle un élement important. Les conflits diminuent parce que la diplomatie préventive connaît se développe (p. 35), mais également parce que certaines régions connaissent, au moins ponctuellement, une forme de stabilisation. Ainsi entre 1999 et 2008, le nombre de conflits majeurs dans le monde passe de 21 à 15, en grande partie parce que l’Afrique semble en voie de pacification (passage de 10 à 3 conflits majeurs) (2) après deux décennies de crise. La dimension géographique s’affirme là encore dans l’approche multiscalaire de la pacification : dans un cadre régional par des entreprises de médiation qui sont l’envers et le reflet des mobilisations conflictuelles (logique de voisinage, d’influence, de communautés), dans un cadre global par la recherche d’une nouvelle gouvernance qui fait depuis les années 1990 intervenir des organisations intergouvernementales comme l’ONU ou l’OMC. La présentation de la fonction de la frontière par Anne-Laure Amilhat Szary (partie 1, chapitre 2) permet de le rappeler opportunément ; la question des opérations de maintien de la paix insiste sur cette situation de conflit latent (partie 1, chapitre 4). La contribution de Lionel Baixas sur le conflit indo-pakistanais (partie 2 chapitre 6) illustre commodément cette question frontière qui se pose à plusieurs échelles. Du problème de la partition de l’ancien Raj britannique à la « place » de l’Etat du Jammu et Cachemire entre les deux Etats postcoloniaux, on retrouve la question des indépendantismes, des réseaux transnationaux et de l’instrumentalisation de ce territoire comme terrain de la rivalité des Etats voisins. Lionel Baixas ouvre sa réflexion sur la résolution dans deux directions, celle d’une approche par la démocratie pour résoudre le conflit, celle d’une coopération régionale qui tienne compte de la complexité de cet espace comme expression du soucis démocratique.
Qui sont les fauteurs de guerre ?
Sur les grandes tendances de la polémologie, la rupture récente repérée est évidemment celle de la fin de la Guerre froide. Avec le Nouvel Ordre Mondial qui se dessine, les conflits interétatiques décroissent, les conflits intra-étatiques (les guerres civiles) augmentent et ceux ci se transnationalisent du fait de l’existence d’enjeux régionaux (circulation des armes et des populations, existence de ressources, de groupes culturels ou religieux qui dépassent les cadres nationaux). La fin de la Guerre froide c’est également bien sûr la fin de grands blocs (l’ex-URSS) ou d’Etats fédéraux (l’ex-Yougoslavie) qui par la guerre parfois négocient l’indépendance que l’ordre bipolaire leur interdisait. Anne-Laure Amilhat Szary rappelle opportunément à la suite de Michel Foucher que « depuis 1991, plus de 26 000 km de nouvelles frontières internationales ont été instituées, 24 000 autres ont fait l’objet d’accords de délimitation et de démarcation » (p. 49). La frontière demeure un lieu de conflit privilégiée car elle est le lieu qui figure sur la carte comme dans les esprits la souveraineté et l’affirmation du pouvoir (le célèbre « la géographie ça sert d’abord à faire la guerre » d’Yves Lacoste demeure au moins dans les représentations collectives d’une puissante actualité).
Mais dans cette contribution sur les frontières, Anne-Laure Amilhat Szary va bien plus loin en posant que la frontière comme interface poreuse est le lieu de nombreuses violences qui ne sont pas dans le conflit interétatique, comme le sort des populations confrontées à des armes présentes en plus grand nombre qu’ailleurs, au développement des activités illicites qui entraînent le déchaînement de la violence parfois, existence de camps de réfugiés qui sont en même temps que des zones de refuge des points d’exportation et de diffusion du conflit qu’ils transnationalisent. Deux situations nous sont présentées qui méritent d’être signalées : celui des Etats faibles qui se révèlent incapables de contenir la violence frontalière, et le cas des villes de la frontière Etats-Unis/ Mexique est abordé (p. 63), mais également et de manière plus originale le problème des fronts pionniers comme lieu de production du territoire et donc de négociation de la frontière et de l’ordre qui s’applique en son sein (p. 59), élaboration d’une « règle du jeu » en cours de négociation. Le conflit israélo-palestinien mérite à lui seul l’analyse qui lui est consacré par Irène Salenson dans le chapitre 3. Elle y insiste sur la dimension frontalière profondément problématique car les frontières sont au coeur des différents projets qui se confrontent dans l’organisation de ce territoire à la fois concret et imaginaire puique associé à une très forte dimension religieuse. A défaut d’une réelle mise en perspective théorique et analytique, cette contribution est d’autant plus intéressante qu’elle repose sur les différentes prises de position israéliennes.
La nation se voit renforcée comme cadre de référence et notion centrale dans la compréhension des situations car elle est à la fois un cadre spatial d’analyse mais également un cadre conceptuel dans la production des situations de conflits. Le nationalisme politique et la construction de l’Etat nation qui s’articulent autour d’une langue (il en existe 5 à 6 000 dans le monde, ouvrant beaucoup de perspectives) ou de la réification d’une culture comme contenu – donc identité.
Les exemples exploités par Frank Tétart dans sa contribution sur « L’Europe face aux dynamiques nationalistes » (partie 2 chapitre 4) fait le tour de la définition de la nation et du nationalisme politique, recourant aux sociologues (ce qui n’est pas si fréquent et mérite d’être souligné) pour nous aider à comprendre les ressorts de la guerre en Yougoslavie et de la « dislocation yougoslave » (p. 258) puis des situations et stratégies de fragmentation à l’oeuvre dans les revendications nationalistes d’Europe de l’Ouest. L’ouvrage ne souligne peut être pas assez, même s’il la signale, la plasticité des appartenances et des allégeances. Elles obéissent à des règles de mobilisation et de construction relative au contexte historique et géographique : un groupe fera d’une identité un élément d’autant plus important de sa présentation qu’il s’en servira comme ressource politique (pp. 26, 256-257) ; en cela le nationalisme précède la nation.
De même l’universalité des religions donne à penser une forme d’unité interne qui, associée à la définition par les Etats-Unis d’un modèle géopolitique post-Guerre froide, sert de fondement à l’analyse en termes de « choc des civilisations ». Cette approche finalement très millénariste de la géopolitique résiste difficilement à la nuance par les relations entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Plusieurs configurations s’offrent à nous. La religion peut être instrument de pouvoir, et dans ce cas le chef politique peut être identifié comme chef religieux, ou la confusion peut être entretenue entre identité politique et identité religieuse – l’appartenance religieuse est alors une dimension centrale de la citoyenneté). Mais la religion est également un instrument de contestation du pouvoir, soit qu’une minorité religieuse cherche sur cette base à construire une minorité politique en demande d’autonomie, soit que la religion fonctionne comme un discours de la libération qui appelle au combat contre un pouvoir sécularisé ou une autre confession détentrice du pouvoir. L’exemple des chiites présenté résume assez bien la dimension multiscalaire de ce mélange entre religion et politique (p. 25).
La ville (partie 1, chapitre 4) enfin est une échelle stimulante d’analyse car si elle n’est pas le théâtre des combats et conflits les plus violents, elle est le cadre de la représentation du « modern warfare » (en tout cas pour les Occidentaux comme le rappelle Paul-David Régnier). Pourtant les doctrines stratégiques font des villes « des espaces qu’il convient d’éviter à tout prix » (p. 95) tant elles sont difficile à prendre comme à tenir dans le cadre du déploiement des armées conventionnelles, aspect développé avec efficacité dans l’analyse de Bassora (p. 96). L’auteur constate pourtant que la ville est devenue lieu du conflit là encore dans un cadre multiscalaire qui voit les combats livrés à l’échelle du quartier déterminés par des stratégies de « tenue » de la ville elles-mêmes guidées par des enjeux qui dépassent de loin l’échelle locale : la démonstration de force dans l’usage de l’arme atomique en 1945, le coeur des opérations de maintien de la paix (Beyrouth au début des années 1980 ; Mogadiscio et Sarajevo dans les années 1990, cette deuxième ville faisant l’objet d’une analyse plus fouillée et stimulante ; Abidjan, Kinshasa et Kaboul dans les années 2000) car elles sont au centre des flux de marchandises comme d’informations utiles aux besoins des opérations de pacification comme stratégiques dans le contrôle des espaces qu’elles polarisent. Cette échelle est également à privilégier car la ville est souvent centre du pouvoir et donc cible privilégiée des insurrections sépartistes et guerres civiles, des émeutes révolutionnaires ou des attaques terroristes, trois aspects que les conflits identitaires du début du XXIe siècle ont mis en avant. C’est dans ce sens que Simon Minkowski oriente sa contribution sur les conflit en Afrique subsaharienne (Partie 2 chapitre 2), s’attachant à une approche multiscalaire qui part du local (la prise des villes) pour avancer vers le régional (la région des Grands Lacs en exemple d’une « conflictualité totale aux échelles imbriquées ») prenant comme variable de l’analyse du cadre naturel (forêt, désert, littoral) et du terrain comme ressource du conflit.
Un besoin accru d’Etat
La capacité de l’Etat à contrôler son territoire en devient l’un des aspects saillants, car l’Etat défaillant voit lui échapper des portion du territoire terrestre ou maritime qui servent au déploiement des trafic (en Colombie pour les cultures de la drogue, en Somalie ou en Indonésie cela facilite le développement de la piraterie) ou de base arrière à des mouvements sécessionnistes ou terroristes (au Yemen ou au Pakistan des espaces marginalisés servent de base à al Qaïda). Le contrôle des ressources continue à être un enjeu, soit parce que leur contrôle est un enjeu de pouvoir (les diamants au Sierra Leone et au Liberia dans les années 1990), soit parce que le partage inégal des revenus qui y sont associés produit de la conflictualité : le Nigeria a connu la guerre du Biafra à la fin des années 1960 qui trouve un écho dans la rébellion du Movement for the Emancipation of the Niger Delta autour du partage de la rente pétrolière. Evidemment on rejoint ici encore la question de la frontière qui dans un Etat faible devient point de fixation des tensions par la volonté de produire de la frontière de groupes séparatistes ou par l’utilisation de la porosité des frontières par les circuits illicites. L’étude proposée par Simon Minkowski rebondit sur ces questions en présentant plusieurs situations conflictuelles en Afrique subsaharienne, mais c’est également le cas de l’étude bien menée sur la Corne de l’Afrique par Alain Gascon (Partie 2 chapitre 3) qui reprend les différentes données témoignant du caractère pluridimensionnel des conflits (enjeux géographiques, politiques et culturels), montrant au passage que l’Etat nation est le coeur du problème. Entre ceux qui ne sont pas des nations (Djibouti), ceux qui n’ont pas d’Etat (la Somalie) et les tensions interétatiques (Ethiopie-Erythrée), la fragilité de l’Afrique semble marquée par la question stato-nationale.
Les études de cas qui illustrent les terrains et terreaux de la conflictualité sont d’ailleurs assez inégales. Ainsi l’étude de la puissance des Etats-Unis pose un lien évident entre puissance et conflit (au Proche-Orient, en Asie, en Amérique et ailleurs), mais au fil de la lecture c’est plutôt une présentation de l’évolution de la doctrine stratégique des Etats-Unis qui nous est proposée par Jean-Loup Samaan (partie 2 chapitre 1). Mais on ne trouve pas de mise en relation des deux concepts de puissance et conflit qui permettrait de comprendre comment la puissance peut ou non conduire au conflit. Or la puissance c’est aussi une manière d’éviter, de dévier le conflit, et le débat sur l’évolution des orientations stratégiques qui est évoqué dans l’article laisse un peu sur sa faim. L’avantage des études proposées sur le golfe Arabo-persique (partie 2 chapitre 5) ou l’espace post-soviétique (chapitre 8) tient à ce que celles-ci, bien que descriptives, insistent davantage sur la production historique des situations conflictuelles ou sur leurs dimensions géographiques et géostratégiques. A défaut d’autre chose, elles se révèlent des instruments très utiles à la compréhension de ces aires, et donc très utiles aux étudiants notamment.
L’autre dimension de l’action des Etats est celle d’acteur des relations internationales, mais cette fois-ci par la production de règles qui paradoxalement révèlent ou suscitent le conflit. Trois exemples très intéressants sont sur ce thème mobilisés. D’abord celui de la « fabrication des territoires de la nature » (partie 1 chapitre 5) car si la nature est un construit social rapidement décrit dans cette contribution de Sylvain Guyot et Julien Dellier, la création de parcs naturels est un construit géopolitique qui questionne la production des frontières et les modalités de contrôle du territoire, notamment à travers les exemples américain (entre Chili et Argentine) ou africain (en Afrique du Sud) mobilisés (p. 120). Mais cet article souligne également comment les parcs sont un instrument de pacification par la production d’un espace commun et soulignent l’importance de la cogestion des parcs par les différents acteurs, au premier plan les Etats qui acceptent d’entailler leur souveraineté, ainsi que leur lecture stratégique de l’espace, au profit d’instances internationales : Parcs de la Paix en Afrique australe, parc national Nahuel Huapi en Argentine. La même réflexion est mise en oeuvre sur la question maritime par Mélanie Fournier (partie 1 chapitre 6), et l’article souligne là encore le problème que soulève la définition de la limite (et donc l’étendue de la souveraineté). La traditionnelle ZEE n’est pas ainsi la seule source de conflit ; le trait de côte lui-même en temps qu’instrument de mesure de l’étendue de la souveraineté maritime est problématique. Evidemment les exemples asiatiques (Kouriles, Spratly, Paracels) sont présentés comme autant de lieu de fixation des conflits territoriaux et dans la foulée les espaces partagés comme l’océan glacial Arctique (au passage une mise au point originale sur la propriété des icebergs dérivant en mer) présentés comme des lieux privilégiés d’observation de la définition de l’international à l’oeuvre. Enfin, et tout aussi stimulante on trouve une contribution de Jean-Loup Samaan sur le cyberespace, trop souvent présenté comme déterritorialisé alors qu’il est un vrai réseau géopolitique. En effet, au-delà de son origine militaire et stratégique, le cyberespace est devenu terrain d’affrontement d’acteurs nationaux comme transnationaux, les hackers pouvant être liés à un Etat ou au contraire contester les Etats en les attaquant. L’article nous rappelle également que les Etats par leur politique numérique (conditions d’hébergement, législation sur les pratiques) contribuent aux usages « problématiques » d’internet, depuis la question du téléchargement illégal d’oeuvres protégées par le droit d’auteur jusqu’à l’absence de mesures fortes pour contrer les escroqueries comme le phishing ou les cyberattaques par prise de contrôle de postes tiers (les PC zombies). Parallèlement les Etats cherchent à contrôler le cyberespace dans une proportion inverse à leur niveau de démocratie (ainsi la Russie ou la Chine bloquent des pans entiers de l’espace de discussion tout en étant des pôles de la cybercriminalité), ou par crainte des cyberconflits. Ainsi les Etats-Unis depuis 2001 développent une structure de défense cybernétique qui aboutit en 2010 à la création d’un Cyber Command, commandement interarmées qui témoigne, par sa doctrine, des difficultés. En effet quand les « alarmistes » espèrent ainsi dissuader un possible « cyber Pearl Harbor », les « réalistes » restent dubitatifs face à la volonté de dissuasion d’un ennemi insaisissable, dans sa géographie comme dans ses motivations. La Chine ou l’Europe ne sont pas en reste, mais n’ont pas ce degré de volontarisme : la Chine entretient surtout sa « Grande Muraille du Net » quand la France et le Royaume-Uni commencent à mettre en place une coordination depuis les attaques de 2007 contre l’Estonie.
____________________
1/ Certains titres témoignent bien de la difficulté à réduire la complexité et la variété, par exemple les sous-parties de Philippe Boulanger sont éloquentes : « Des causes diverses », « Différentes formes de conflits », « Les conséquences des conflits » (p. 38-39)
2/ Le défaut d’un tel tableau est de fonctionner sur une série un peu courte pour être significative. Il ne dispense pas non plus d’une analyse plus fine qui permette de repérer dans quelle mesure nous avons affaire à des conflits qui s’éteignent par négociation d’une paix durable ou non.