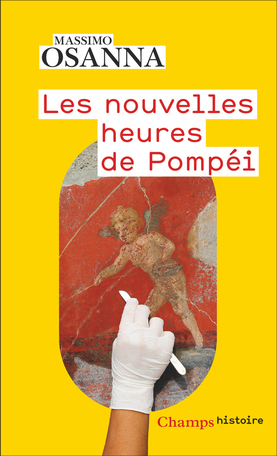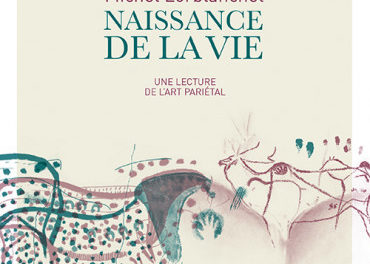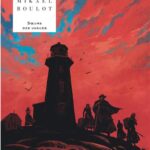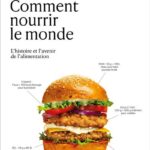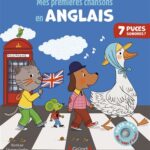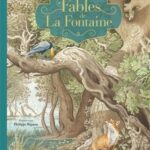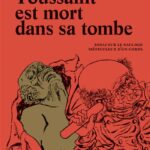« Elle est retrouvée. Quoi ? L’éternité ». Ces quelques vers d’Arthur Rimbaud cités par Massimo Osanna, professeur d’archéologie à l’université de Naples, pourraient très bien convenir aussi pour introduire l’ensemble de son dernier ouvrage. L’édition de poche des Nouvelles heures de PompéiRecension de la 1ere version : Les nouvelles heures de Pompéi, Massimo Osanna, Flammarion, 2020) permet de revenir sur les dernières découvertes réalisées au sein de ce chantier de fouilles permanent. C’est notamment grâce à une note laissée au charbon sur l’un des murs d’une maison de Pompéi que l’on est aujourd’hui certain que l’éruption eut le 25 octobre de l’an 79, et non pas le 24 août comme on nous l’avait enseigné autrefois. Au fil des pages, du sanctuaire à la chambre à coucher, de la taverne jusqu’au tombeau, l’auteur nous accompagne dans l’exploration de tous les recoins de cette Pompéi que l’on croyait connaître, mais qui apparaît sous un jour neuf, notamment grâce à l’emploi de nouvelles technologies. Dans un récit qui s’apparente parfois à un Discours de la méthode bien utile, l’archéologue nous apprend ainsi comment lire et interpréter une fresque ou comment écouter des « vases qui parlent ». Il se fait l’historien du site de Pompéi depuis les origines étrusques et grecques, mais il revient aussi sur l’histoire même de l’exploration du site et de sa mise en valeur. C’est un grand livre scientifique et historique, mais le comme le précise l’auteur lui-même, c’est aussi un ouvrage personnel dans lequel il laisse transparaître toute la passion qu’il a eu à œuvrer à Pompéi pendant près de cinq années. Pour résumer, un livre utile et beau à la fois. C’est suffisamment rare pour être souligné.

Collection privée
La longue vie de Pompéi
Le 25 octobre 79 pourrait être la nouvelle date officielle de l’éruption du Vésuve – et non le 24 août, comme on le supposa fort longtemps. C’est l’une des nombreuses découvertes des fouilles entreprises à partir de 2014 par Massimo Osanna. Après une brève introduction, les deux premiers chapitres traitent des origines de la cité, fondée à la fin du VIIe siècle. Les premières traces d’occupation du site sont mal connues, car recouvertes partiellement par la cité romaine. Les espaces religieux offrent davantage d’informations. Le premier chapitre est consacré aux rapport entre « les sanctuaires et la cité » : grâce à l’essor de nouvelles technologies, l’étude des sanctuaires d’Apollon et d’Athéna aide à retracer le développement historique de la cité, depuis ce que l’on doit considérer comme la fondation étrusque jusqu’à sa disparition. C’est autour de ces sanctuaires que les différentes communautés se sont réunies et confrontées au cours du temps ; Étrusques, Grecs ou Samnites y ont à chaque fois réinventé la cité. Le chapitre suivant, « aux origines de Pompéi et des Pompéiens », évoque un type d’artefact particulier, les « vases qui parlent ». Il s’agit de vases inscrits, comme celui de Mamarce Tetana, qui donnent des informations sur l’origine des premiers habitants de Pompéi, leur statut, et témoignent de l’importance de la présence étrusque à Pompéi dès la fin du VIIe siècle avant notre ère. Plus largement, ces inscriptions permettent de définir le cadre culturel de la cité des origines, marqué par la mobilité et les migrations.

Collection privée
Un quotidien ressuscité

Domaine public
Les trois chapitres suivants sont consacrés plus spécifiquement aux habitants de Pompéi, et plus précisément à l’animation qui devait agiter les rues et les quartiers de la cité. Dans le chapitre trois, « Rues, maisons, et boutiques. Le nouveau quartier retrouvé de la Région », Massimo Osana nous guide au sein d’un quartier nouvellement dégagé au sein de la région V, situé dans le quart nord-est de la ville. Ce îlot est traversé par la « Ruelle des balcons » autour de laquelle se présentent de nombreuses boutiques, une taverne et de luxueuses maisons, comme celle de la « maison des Noces d’Argent » ou la « maison du Jardin » qui était en cours de restauration lors de l’éruption du Vésuve. La « maison d’Orion » est ainsi nommée en raison des mosaïques qui y ont été découvertes en 2018. Les fouilles ont aussi permis de mettre à jour des artefacts de grande qualité qui ont échappé à la rapacité des fouilleurs clandestins. Le chapitre suivant, intitulé « ‘Sans gloire’ mais pas ‘sans histoire’ », revient sur les nombreuses inscriptions retrouvées sur les murs de la ville ou au sein des demeures privées : affiches électorales, invectives se mêlent aux plaisanteries obscènes ou aux épigrammes maladroits. Un graffiti retrouvé dans la maison du Jardin » a particulièrement retenu l’attention : il est daté du 17 octobre, soit seulement une semaine avant l’éruption. Enfin, dans « Gladiateurs et tavernes », l’auteur s’intéresse à la vie d’une place de Pompéi, au croisement de la ruelle des Noces d’Argent et de celle des balcons : on y trouvait notamment un autel consacré aux Lares compitales, une taverne qui devait être fréquentée par les gladiateurs, et enfin un thermopolium, l’ancêtre du street food, dont les déchets rendent compte partiellement du régime alimentaire des Pompéiens.
Monuments et œuvres d’art : essais d’interprétation

Source : Surintendance de Pompéi
Les chapitres suivants reviennent sur la découverte de plusieurs œuvres d’arts et monuments oubliés de Pompéi. Dans le chapitre 6, « le mystère élucidé de mosaïques d’Orion », Massimo Osanna déchiffre deux images dont le programme iconographique n’avait pas de correspondant par ailleurs : sur l’une d’entre elles, des animaux sauvages et une chimère sont tenus en laisse tandis qu’un papillon flotte au-dessus du groupe. Le centre de l’autre est occupé par un homme à la chevelure enflammée et aux ailes de papillon. De la taille du héros émerge le corps d’un scorpion. Tout ceci évoquerait l’astérisation d’Orion, c’est-à-dire sa transformation en constellation. « Dans la chambre de Léda : mythe et érotisme », l’auteur replace une œuvre d’art au sein de son espace d’exposition. Située au seuil de la chambre à coucher, la fresque qui évoque l’épouse de Tyndare constitue une véritable « explosion érotique » (p. 189) : alors que le cygne est sur le point de posséder Léda, celle-ci détourne le regard vers les spectateurs. L’image illustre la fonction de la pièce, mais constitue aussi une « source d’inspiration » pour les visiteurs. Enfin, dans « le plus aimé des Pompéiens. Une tombe particulière à la porte de la ville (8) », on apprend que des fouilles récentes menées sous le bureau même d’Osanna ont permis de mettre au jour un mausolée monumental. Une inscription potentiellement rattachée à cette tombe indique que pour marquer son passage à l’âge adulte, le défunt aurait invité tous les hommes libres à un banquet somptueux et organisé un spectacle de 416 gladiateurs, ce qui est considérable pour une cité de la taille de Pompéi. Le paradoxe tient au fait que le nom de cet homme particulièrement puissant nous reste aujourd’hui inconnu. Sic transit gloria mundi.
Fin et résurrection de la cité et de ses habitants

Collection privée
Les dernières pages sont consacrées aux ultimes instants de la cité et à sa redécouverte à partir du XVIIIe siècle. Dans le chapitre 9, « Cendres et lapilli : anatomie d’un désastre », nous comprenons mieux comment les différentes couches de dépôts volcaniques permettent de documenter avec précision non seulement le déroulement de l’éruption de 79 de notre ère, mais aussi des éruptions successives. Il apparaît que la mort des habitants s’explique de multiples façons : la plupart ont été asphyxiés par les cendres rejetées par le Vésuve, d’autres sont décédés à la suite d’un choc thermique, et enfin certaines ont été victimes de traumatisme. Dans les pages suivantes, «‘Arrachés à la mort’. Les premiers moulages des victimes de Pompéi (10) », Osanna insiste sur l’exception que constitue la collection des moulages qui ont figé pour l’éternité l’agonie des citoyens de Pompéi. Les dernières découvertes technologiques, comme l’analyse ADN, nous en apprennent davantage par exemple sur leurs liens de parenté. Ces sculptures sont justement célèbres mais nous apprenons qu’elles ont aussi une histoire : par exemple, la qualité du plâtre employé était bien meilleure au XIXe siècle qu’en 1980, ce qui fait que les moulages modernes sont aujourd’hui en piètre état et doivent même faire l’objet de restaurations. Enfin, en annexes, l’auteur revient sur la résurrection de Pompéi et fait l’historique des fouilles menées dans la cité ; il montre à quel point le site que les touristes visitent aujourd’hui est aussi (et surtout ?) le fruit d’une construction contemporaine De sa redécouverte en 1748 jusqu’au « Grand Projet Pompéi » lancé par l’Europe en 2013, Massimo Osanna éclaire sur les choix faits par les différents archéologues qui ont travaillé sur le chantier et se place asi au sein d’une longue lignée de chercheurs qui ont œuvré à transformer Pompéi « en espace d’excellence et d’expérimentation » (p. 331).
Le livre de Massimo Osanna est remarquable à plus d’un titre : au-delà du fond extrêmement riche que nous avons évoqué, certains traits permettent de le distinguer de la masse des ouvrages consacrés à Pompéi. Tout d’abord, la langue est claire et précise, et on peut saluer à cet effet le travail des trois traductrices (Madeleine Rousset Grenon, Béatrice Didiot et Danièle Faugeras). Mais la science sait aussi faire place à la poésie et l’archéologue arrive à communiquer sa passion : il n’est pas si courant pour un chercheur d’invoquer Proust ou Rimbaud pour rendre compte de ses travaux. Ce livre est aussi l’œuvre d’un pédagogue dans le sens ancien du terme, c’est-à-dire qu’il prend le lecteur par la main pour le mener au savoir : il évoque avec lui l’historique des fouilles, les hypothèses soulevées, les impasses de la recherche ou les silences des sources, et l’amène naturellement à partager ses conclusions. Tout est fait pour aider à s’y retrouver : vingt-cinq pages de notes, une brève chronologie, un glossaire qui revient sur la signification des termes latins ou techniques, et trente pages de bibliographie. S’il s’avère un excellent guide, aussi bien pour les néophytes que les spécialistes, Massimo Osanna respecte aussi notre liberté : chaque chapitre peut se lire de façon indépendante, il est loisible de papillonner à son gré au fil des pages. C’est même fortement conseillé car l’ouvrage est abondamment illustré. Il faut plus particulièrement saluer le cahier central : les photographies en couleur des différentes fresques mises au jour par les archéologues sont particulièrement bienvenues et incitent facilement au rêve. Bref, un délice de livre.