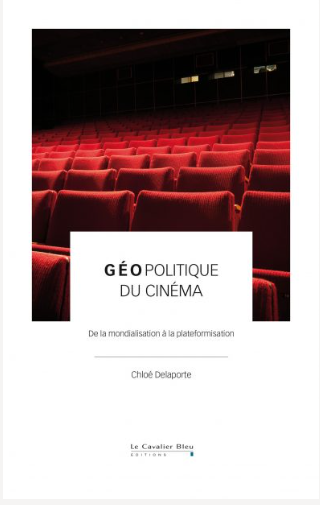Suite à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, le Festival de Cannes désigne persona non grata toutes les personnalités pro-Proutine. Il décide même d’ouvrir la compétition avec le film La Femme de Tchaïkovski de l’opposant russe Kirill Serebrennikov. Cet exemple nous rappelle combien le cinéma est au cœur d’enjeux géopolitiques.
La géopolitique du cinéma est au croisement de deux dimensions interdépendantes : d’un côté, sa place comme arme de soft power influant sur les relations internationales et véhiculant des valeurs et des idéologies, et de l’autre, sa fonction économique en tant qu’industrie culturelle. C’est autour de ces enjeux géopolitiques au XXIe siècle que Chloé Delaporte axe sa réflexion en l’intégrant dans une histoire du cinéma et en s’efforçant d’éviter tout ethnocentrisme.
Chloé Delaporte est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches. Elle enseigne la socioéconomie du cinéma et de l’audiovisuel à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, où elle est rattachée au RIRRA21. Ses travaux portent sur la diffusion, la valorisation et la réception des films et séries. Elle est l’auteur en 2015 de Le Genre filmique. Cinéma, télévision, internet (Presses Sorbonne Nouvelle) et en 2022 de La Culture de la récompense. Compétitions, festivals et prix cinématographiques (Presses universitaires de Vincennes)
Une économie du film mondialisée ?
Dans cette première partie, Chloé Delaporte s’intéresse aux rapports de force contemporains dans l’économie mondiale du cinéma et à leurs évolutions. Elle commence naturellement par revenir sur l’hégémonie hollywoodienne qui dispose aujourd’hui de l’industrie cinématographique la plus puissante et la plus influente du monde. Elle revient d’abord sur l’évolution du cinéma avant la création d’Hollywood en notant que jusqu’aux années 1920 c’est la France qui domine l’économie mondiale du film. Les rapports de force changent au lendemain de la Première Guerre mondiale avec l’industrialisation de la production américaine et son organisation en grands studios. Ces derniers, surnommés les « Big Five » (MGM, Warner Bros, Paramount, 20th Century Fox, RKO) contrôlent toute la chaîne de valeur du film de la production à l’exploitation en passant par le star system. Jusqu’en 1948, les majors bénéficient d’une certaine tolérance des pouvoirs publics face aux actions antitrust. Mais, le « Décret Paramount » les oblige à se séparer de leur parc de salles ce qui modifie le fonctionnement de l’industrie hollywoodienne des années 1950 aux années 1970 (épanouissement des indépendants et du Nouvel Hollywood, invention du blockbuster …). Cependant, Reagan dans les années 1980 renforce de nouveau les studios qui peuvent désormais déployer leur activité dans le domaine de l’entertainment de façon générale. Aujourd’hui, 5 majors dominent le marché américain : Walt Disney Company, Warner Bros. Enterntainment, Universal Pictures, Sony Pictures et Paramount Pictures. Depuis le milieu des années 1990, la proportion de recettes générées par les films hollywoodiens à l’international dépasse de façon continue celles générées sur le marché états-unien. Si le marché européen constitue depuis les années 1920 un marché de premier plan, le développement des marchés asiatiques est désormais perçu comme une opportunité par l’industrie hollywoodienne.
Puis, Cholé Delaporte s’intéresse à l’émergence de nouvelles puissances cinématographiques qui « résistent » à l’américanisation des écrans et oeuvrent au développement de leur propre cinéma national. L’auteur note d’abord que l’hégémonie hollywoodienne se mesure à la présence massive des films américains sur tous les écrans (pas que de cinéma) de la planète. Elle est favorisée par la langue mais aussi par la diffusion d’une pop culture américaine. Cependant, dans les pays qui ont développé leur propre cinéma national, la crise de la Covid-19 a créé un effet d’aubaine augmentant la part de marché des films nationaux. Parmi les régions qui résistent particulièrement à l’hégémonie américaine, les concurrences asiatiques occupent une place particulière. Ainsi, l’industrie nippone a connu un « âge d’or » dans les années 1950-1960 avec des réalisateurs comme Kurosawa ou Mizoguchi qui lui permettent une reconnaissance hors du Japon. Cette industrie est alors en grande partie calquée sur le modèle hollywoodien. Aujourd’hui, malgré la reconnaissance internationale de cinéastes marqués « auteurs » (Kitano, Kawase, Kore-eda…) la situation économique de la filière nippone reste instable avec un marché restructuré autour 4 majors (Toho, Toei, Schochiku et Kadokawa). Par contre, avec des studios comme Ghibli (fondé par Miyazaki), le Japon a su s’imposer sur le marché de l’animation comme un acteur majeur à l’échelle mondiale. L’industrie nippone doit désormais faire face à d’autres cinématographies asiatiques concurrentes en plein essor comme celle de la Corée du Sud (qui a emprunté un grand nombre de stratégies au modèle hollywoodien) mais surtout cette de la Chine qui constitue la principale concurrence asiatique aux Etats-Unis. Si le cinéma a été introduit en Chine au tournant du XXème siècle, sa reconnaissance mondiale s’est d’abord concentrée dans les années 1970 autour de la filière hongkongaise avec des « films de genre » (arts martiaux notamment). C’est dans les années 1980-1990 que le cinéma de Chine continentale accède à une renommée internationale avec des cinéastes comme Chen Kaige ou Zhang Yimou. C’est aussi au milieu des années 1990 que le système de studios d’Etat est restructuré pour laisser la place à des conglomérats privés (mais contrôlés par l’Etat) et à quelques indépendants dont les films sont destinés aux festivals internationaux. Si le cinéma hollywoodien représentait les ¾ du marché chinois dans la première moitié du XXème siècle, Hollywood est absente des écrans chinois entre 1951 et 1981. A partir de 1994, une politique de quotas autorise les films étrangers à sortir en Chine (actuellement 70 films par an) : l’importation de films est contrôlé par le gouvernement via la China Film Group Corporation. La croissance fulgurante du marché chinois (80 000 écrans, 1,73 milliards d’entrées) amène Hollywood à accentuer ses coproductions avec les filières chinoises et à adapter ses films à ce marché.
L’auteur analyse ensuite la production cinématographique dans le monde. A l’échelle internationale, une douzaine de pays se distinguent vaec plus de 100 films produits par an. C’est notamment le cas du Nigéria qui est le 1er producteur de films au monde avec 1500 à 2200 films par an. L’industrie audiovisuelle nigériane s’est considérablement développée dans les années 1990 et le phénomène s’est amplifié dans les années 2000 et 2010. Mais, ces films ne sortent que très rarement en salle : ils sont essentiellement vendus en DVD. A côté du « Nollywood » qui produit des films en anglais dans le sud du Nigéria, il existe d’autres pôles de production qui tournent en langue autochtone (comme « Kannywood » dans le nord du pays en région musulmane). On retrouve la même situation en Inde, 2ème pays producteurs de films au monde (2000 films par an) où il existe autant d’industries cinématographiques que d’Etats indiens et de langue. Mais, le pôle de production le plus prolifique est celui de « Bollywood » situé à Mumbaï et où on tourne en hindi. La production occidentale est dominée par Hollywood et ses 700 à 1000 films par an. Le Canada, grâce à sa filière active dans la production et les tournages de film, est un lieu privilégié pour les productions délocalisées hollywoodiennes. L’Australie et la Nouvelle-Zélande se trouvent dans une situation similaire bien que moins liés à Hollywood. En Europe, la France occupe la 1ère place du continent avec 200 à 300 films par an. Elle est suivie de l’Espagne et du Royaume-Uni, puis derrière l’Italie et l’Allemagne. Quant à la Russie, la production est en plein développement depuis la Perestroïka avec une spécialisation pour les films d’animation et les documentaires. Il existe aussi des pôles cinématographiques influents à l’échelle régionale comme en Amérique latine et du sud (Mexique, Argentine, Brésil), au Moyen-Orient (Turquie, Pakistan, Iran, Egypte) ou en Afrique (studios Gauteng en Afrique du Sud).
Mais, l’indicateur du nombre de films produits n’est pas suffisant pour comprendre les rapports de force entre les pays. Il faut aussi prendre en compte la capacité d’un Etat à rentabiliser ses investissements et à générer des recettes. Or, les industries produisant massivement des films ne correspondent pas forcément aux territoires où on en visionne le plus ni où on génère le plus de recettes. Ainsi, tous les pays ne sont pas équitablement dotés en salles de cinéma : les Etats-Unis dominent le classement (12,15 écrans écrans pour 100 000h) loin devant la Chine (5,68) et l’Inde (0,67). Les formats du multiplexe (6/8 écrans) et du mégaplexe (12/16 écrans) se sont considérablement étendus depuis les années 1980 aux Etats-Unis, puis en Europe dans les années 1990 et en Asie à partir des années 2000. Le classement des 10 premiers marchés mondiaux en nombre d’entrée est quasi-similaire à celui du nombre salles (sauf pour l’Inde qui a un nombre très élevé d’entrées). Le nombre d’entrées dépend aussi des habitudes de fréquentation du public national qui varient d’un pays à l’autre, mais aussi à l’intérieur même des Etats. Enfin, le classement en montant des recettes montre un autre visage du marché mondial du cinéma car il dépend du coût moyen national d’un ticket de cinéma. Ainsi, en 2020, la Chine a dépassé les Etats-Unis alors que l’Inde est reléguée en 8ème place (avec un ticket ne dépassant pas 1 dollar) et le Japon est en 3ème (avec un ticket à 15 dollars!).
Politiques publiques et stratégies industrielles
Dans cette deuxième partie, Chloé Delaporte s’intéresse aux stratégies de croissance des industries cinématographiques. Elles peuvent reposer alors sur des mesures incitatives protectionnistes visant à favoriser à la fois la production et la diffusion de films nationaux sur le territoire. Les Etats qui veulent inciter la production de films nationaux peuvent s’appuyer sur des financements publics. Cela peut se traduire par la mise en place d’un fonds de soutien à la création cinématographique. C’est le cas en France avec la création du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) dont le fonds est abondé par une taxe sur les entrées en salle (TSA) et financé par les diffuseurs télévisuels. Cet exemple a été suivi par l’Allemagne et par le Royaume-Uni (jusqu’en 1985 avant d’être remplacé par un dispositif financé par la National Lottery ). Il existe aussi des systèmes d’aides régionaux et d’autres supranationaux . C’est le cas, par exemple, en Europe avec les fonds paneuropéens visant à favoriser la coopération entre les différents Etats membres. De manière générale, les fonds destinés à d’autres cinématographies que la production nationale ont aussi pour but de valoriser cette dernière car les critères d’attribution des aides impliquent de réaliser une partie des étapes de production dans le pays donateur. Un autre levier de financement public est le crédit d’impôt qui peut aussi être utilisé par les Etats souhaitant inciter les tournages étrangers sur leur territoire. Il existe aussi d’autres outils comme les obligations d’investissement des diffuseurs (chaînes TV et plateformes). Ainsi, en France, les plateformes doivent désormais investir dans l’audiovisuel en France. Le financement public de la création est aussi un enjeu symbolique car les films financés par les fonds publics sont promus comme des cinémas « d’auteur ». Cependant, la dépendance au financement public peut rendre l’industrie nationale vulnérable (comme au Brésil par exemple) car soumise aux visées idéologiques du gouvernement en place. L’imposition de quotas est aussi un levier important des politiques protectionnistes. Cette politique est mise en place en France dès les années 1930 et de nombreux pays l’adoptent après la Seconde guerre mondiale pour lutter contre l’impérialisme américain. Mais, dans les années 1990-2000, l’adhésion à l’OMC oblige à faire sauter cet obstacle au libre-échange. Cependant, des pays comme la France ou la Corée du Sud font valoir « l’exception culturelle » concédant aux produits culturels une circulation différente des autres produits de consommation. Les quotas de diffusion favorisent plus le secteur de la production que ceux de la distribution et de l’exportation : ils sont vus d’un mauvais œil par les acteurs qui travaillent avec l’international et par les diffuseurs télévisuels et vidéos qui sont contraints dans leur stratégie d’acquisition et de gestion de leurs catalogues. Enfin, la censure peut aussi être un outil détourné pour restreindre l’accès au marché national à des films étrangers. Souvent, elle passe par la délivrance ou non d’un visa d’exploitation comme c’est le cas en Iran.
En parallèle, sont aussi mises en place des stratégies expansionnistes reposant sur la capacité des acteurs à internationaliser leurs filières de production dans une double dynamique : « faire venir l’étranger à soi et aller soi-même vers l’étranger ». Ainsi, la structuration d’un pôle de production implique des migrations aussi bien intra-nationales qu’internationales. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l’industrie hollywoodienne a attiré des talents étrangers. L’import de talents venant de pays anglophones occidentalisés (Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) est alors facilité par la proximité linguistique et culturelle. On retrouve le même phénomène à Bollywood. Un autre outil d’internationalisation est la coproduction car elle augmente les chances de pénétrer un marché extérieur. La France, avec une cinquantaine d’accords bilatéraux, est la championne du monde des accords de coproduction lui ouvrant les portes de la diffusion dans de nombreux marchés extérieurs. En effet, un film coproduit entre plusieurs pays est considéré comme « national » dans ces pays lui ouvrant des droits aux aides publiques et permettant de contourner les quotas de diffusion. Cela explique que de les studios occidentaux coproduisent de plus en plus avec des firmes chinoises. Certaines industries internationalisent aussi leur production en délocalisant les tournages. Cette internationalisation de l’industrie cinématographique est visible dans l’augmentation des investissements étrangers prenant la forme de rachat mais aussi de partenariats et d’accords entre firmes. L’objectif de ces investissements étrangers est avant tout d’ordre financier et économique : les firmes japonaises (Sony), françaises (Canal+) ou chinoises (Tencent) investissent dans le cinéma hollywoodien pour s’assurer un canal d’approvisionnement en films. Mais, dans certains Etats l’ouverture aux capitaux étrangers de l’industrie cinématographique est extrêmement contrôlée. C’est le cas en Chine où les pouvoirs publics veulent garder le plein contrôle de cette forme de soft power.
Cependant, l’internationalisation des filières ne repose pas seulement sur des stratégies financières : le succès d’une cinématographie nationale à l’étranger repose aussi sur sa capacité à s’adapter au marché mondialisé. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, les studios américains cherchent à « désaméricaniser » une partie de leur production. Afin d’éviter une interdiction de sortie ou une obligation de retirer un film des salles, ils ajustent leur scénario et respectent en amont les règles de censure. Le premier enjeu tient dans la langue de tournage des films. En effet, elles déterminent l’ampleur des aires de diffusion potentielle des différentes cinématographies. Ainsi, les pays où une seule langue officielle est reconnue et majoritairement parlée sont privilégiés car les films peuvent alors circuler sans adaptation dans toutes les régions. La situation est bien sûr encore plus avantageuse quand la langue est parlée en dehors du pays. Les distributeurs sont souvent obligés de procéder au doublage ou au sous-titrage des films. Le premier est généralement préféré par les distributeurs car il permet d’intégrer indirectement au casting du film des acteurs autochtones (cas des films d’animation). Ainsi, distribuer un film étranger dans un pays multilingue est très coûteux. Il arrive aussi que l’adaptation linguistique des films soit prise en charge par le public lui-même par du sous-titrage amateur, voire du doublage amateur. Certaines industries (comme les Etats-Unis ou l’Inde) préfèrent adapter des films étrangers sous la forme de remake plutôt que de les distribuer dans leur version originale. La constitution de castings cosmopolites constitue aussi un outil efficace d’internationalisation. A Hollywood, depuis les années 1990, on intègre aux films des acteurs renvoyant aux principaux marchés extérieurs : le Japon, la Chine, la France, Royaume-Uni … De même, alors que la pratique du whitewashing (fait de confier un rôle de personnage extra-occidental à un acteur nord-américain blanc en le maquillant) a été longtemps la norme à Hollywood, les voix des spectateurs et professionnels racisés du cinéma américain s’élèvent depuis le milieu des années 2010 pour exiger plus de diversité. Alors que la raison de cette blanchité est présentée comme pragmatiquement économique par les studios, certains confient des rôles clés à des acteurs non blancs pour promouvoir leur « ouverture » et séduire les audiences attentives à la diversité, suscitant parfois de violentes polémiques. Enfin, le marketing peut constituer une étape clé pour adapter un contenu aux attentes des publics étrangers. L’intervention consiste alors à adapter les outils marketing originaux soit en invertissant l’ordre de grandeur des différents personnages sur l’affiche, soit en supprimant certaines informations, soit en modifiant le titre d’exploitation.
Pour terminer, Chloé Delaporte analyse les outils pour rayonner culturellement et développer la circulation des films. Les industriels peuvent, par exemple, s’appuyer sur des structures chargées de promouvoir l’export de cinématographies nationales. C’est le rôle aux Etats-Unis de la Motion Picture Export Association (MPEA) qui mène une politique extérieure offensive pour libérer de toute entrave la circulation des films hollywoodiens à l’international. Organe de pression autant que de négociation, elle n’hésite pas à utiliser le boycott pour arriver à ses fins et défendre les intérêts privés des majors. En France, c’est une structure publique, Unifrance, qui aide au rayonnement international du cinéma français. De manière générale, toutes les cinématographies qui s’exportent même à l’échelle régionale disposent de tels organes de promotion. Cette nécessité de structurer le secteur de l’exportation tient en partie à la multiplication depuis les années 1990 de marchés du film devenus des étapes nécessaires à la circulation internationale des contenus audiovisuels. De plus, être reconnu comme un pays produisant de « bons » films est important pour pénétrer l’économie mondiale du cinéma. Les industriels comme les pouvoirs publics sont donc très attentifs à la sélection des films dans les festivals internationaux, générant la reconnaissance et parfois un gain financier. Les périmètres d’éligibilité aux différents prix offerts dans les festivals et cérémonies recouvrent des enjeux géopolitiques. Ainsi, l’Oscar du meilleur film international valorise particulièrement les pays avec lesquels Hollywood souhaite entretenir de bonnes relations. De même, la sélection en festival est vue par les cinématographies non dominantes comme un tremplin avec une meilleure visibilité. A côté des Oscars et des festivals internationaux de première catégorie (Cannes, Berlin, Venise), les cinémas non occidentaux ont créé leurs propres dispositifs. Ainsi, le Burkina Faso accueille chaque année le plus important festival du continent africain, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), ainsi que le MICA, le marché du film africain. De même, presque toutes les industries cinématographiques ont créé leur version des Oscars américains. L’importance d’une économie parallèle du cinéma dit « de prestige » pousse les acteurs des filières à développer à la fois des films pour le grand public rentabilisés grâce aux entrées en salle et des films « de festival » rentabilisés par le surplus de notoriété. Enfin, la conquête d’un marché extérieur s’appuie sur le rayonnement culturel du pays, notamment par la diffusion des séries télévisées. Ces dernières favorisent les échanges et l’interpénétration des marchés du film en familiarisant les publics avec de nouvelles formes, genres, styles et thématiques. Ainsi, la vente de catalogues entiers de séries à travers le monde dès les années 1970 a permis aux Etats-Unis d’infuser les cultures populaires. Mais, sur certains marchés, les séries américaines font face à de sérieux concurrents comme en Amérique du Sud avec les telenovelas ou en Afrique de l’Ouest. Depuis les années 2000-2010, la mondialisation des séries s’est accompagnée de l’arrivée des plateformes permettant leur visionnage en streaming. Ces dernières ont eu pour effet d’intensifier la circulation internationale des contenus et de rapprocher certains consommateurs de séries étrangères auxquelles ils avaient peu accès. Les séries occupent aussi une place importante dans les politiques extérieures des Etats. Ainsi, le gouvernement turc soutient financièrement la filière de production des séries car elle ouvre les portes des marchés extérieurs (Moyen-Orient, Asie, Afrique) en matière cinématographique et audiovisuelle, présentant des intérêts économiques mais aussi géopolitiques.
Propagande, idéologie et soft power
Dans cette 3ème partie, Chloé Delaporte analyse les relations qu’entretiennent le cinéma et la propagande. Elle revient d’abord sur l’utilisation par les Etats démocratiques du cinéma comme outil de propagande de guerre. Dès la guerre hispano-américaine de 1898, le cinéma été utilisé pour documenter les différentes guerres mais surtout pour en livrer un interprétation favorable aux politiques menées par les puissances internationales. La Première Guerre mondiale marque une étape importante dans le recours au cinéma comme arme de propagande : le cinéma devient dès lors une affaire d’Etat avec une institutionnalisation du contrôle de la production et la création de départements dédiés au sein des armées. Ainsi, en France, est créé en 1915 un Service cinématographique des armées chargé de la production de films de propagande aussi bien pour les actualités filmées que des œuvres de fiction. Du côté britannique, le cinéma de propagande est développé dès 1915 par le British Topical Committee for War Films. Un autre objectif de propagande est alors de convaincre les Etats-Unis de s’engager dans la guerre. Pour ce faire, le président Woodrow Wilson instaure la Commission on Public Information. Dans les années 1920-1930, l’industrie hollywoodienne va familiariser le public avec le film de guerre ce qui favorisera le redéploiement du cinéma de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. La création de la Hollywood Anti-Nazi League en 1936 encourage la production de films de guerre interventionnistes appelant au soutien des Etats-Unis dans la lutte antinazie. Après l’engagement des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, le président Franklin D. Roosevelt se dote d’un organe officiel de propagande, l’Office of War Information, qui s’appuie sur le cinéma en commandant des documentaires à des réalisateurs de renom. Les collusions entre Hollywood et le Pentagone connaissent un coup d’arrêt dans le contexte de la guerre froide et de la lutte contre les communistes. En 1947, une liste noire recense 19 artistes « communistes » à boycotter et au début des années 1950 le sénateur Joseph McCarthy se lance dans une « chasse aux sorcières ». A partir des années 1960, en particulier pendant la guerre du Vietnam, la propagande de guerre du gouvernement américain s’appuie surtout sur la télévision. C’est à travers la figure de l’ancien combattant (Taxi Driver, Rambo…) que le Vietnam va trouver une place au cinéma à la fin des années 1970 et dans les années 1980. L’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre 2001 est prise pour sujet par les studios hollywoodiens, bien souvent avec le soutien du Pentagone : le Pentagone, Hollywwod et Washington deviennent alors les acteurs d’une même stratégie globale, celle de l’impérialisme américain au nom d’un cinéma de « sécurité nationale ». Cependant, tous les conflits armés dans lesquels s’engagent les Etats ne sont pas tous médiatisés par le cinéma. Ainsi, la guerre de Corée a été peu traitée par le cinéma hollywoodien. Il en va de même du côté français avec la guerre d’Indochine, plus par autocensure des cinéastes de l’époque que par censure de l’Etat.
Les films peuvent aussi servir à l’endoctrinement, c’est-à-dire une forme radicale de propagande s’exerçant dans des contextes où des positions alternatives à l’idéologie dominante ne sont pas exprimables. Ainsi, le cinéma a occupé une fonction propagandiste centrale dans la plupart des des régimes totalitaires du XXème siècle. Ainsi, dès son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Hitler crée un ministère de l’Education du peuple et de la propagande dirigé par Goebbels, qui considère le cinéma comme l’un des « moyens de manipulation des masses les plus modernes ». Le parti nazi nationalise presque entièrement la filière cinématographique allemande, instaure des comités de vérification et commissions de censure pouvant interdire tout film et se lance dans la construction de salles et l’organisation de projections, surtout destinées à la jeunesse. En parallèle, s’engage une production d’un cinéma de propagande nazie avec des documentaires (comme ceux de Leni Riefenstahl) mais aussi des films de fiction et de montages antisémites. De son côté, le stalinisme ne fait pas un usage aussi massif du cinéma comme arme de propagande. Pourtant, le potentiel propagandiste du cinéma est exploité en Russie depuis la révolution de 1917 : l’industrie cinématographique est nationalisée et une école de cinéma est créée en 1919. De même, dans les années 1920, de nombreux cinéastes (comme Sergueï Eisenstein) tournent des films commandés par le pouvoir politique. Mais, Staline musèle les acteurs de la filière, censure la production (qui s’effondre) et commande la réalisation de fiction nourrissant le nationalisme soviétique et le culte de la personnalité. Dans l’Italie fasciste, la propagande cinématographique s’exerce d’abord au sein des actualités filmées mettant en scène Mussolini. La création des studios de la Cinecittà en 1937 permet au Duce de contrôler et d’amplifier la production notamment de films de divertissement présentant une version fantasmée de la classe moyenne italienne. Du côté de la Chine de Mao Zedong, le contrôle de l’industrie cinématographique passe par la création du Bureau du cinéma en 1949 et de l’Académie du cinéma de Beijing en 1950, ainsi que par la nationalisation des studios et le contrôle strict de la production par la Section de la propagande du Parti communiste. Un des rares cinémas d’Etat à subsister aujourd’hui est le cinéma nord-coréen dont la production ne dépasse pas la vingtaine de films par an dont la diffusion hors des frontières est extrêmement limitée. De son côté, le cinéma colonial est une forme particulière de cinéma de propagande visant à convaincre les populations des régimes démocratiques du bien-fondé et de la mission civilisatrice de l’entreprise coloniale. Dans le cas français, le cinéma colonial n’est pas un cinéma de propagande officiel pris en charge et commandé par les pouvoirs politiques : il est le résultat de la convergence d’opinion d’une partie des acteurs de la filière avec l’idéologie dominante pro-coloniale. Seules les guerres de décolonisation (Indochine, Algérie) font l’objet d’un cinéma de propagande officiel commandé par le Service cinématographique des armées (SCA). De leur côté, les Eglises prêtent une attention particulière au cinéma depuis la deuxième moitié du XXème siècle pour sa capacité à convaincre voire à convertir. Dans les pays religieux, le contrôle religieux du cinéma s’exerce le plus souvent par la censure. Dans la plupart des pays libéraux du monde occidental, le contrôle religieux s’exerce par une cotation morale des films, établissant des listes de recommandations et d’interdiction voire de boycoot de certaines sorties. Si l’Eglise catholique a finalement peu recours à la production de films de propagande officielle , ce n’est pas le cas des protestants, notamment les évangéliques et les néo-pentecôtistes. Leur prosélytisme passe alors par des sociétés de production spécialisées qui produisent des films déployant une imagerie réactionnaire en ciblant notamment la pratique de l’avortement.
Chloé Delaporte analyse ensuite les politiques de représentation et les processus d’altérisation en jeu dans la production cinématographique. Ainsi, il est fréquent que le rôle de l’ennemi dans un film soit occupé par un personnage de nationalité étrangère, originaire d’un pays en conflit avec le pays producteur du film. Ainsi, les méchants des films hollywoodiens sont nazis dans les années 1940, puis Russes dans les années 1950 et 1960. Puis, dans les années 1970, mais surtout 1980 et 1990, ils prennent les traits asiatiques évoquant à la fois l’opposant politique vietnamien, le communiste chinois et le concurrent technologique japonais. Les attentats du 11 septembre remettent en avant la figure de l’ennemi moyen-oriental. En effet, les personnages perçus comme arabes dans les films hollywoodiens ont depuis toujours souffert d’une représentation négative : soit ils convoitent les femmes blanches, soit ils ont une propension au terrorisme. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, les conflits israélo-arabes irriguent l’iconographie du méchant Arabe. De même, le choc pétrolier de 1973 et l’augmentation du prix de l’essence sont à l’origine d’une recrudescence des rôles d’Arabes terroristes dans les années 1970 et 1980. Mais, la situation s’est aggravée depuis les années 2000 avec la diffusion massive sur les plateformes de séries comme Homeland. Cependant, Hollywood n’a pas le monopole de la représentation raciste. Ainsi, l’industrie bollywoodienne s’inscrit dans une logique de colorisme, c’est-à-dire de discrimination des individus en fonction de leur couleur de peau ou de la texture de leurs cheveux, l’idéal étant l’individu blanc. De même en Chine, la segmentarisation ethnique et la polarisation entre les cultures dominées (les minorités) et la culture dominante (les Hans) aboutissent dans le domaine cinématographique à l’autonomisation d’un ensemble de films constituant presque un genre propre au cinéma chinois à savoir les shaoshu minzu pian ou « films des ethnies minoritaires ». Leur production s’est développée dans les années 1950 et 1960 en grande partie à l’initiative du Parti communiste chinois qui y voyait un levier de cohésion et de promotion nationale : ils sont alors tournés par des Hans en mandarin et donnent aux non-Hans des traits généralement négatifs. Il faut attendre les politiques d’ouverture des années 1980 pour que des films tournés par des minorités ethniques apparaissent sur le devant de la scène. La production s’accélère au cours des années 2000-2010 avec une section qui leur est dédiée au sein du Festival international du film de Beijing. Les autorités chinoises ont mis en place en 2013 un plan d’action national pour encourager la production de films par les ethnies minoritaires et disposer chaque année d’un « grand film chinois » mettant en lumière une ethnie minoritaire. Le but est aussi de développer le cinéma chinois sur le marché international, notamment par les festival, et ainsi offrir un point de vue contraire aux médias occidentaux critiquant la politique répressive des autorités chinoises ainsi que de faire la promotion du tourisme en Chine.
Pour terminer, Chloé Delaporte analyse comment le cinéma permet aux Etats de se construire une image de marque et en quoi il est le levier d’un soft power. Ainsi, Hollywood est le lieu de fabrication zt de diffusion de l’American way of life. En effet, après 1945, les Etats-Unis tirent profit de leur position pour imposer leurs films qui se font alors la tribune du consumérisme dans la société américaine. L’enjeu est alors aussi bien idéologique (identifier le modèle américain aux idées de croissance économique et de prospérité matérielle face au modèle communiste) que commercial (favoriser l’export de produits de consommation). Les films hollywoodiens construisent une américanité idéalisée fondée sur l’idée que la vie de l’Américain moyen est plus confortable que celle des autres. La promotion de cet art de vivre américain passe autant par les représentations que par la forme cinématographique : les films hollywoodiens sont eux-même le produit de cette américanité et reconnus comme tels par les publics étrangers. De son côté, l’industrie cinématographique et audiovisuelle japonaise peut depuis les années 1980-1990 compter sur l’animation (« japanimation ») pour se promouvoir à l’international. Elle accède même à la reconnaissance artistique occidentale au début du XXIème siècle quand Le Voyage de Chihiro d’Hayao Miyasaki est le premier film d’animation à remporter l’Ours d’or à Berlin. La majorité de la production japonaise des années 1980-1990 était plutôt « culturellement neutre » avec des personnages dépourvus de traits distinctifs ethniques ou culturels. Mais, depuis les années 2000-2010, on assiste à une forme de re-japonisation des contenus. Ca correspond au moment où le gouvernement nippon met en œuvre un plan d’action ayant pour but de faciliter l’exportation de produits culturels : le « Cool Japan ». C’est en partie pour répondre à cette stratégie nippone que la Corée du Sud déploie depuis plusieurs années une stratégie similaire en s’appuyant sur phénomène Hallyu. Ce phénomène est le résultat de la mise en œuvre de politiques publiques, stimulant l’entreprenariat privéet libéralisant la production culturelle. Le succès vient d’abord de la diffusion des k-dramas, puis de la k-pop en Asie. Dans les années 2000, le phénomène déborde les frontières asiatiques grâce à un arsenal de politiques publiques chargées de stimuler et « marketer » la production culturelle à destination de l’international. Cette stratégie accompagnée d’une plus vaste campagne de nation branding (« Dynamic Korea »)permet désormais à la Corée du Sud d’affirmer son soft power sur la scène internationale.
A l’heure des plateformes
Dans cette dernière partie, Chloé Delaporte se demande si les plateformes signent la fin du cinéma. L’auteur s’intéresse d’abord au marché mondial de la vidéo à la demande. Ce dernier est dominé par une poignée de plateformes américaines dont la plupart (hormis Netflix) sont des acteurs issus du système des studios hollywoodiens. La Chine est le seul « gros » marché du cinéma à ne pas avoir accès aux services de vidéo à la demande américains. Le marché chinois est dominé par les plateformes iQIYI, Youku et Tencent Video qui appartiennent aux BATX. Mais, les pays interdisant les services américains ne sont pas les seuls à se doter de plateformes nationales. C’est le cas en Asie (Japon, Corée du Sud, Vietnam) mais aussi en Amérique du Sud (Mexique, Brésil). En Europe, des plateformes locales tenant compte des spécificités cinéphiliques réussissent à s’imposer et les diffuseurs télévisuels se regroupent pour proposer des offres alternatives. Le continent africain est encore peu consommateur de SvoD mais des plateformes autochtones s’y développent néanmoins (comme la nollywoodienne IrokoTV). Le développement de certaines plateformes à l’échelle mondiale n’aboutit pas à la production de contenus déterritorialisés : la demande est forte pour les séries ancrées dans une culture étrangère que les services de vidéo à la demande cherchent à acquérir par tous les moyens. Outre l’acquisition des droits, la stratégie de Netflix pour offrir des contenus étrangers est depuis quelques années de produire directement du contenu localisé grâce à la collaboration avec des sociétés de production autochtones. Cette politique de « glocalisation » est le résultat d’une connaissance améliorée du goût des utilisateurs grâce à la collecte de leurs données personnelles. Les services de SvoD ont aussi besoin d’entretenir leur prestige et leur notoriété en tentant d’accéder aux festivals et prix cinématographiques. De ce point de vue, les séries « de plateforme » ont moins de difficultés à accéder à la reconnaissance que les films « de plateforme »
L’auteur s’intéresse ensuite aux zones de tension juridique qu’a réactivé l’arrivée des acteurs du numérique dans le monde du cinéma et de l’audiovisuel. C’est le cas notamment de la question de « la chronologie des médias », c’est-à-dire les dispositions nationales régulant la temporalité de sorties des films en différents supports d’exploitation. Dans la plupart des pays libéraux, comme aux Etats-Unis, celle dépend d’accords contractuels entre les acteurs de l’industrie. Dans l’UE, les pratiques différent d’un pays à l’autre. Ainsi, la France est le pays disposant de législations les plus contraignantes. Dans le cadre des accords en France, Netflix bénéficie d’une position relativement privilégiée car c’est la seule plateforme à les avoir signés et car elle a accepté d’investir dans la production de contenus français comme tous les autres diffuseurs de films. Concernant la propriété des œuvres cinématographiques et audiovisuelles deux grands modèles s’affrontent : celui comme en France des droits d’auteur et celui comme aux Etats-Unis du copyright (les droits sont possédés par le producteur ce qui fait que la rémunération des auteurs dépend des conventions collectives et accords signés entre les producteurs et les auteurs). L’arrivée des plateformes numériques a réactivé le débat sur le partage et le respect des droits. L’UE a pris une Directive sur droit d’auteur et les droits voisins dite « Directive Copyright ». Elle oblige notamment Google à mieux rémunérer les créateurs des contenus sur Youtube en signant des contrats de droits d’auteur. D’un point de vue général, empêcher la contrefaçon audiovisuelle est devenue la principale lutte des détenteurs de droit avec un enjeu avant tout industriel : la mise au point de technologies de cryptage permettant la protection des contenus.
Chloé Delaporte note aussi que l’émergence des plateformes coïncide avec un intérêt pour la valorisation de la « diversité ». Les plateformes de vidéo à la demande ciblent en particulier les jeunes générations et essaient de se calquer sur les évolutions contemporaines. Ainsi, Netflix se démarque par des représentations plus inclusives : les identités minorisées y sont plus visibles que dans les séries « network ». Mais, selon l’auteur, ces évolutions ne doivent pas être prises comme l’indication d’une réelle remise en cause idéologique. D’une part, car cette remise en cause porte sur les conséquences (les discriminations) et non sur les causes. D’autre part, car l’inclusivité promue reste superficielle. Enfin, car la diversité ne concerne pas le recrutement et le management des entreprises concernées.
L’auteur termine en s’interrogeant sur l’avenir du cinéma dans toutes ses dimensions (art, pratique culturelle, industrie, média …). Elle note tout d’abord que la fin du cinéma est une rhétorique ancienne qui ressurgit à chaque « crise », notamment quand les entrées en salle chutent ou quand de nouvelles technologies (magnétoscope, internet) ou médias (télévision, plateformes) apparaissent. En fait, la récurrence de cette rhétorique a pour effet de maintenir un imaginaire social autour de la salle comme lieu sacralisé de consommation de films. Or, l’apparition des plateformes a entraîné plus un déplacement de la télévision vers celles-ci que de la salle vers les plateformes. En réalité, les discours alarmistes sur l’avenir du cinéma repose entre autre sur une idée reçue qu’il existerait une concurrence entre salle, télévision et plateformes. Cette idée mérite d’être interrogée car, d’une part, les acteurs de ces différentes filières sont en partie les mêmes. D’autre part, ces acteurs ne peuvent conduire leur activité qu’en collaborant. Enfin, car les intérêts économiques de ces acteurs sont au final strictement les mêmes. Il y a donc plus aujourd’hui de concurrence entre les Etats qu’entre les différents acteurs du secteur du cinéma et de l’audiovisuel.
Mon avis
Ce livre met en avant que la « plateformisation » touche tous les secteurs du cinéma. Elle rebat partiellement les cartes du marché mondial du film tout en changeant les usages des consommateurs sans impliquer de réelle restructuration des rapports de force. En effet, les Etats-Unis y maintiennent leur position hégémonique. De plus, le cinéma conserve toujours sa forte dimension géopolitique avec à la fois sa stratégie de propagande et sa stratégie économique qu’elles soient mises en place par des Etats ou des acteurs privés.
On pourra regretter que certaines parties du livre (comme celles sur la diversité par exemple) sortent un peu du champs purement géopolitique et que l’auteur nous fasse part de quelques avis personnels pas toujours nuancés sur certaines œuvres (Zero Dark Thirty ou Fauda sont plus subtiles que la présentation faite par Chloé Delaporte). Mais, d’un point de vue général, le livre est très intéressant, écrit dans un français très accessible et s’appuie sur des exemples précis et récents. Il trouvera donc largement sa place dans les CDI de lycée afin d’être exploité en spécialité HGGSP (notamment sur les notions de puissance, d’information et de diffusion de la connaissance) mais aussi en spécialité et en BTS Cinéma-audiovisuel.