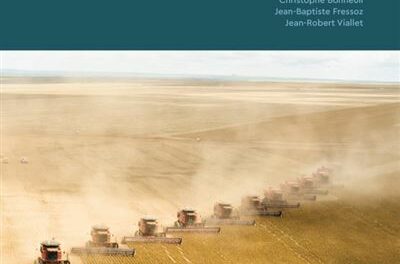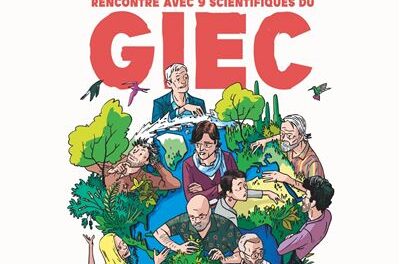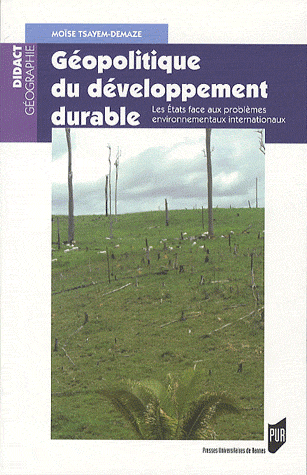
La couverture n’est pas très engageante : d’une pelouse en partie mitée où broutent quelques bovins émergent des souches et des troncs sans feuillage ; l’impression de désolation laissée par la déforestation de ce coin d’Amazonie n’incite guère à l’optimisme. Et quelques semaines avant la conférence de l’ONU sur le changement climatique, les chances d’un nouveau souffle pour les politiques internationales de développement durable semblent limitées. Ces politiques auraient pourtant besoin d’une sérieuse redéfinition à en croire le dernier ouvrage de Moïse Tsayem-Demaze.
Maître de conférence à l’Université du Maine où il a enseigné pendant six ans le développement durable, l’auteur exprime peut-être avant tout ici son expérience de chercheur de terrain. Il a parcouru les forêts tropicales de la Guyane au Cameroun en passant par le Parà au Brésil et il y est entré dans la complexité des facteurs naturels et humains qui agissent sur la dégradation de l’environnement. C’est ce miroir du terrain qui donne à cet ouvrage de géopolitique consacré aux relations entre états et à l’action internationale sur le développement durable son intérêt particulier et ce regard critique constant.
La désertification et la déforestation comme clés de compréhension de la dégradation de l’environnement.
.
L’ouvrage est divisé en trois grandes parties. La première décrit les différents types d’atteinte à l’environnement. Si M. Tsayem-Damaze commence classiquement par présenter les changements climatiques, leur mécanismes et les scénarios du GIEC, il n’y consacre finalement qu’une quinzaine de pages qui peuvent d’ailleurs constituer une synthèse commode. C’est avec le chapitre suivant sur les atteintes à la biodiversité que l’auteur se rapproche de son terrain de prédilection: les zones intertropicales. Si la biodiversité est définie et son histoire retracée, Moise Tsayem-Demaze insiste sur la concentration de ses « points chauds » dans les espaces intertropicaux. Il expose les inquiétudes et les incertitudes sur l’affaiblissement de la biodiversité du aux hommes qui ont conduit à la création d’une plate-forme internationale; celle-ci (IPBES) est destinée à jouer un rôle d’analyse et d’information comparable à celui du GIEC pour le climat.
La déforestation, au cœur des recherches de l’auteur, est replacée dans l’ensemble des atteintes à l’environnement avec lesquels elle partage des liens étroits: la déforestation crée un surplus d’émission de gaz à effet de serre (GES), porte des coups à la biodiversité, peut conduire à une dégradation des sols. Comme les autres formes d’atteintes, elle s’inscrit dans un contexte politique, économique et social qui la favorise. Si les efforts de reboisement, notamment dans la zone intertropicale, sont rappelés, l’auteur s’inquiète de la transformation des espaces forestiers, enjeux de politiques de développement durable qui sont évoquées dans la dernière partie du livre.
Un dernier chapitre, sur la désertification en explique les mécanismes spécifiques mais insiste là encore sur les liens avec le changement climatique et l’érosion de la biodiversité; l’auteur déplore pourtant que les politiques de développement durable semble moins s’intéresser à ces enjeux qui pourraient concerner la population habitant les zones sèches, soit près du tiers de l’humanité.
Le grand flou conceptuel et les ambiguïtés du développement durable.
Du cri d’alarme du club de Rome au rapport Bruntland créant la notion de développement durable, du sommet fondateur de Rio aux conventions et protocoles d’action nés de sommets plus récents, le discours du développement durable a pris de l’ampleur et s’est finalement inscrit dans les relations internationales: les propos mesurés de l’enseignant du supérieur retracent d’une façon pratique les origines, la genèse, les évolutions de la notion et de leur dimension internationale, mais le chercheur débusque le ver dans le fruit lors de cette deuxième partie: il existe plusieurs acceptions de la notion de durabilité et les politiques de développement durables sont souvent fondées sur un rapport un peu simpliste établi entre le niveau de développement et le degré de dégradation de l’environnement: la courbe environnementale dite de Kuznets indique que la dégradation de l’environnement s’accroit jusqu’à un certain niveau de développement; puis, la courbe s’inverse.
Mais outre le fait que le seuil est variable selon les auteurs, M. Tsayem-Demaze semble douter de l’effet mécaniquement positif du développement á un niveau élevé; il souligne au contraire l’ampleur des efforts à accomplir par les pays développés et les pays émergents pour concilier niveau de développement élevé et Empreinte écologique (EE) raisonnable; il doute plus encore des conséquences géopolitiques de la courbe de Kuznets: au nom de la responsabilité principale des pays développés dans les atteintes déjà perpétrées a ce jour, les politiques de développement durable les obligent seuls a faire l’essentiel des efforts en laissant les pays en développement atteindre tranquillement le stade où il deviendront vertueux, forcément vertueux, quelques transferts de moyens et de technologie devant les aider à accomplir cette mutation.
Les pays développés peuvent ainsi investir dans des programmes mis en place par les conventions issues des accords de Copenhague et de Cancun comme la Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation forestière (REDD): il participent à l’effort de reforestation ou de conservation du stock forestier de pays du sud. Mais dans le cas du mécanisme de développement propre(MDP), issu du protocole de Kyoto où seuls les pays développés sont contraints de limiter leurs émissions de GES, leurs investissements dans les pays en voie de développement permettent d’alléger l’effort en augmentant leur ‘permis de polluer’. Le compromis onusien auquel les désaccords nord-sud ont abouti comporte donc selon l’auteur un double risque de dérive: celui que les logiques économiques et financières l’emportent sur les objectifs écologiques et celui que les efforts décidés et finalement consentis soient trop modestes au regard des enjeux.
La dérive économiste des politiques internationales de développement durable.
Dans la dernière partie du livre, MDP, REDD+ et certification forestière sont passés au crible. Si les fondements scientifiques et conceptuels des politiques internationales de développement durable semblent peu solides, les dérives viennent également du recours aux transferts, notamment des pays développés aux pays en voie de développement. L’analyse de la répartition par secteur des projets de MDP, favorisant les industries énergétiques où l’on peut gagner facilement des crédits carbone, montre des déséquilibres que ne corrigent guère, loin s’en faut, la répartition géographique; celle-ci dévoile que les pays émergents profitent le plus du MDP (50% pour la Chine!) donnant ainsi une prime à leur dynamisme.
Les mêmes doutes concernent les politiques de REDD: elles sont le fruit d’un compromis entre les pays développés, surtout soucieux des changements climatiques et de pays en voie de développement pourvus de vastes forêts tropicales. Le principe est de récompenser, financièrement la lutte contre la déforestation. Ces projets sont décrits à différentes échelles, M. Tsahal-Demaze évoquant le programmes mis en place dans les états du Brésil. Mais cette logique de rémunérer les GES évités conduit un peu plus , selon l’auteur, à faire du CO2 un produit marchand alors qu’il était considéré comme une nuisance; sa valeur est fixée avec des calculs qui n’ont plus grand chose à voir avec la complexité du fonctionnement des forêts tropicales ou des mécanismes de leur mise en danger, tels que les étudie M. Tsayem-Demaze.
Quant à la certification forestière, qui garantit que le bois acheté provient de forêts bien gérées, elle ne concerne que de façon marginale les forets tropicales où les menaces semblent pourtant le plus présentes. Elle semble tout au plus un outil de marketing où deux certifications concurrentes PEFC et FSC. se partagent le « marché » dans les pays développés, alors que les émergents, notamment asiatiques, continuent à se fournir en bois tropical… sans certificat.
Bien sûr, le livre de Moïse Tsayem-Demaze peut se présenter comme une approche géopolitique, car il confronte le jeu des différents acteurs: l’ONU, les groupes d’états, les états et certaines régions sans oublier les ONG. Mais on a tout de même l’impression que le propos est ailleurs : un réquisitoire qui se durcit dans les deux dernières parties du livre contre des politiques internationales fondées sur des compromis ambigus et non sur une approche scientifique qui devrait être approfondie, ne serait-ce que pour lever les parts d’incertitude sur l’ampleur des dégradations et pour saisir la complexité des mécanismes naturels économiques et sociaux en œuvre.
Enseigner, c’est souvent partir au combat. Paradoxalement, ce réquisitoire contre le grand flou du développement durable peut convaincre les plus usés d’entre nous, les plus blasés par l’enseignement de cette tarte à crème tombée dans les programmes de géographie à utiliser les outils de notre discipline pour aborder avec les élèves ces enjeux devenus majeurs dans le monde où il grandissent. Il y a dans cet ouvrage non seulement beaucoup d’outils documentaires, mais surtout des approches stimulantes, en particulier celles qui peuvent inciter à parler à nos collègues de SES ou de sciences pour des approches pluri-disciplinaires.
Marc Lohez © Les Clionautes