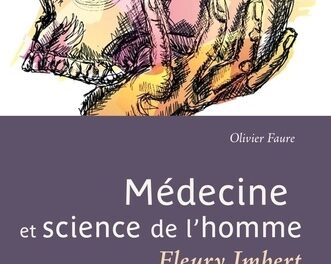Il y a ceux qu’illuminent les lumières du pouvoir et les phares de la notoriété ; et il y a les gens de l’ombre qui les conseillent et les influencent depuis les coulisses. Naviguant entre ces deux rives, le parcours de Georges Albertini est l’illustration étonnante des passions équivoques et des inspirations secrètes qui nourrissent la vie politique. Fleuron de la Collaboration de Gauche, longtemps minimisée, cet anticommuniste obsessionnel parvint à devenir, après une expiation clémente, une éminence grise fréquentée par une grande partie de la classe politique depuis les années cinquante jusqu’à l’alternance de 1981.
Directeur de l’Institut d’histoire sociale, qui a hérité de la majeure partie des archives privées d’Albertini, Pierre Rigoulot était particulièrement bien placé pour mettre en lumière la personnalité et la carrière de ce personnage singulier. La biographie qu’il en livre dresse non seulement un portrait à la fois mesuré et rigoureux d’Albertini mais projette aussi, par ricochet, un éclairage révélateur sur plusieurs décennies de vie politique française.

Un jeune espoir de la gauche
Jeune pousse de la gauche socialiste de l’avant-guerre, Abertini est d’origine sociale modeste. Intellectuel issu du terreau fertile de l’enseignement, ce pur produit de la méritocratie scolaire de la IIIe République devient professeur en École Normale. Très introduit dans les réseaux de la gauche non communiste, il est un militant politique et syndical énergique et suractif. Engagé à la SFIO et à la CGT, il est rédacteur de presse, conférencier et homme de radio. Dirigeant socialiste local du département de l’Aube auprès du futur grand résistant Pierre Brossolette, il est membre du CVIA et participe aux Décades de Pontivy. Prototype du socialiste gestionnaire et du pacifiste munichois, il est également antiparlementariste et profondément anticommuniste. La haute opinion qu’il professe de lui-même le porte peu à l’autocritique sur ses choix et engagements. En 1940, il s’engage ainsi en toute certitude d’être dans le vrai sur le chemin fangeux de la Collaboration d’idées.
Un ténor de la Collaboration
Pierre Rigoulot analyse avec beaucoup de soin les activités et les références idéologiques de son « héros » au cours de cette période. À travers le cas Albertini, se dessine un panorama de la gauche collaborationniste, à la fois foisonnante et groupusculaire. L’enseignant devient le secrétaire général du RNP, où il est le bras droit de Marcel Déat. Le partage des rôles reflète la personnalité des deux hommes : Déat est le penseur et la vitrine du parti, Albertini en est la véritable cheville ouvrière et le maître de l’appareil. En 1944, il suit son mentor à Vichy et y est son directeur de cabinet au Ministère du travail.
La pensée politique d’Albertini sous l’occupation est un curieux mélange d’opportunisme, de fidélité aux valeurs de gauche et d’affinités superficielles avec le nazisme. La cohérence et la continuité idéologique avec ses convictions d’avant-guerre sont réelles. À la fois réformiste partisan de la «politique de présence» et adepte d’un socialisme national et autoritaire, il cultive tous les « antismes » : antisémitisme, antimaçonnisme, antiparlementarisme et anticapitaliste. Hostile au conservatisme social du régime de Vichy, il rêve de greffer une révolution sociale sur la Révolution nationale. De façon saisissante, Pierre Rigoulot démasque les chimères d’une pensée de gauche dévoyée dont le robespierrisme perverti assimile révolution jacobine et révolution nazie…
À la Libération, Albertini refuse de suivre Déat à Sigmaringen. Arrêté, il est traduit devant les tribunaux de l’épuration. Bénéficiant des omissions d’une instruction bâclée et d’un panel de témoins favorables, l’ex N°2 du RNP met en œuvre une défense adroite et même audacieuse. Il arrache un verdict étonnamment clément et est élargi après avoir purgé trois ans et demi seulement de détention.
L’éminence grise de l’anticommunisme
Peu repentant mais très adaptable, Albertini n’a rien perdu de son énergie et de sa passion pour la politique. Sur le plan professionnel, il rebondit comme conseiller en entreprise. Sur le plan politique, il choisit de ressusciter dans l’ombre. La ferveur anticommuniste qui lui sert de boussole et les contacts qu’il a conservés auprès de ses amis politiques d’avant-guerre lui tiennent lieu de sésame.
Sa vision politique évolue rapidement : sans véritable remise en cause de son passé collaborationniste, il se convertit au libéralisme et à l’atlantisme, puis au gaullisme. Il se positionne en expert de la lutte anticommuniste. En 1951, il fonde un laboratoire d’idée subventionné par la CIA et les milieux du patronat français. Il y recrute comme experts des relaps du PCF passés par la Collaboration (notamment le duo Barbé et Célor), des réfugiés d’Europe de l’Est et des recyclés du RNP. Il s’assure la respectable collaboration de Boris Souvarine. La connaissance intime du système communiste et de sa désinence française possédée par ce cénacle nourrit des analyses très documentées diffusées auprès des décideurs politiques. L’officine est très bien introduite et a ses entrées à droite comme à gauche, notamment auprès des anciens camarades d’Albertini à la SFIO et dans le syndicalisme.
Albertini arpente trois décennies durant les allées du pouvoir, où on lui concède une forme d’honorabilité honteuse. Fort d’un grand pouvoir de séduction intellectuelle, ce donneur d’idées, qui possède de riches qualités de travail et d’analyse ainsi qu’un solide entregent, fraye avec tous les milieux politiques. Il entretient des contacts syndicaux et a des échanges réguliers de bons offices avec les services secrets. Il nourrit des relations régulières avec tout un réseau de correspondants étrangers, de l’Espagne à la Hollande en passant par le Vatican.
Développant une vision stratégique globale de lutte contre le communisme, il rend des services précieux et variés : analyses de situation, participation aux campagnes électorales, travail de contact et d’influence auprès des responsables politiques, syndicaux et étudiants, production d’une abondante littérature anticommuniste d’information et de propagande (brochures, périodiques confidentiels, feuilles spécialisées, tracts).
Son carnet d’adresse est impressionnant. Glissant de la gauche modérée aux gaullistes, Albertini conseille tour à tour Edgar Faure, Georges Bidault, Georges Pompidou et Jacques Chirac, et noue des contacts – pas toujours concluants – avec Guy Mollet, François Mitterrand, Pierre Poujade et quantité de barons de moindre envergure au sein de la gauche modérée et de la droite. Cassandre de moins en moins audible de la hantise anticommuniste, il a la dernière frayeur d’assister à la victoire de Mitterrand, derrière laquelle il voyait le spectre d’un avènement des communistes au pouvoir…
Malgré le petit regret né de l’absence de tout cahier illustré, la lecture de cette biographie est assez palpitante. Georges Albertini, socialiste, collaborateur, gaulliste : ce triptyque improbable signe-t-il une destinée hors norme ? Suivre l’itinéraire politique de cet intellectuel du XXe siècle en souligne en fait les limites : l’obstination y tient lieu d’efficacité et l’obsession de cohérence. La vérité de Georges Albertini est sans doute à chercher dans la constance de son opportunisme historique.