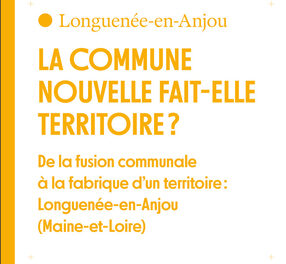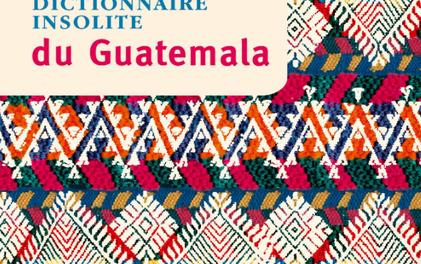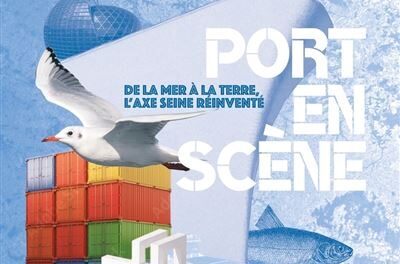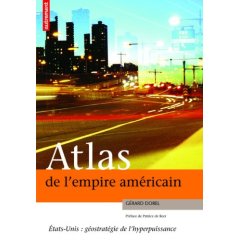
Le défi du livre est donc en 80 pages de présenter des cartes et de parler de la géostratégie d’une hyperpuissance incontournable, objet de fascination ou de rejet.
L’entrée par les cartes et les documents permet, au-delà des querelles idéologiques, de livrer des informations sur la puissance des Etats-Unis, quel que soit l’adjectif qu’on souhaite y ajouter.
A ce titre, une utile introduction de Patrice de Beer situe les enjeux du livre. » G Dorel nous fournit les éléments pour nous faire notre propre idée…. non pas globalement mais point par point. »
Trois parties d’inégales longueurs composent l’ouvrage : tout d’abord la construction de l’empire puis la puissance du business et la séduction du modèle et enfin l’empire défié depuis 1989.
Ce plan est pratique, alternant une profondeur historique et des constats actuels.
Dans la première partie donc, relativement brêve (une dizaine de pages), c’est l’histoire des Etats-Unis qui est racontée, survolant le XIX ème siècle et les guerres, qu’elles soient froides ou mondiales.
Dans la seconde partie sont évoqués tous les aspects de la puissance des Etats-Unis : les hautes technologies, l’aérospatiale, les firmes et la puissance commerciale, le dollar, la culture de masse.
Au passage, les auteurs nuancent certaines certitudes : » Les firmes multinationales ne sont cependant plus aussi dominantes que dans les années 1960 et 1970. Nombre d’entre elles ont disparu de la liste suite à des fusions ou parce qu’elles ont été absorbées par des sociétés étrangères, européennes ou japonaises. Les nouvelles filiales américaines de ces dernières sont cependant souvent devenues plus importantes que leurs maisons mères. «
De la même façon les auteurs nuancent le « cauchemar hispanique » de Samuel Huntington : « Frederik Douzet (Herodote 2006) dit combien ce groupe linguistique est hétérogène, ethniquement, socialement, politiquement. »
La troisième partie est davantage stratégique, traitant les défis que les Etats-Unis doivent relever.
Il faut dire ici que certaines cartes ne sont pas forcément indispensables. Le format de la collection implique d’aller à l’essentiel et la carte de la page 65 sur « les forces nucléaires stratégiques : planifier l’apocalypse « est peut-être trop détaillée.
Signalons combien sont pratiques les petites pastilles avec des citations qui parsèment l’ouvrage. Elles condensent parfois en une formule une idée que les documents montrent.
Positive également est la multiplication de mini croquis plutôt bien faits. Ainsi l’agro-industrie en quelques documents permet d’aborder l’essentiel du sujet.
L’avantage c’est aussi une foule de chiffres, certes pas tous de la même date, mais tous relativement récents. Cela permet d’ actualiser ainsi un thème même si, sur le fond, il n’ y a pas de grosse remise en question.
Alors, certes, le format de l’atlas ne peut offrir plus que ses contraintes : souvent les encarts sont réduits, certains diraient squelettiques. D’autres encarts proposés par l’atlas apportent peu à la compréhension d’ensemble du sujet ; ainsi les caractéristiques du B52 et la localisation des bases B 52 pendant la guerre froide.
Petit détail pratique : les sigles et abréviations se situent dans un tiers de colonne page 79, alors soyez attentif pour ne pas les rater !
Enfin notons des titres parfois maladroits comme à la page 18 19 à propos de la guerre froide :
» les Etats-Unis confrontés » ?
Au final, et malgré ces points de détails, cet ouvrage rendra de grands services aux enseignants pour la conception des chapitres sur les Etats-Unis. Il permettra aussi de mettre des faits, des chiffres derrière de grandes idées générales sur les Etats-Unis.
Compte-rendu de Jean-Pierre Costille
———————–
Compte-rendu de Jean Philippe Raud Dugal
Gérard Dorel est Inspecteur Général honoraire de l’Education Nationale. Ancien professeur de géographie des Etats-Unis à l’Université de Paris-I, il a publié « la Puissance des Etats », premier recueil du genre, à la Documentation photographique en 1998. Son ouvrage intervient dans un contexte riche sur la question avec le récent Festival International de Géographie de Saint-Dié dont le thème était: « Les géographes redécouvrent les Amériques » et peut à plus d’un titre compléter la sortie de la Géopolitique des Amériques (Nathan 2006) voir le CR->http://www.clionautes.org/?p=1120
Gérard Dorel choisit de définir dans sa préface l’hyperpuissance américaine dont Hubert Védrine, ancien Ministre des affaires étrangères, a usité le terme pour le recueil de ses discours du temps ou il avait la charge de la diplomatie française. Ses fondements sont à chercher du côté de ses mythes fondateurs, de sa puissance technologique,… Ils doivent pour rester cette hyperpuissance, combiner, selon l’auteur, des objectifs contradictoires à savoir conserver une place éminente en Europe, « lieu privilégié de l’influence économique et culturelle » (p.9), en même temps que repenser leur influence en Amérique Latine (Voir la conférence de F. Leriche et M. Guibert à St Dié qui confirme cette thèse) et leur attitude vis-à-vis de la Chine sans oublier les besoins en pétrole alimentant des enjeux géopolitiques et géostratégiques majeurs.
La première partie, « La construction d’un Empire » propose une partie historique développée autour de ces problématiques. Puissance qui se veut dès l’origine anti-impérialiste puisque étant elle même une ancienne colonie, ce titre peut surprendre mais il se veut une analyse de la réalité qui fait fi des discours officiels.
Cet impérialisme est contenu en germe dans la conquête de l’Ouest américain (une carte supplémentaire sur l’expéditions du Corps de la Découverte à partir de 1804 menée par Lewis et Clark aurait était un plus incontestable). Le but est de gagner en influence essentiellement sur le continent américain. Dans ce contexte, la construction du Canal de Panama peut être « conçu comme une élément essentiel du dispositif de défense des Etats-Unis ». A partir de 1898, le Pacifique devient progressivement le terrain de jeu privilégié de sa puissance. Les différentes guerres lui permettront de rayonner à 360°. Enfin, la Guerre Froide lui permet d’étendre son influence avec un système d’alliance de plus en plus élaboré.
Gérard Dorel entreprend ensuite d’étudier les fondements géopolitiques, géostratégiques et géo-économiques de l’hyperpuissance américaine. Cette partie, « Puissance du business et séduction du modèle » est entamée par l’étude du RNB et de la puissance technologique. « C’est leur capacité à trouver de nouveaux produits et à les diffuser à l’échelle mondiale quitte à en abandonner rapidement la production à d’autres » (p.23) qui fonde la stratégie économique mondiale des Etats-Unis. Cette capacité est largement liée aux très nombreux prix Nobel obtenus par les chercheurs étasuniens (nous l’avons encore remarqué avec une grande acuité cette année encore). L’auteur prend ensuite de nombreux exemples des réussites de l’industrie américaine pour corroborer ses dires. Il en conclu à une redistribution du territoire même si on peut regretter qu’il n’ait pas fait mention des difficultés des industries sidérurgiques et, surtout, automobiles. Gérard Dorel insiste ensuite sur la façon dont le credo libre échangiste est appliqué dans le monde sous la forme d’accords multilatéraux (ZLEA [en latence depuis l’échec des négociations fin 2005 tout de même], ASEAN… Cet empire se fonde ainsi sur le dollar et sur sa puissance agro-industrielle considérés comme des armes stratégiques pour les Etats-Unis. Les OGM sont, dans cette perspective, au cœur d’une bataille géopolitique majeure. De plus, le pétrole est au cœur des préoccupations géostratégiques avec comme impératif principal de sécuriser les approvisionnements (le redéploiement américain dans le golfe de Guinée aurait là aussi pu être souligné. Mais comme pour les autres remarques, les choix d’éditions doivent être compliqués à faire en 80 pages). Enfin, l’auteur envisage le rôle de l’ « american way of life » dans l’attrait des nouveaux migrants s’accompagnant progressivement de l’hispanisation du continent, mais aussi dans la diffusion du modèle culturel américain par l’intermédiaire des médias mais aussi celui des églises évangélistes.
La dernière partie, « L’Empire défié : la nouvelle donne depuis 1989 », analyse tout d’abord la puissance militaire actuelle des Etats-Unis en éclairant les relations complexes entre le gouvernement et le complexe militaro-industriel. Gérard Dorel expose ainsi les quatre options majeures de la politique de défense américaine : la dissuasion nucléaire, la sanctuarisation du territoire, la lutte antiterroriste et la capacité de projection de ses forces partout dans le monde. Depuis la fin de la Guerre Froide on assiste à un redéploiement vers la Moyen-Orient. De même, plus encore qu’avant, le Pacifique est considéré comme « un lac américain ». Depuis le début de ses ambitions universelles, le continent américain est une constante de la politique extérieure et intérieure américaine au niveau militaire mais aussi économique. Le problème actuel de la cocaïne est évoqué comme celui des maquiladoras. Malgré tout, l’Empire est défié depuis le 11 septembre 2001, date qui apparaît comme l’entrée vers« une nouvelle forme de conflit qui remet en question leur posture géostratégique, déstabilise leur armée et leur diplomatie » (p. 72). Enfin, l’ouvrage se clôt pas une carte de l’américanophobie dans le monde, sorte de bilan qui pourrait être mal compris en document brut mais, le ton général de l’ouvrage ne laisse aucun doute sur ses intentions.
L’Atlas de l’Empire américain fournit des cartes d’une excellente qualité grâce à Madeleine Benoît-Guyod, cartographe-géographe, et ont l’avantage d’offrir de très nombreuses approches multiscalaires. Une bibliographie assez complète et un lexique tout à fait utile apparaissent comme autant d’outils intéressants pour le lecteur. L’enseignant pourra y trouver des études de cas précises comme celle sur le face à face nucléaire pendant la Guerre Froide (p.20-21) ou encore sur Google, Boeing ou Microsoft et Ford (dans la seconde partie). Le candidat aux concours de l’enseignement auront tout intérêt à consulter cet ouvrage pour une réactualisation minimale de ses connaissances. Plus largement, cet Atlas a tout à fait sa place dans un CDI ou une bibliothèque universitaire.