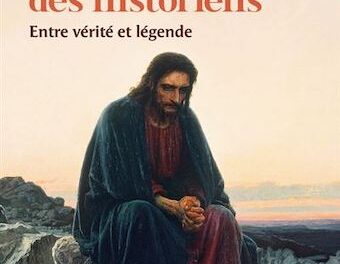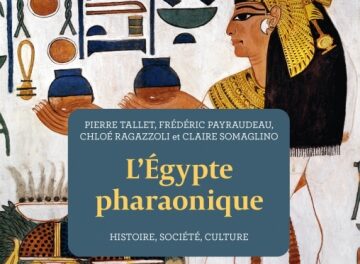Quiconque s’intéresse un tant soit peu à l’histoire de l’art, ou s’est simplement trouvé un jour à la recherche d’un recueil commode en matière d’iconographie dans ce domaine, ne peut que connaître la collection L’Univers des Formes. Née de la volonté d’André Malraux, qui réussit à s’attacher quelques collaborateurs talentueux et audacieux, elle devait donner lieu à la publication par Gallimard de 42 volumes entre 1960 et 1997. 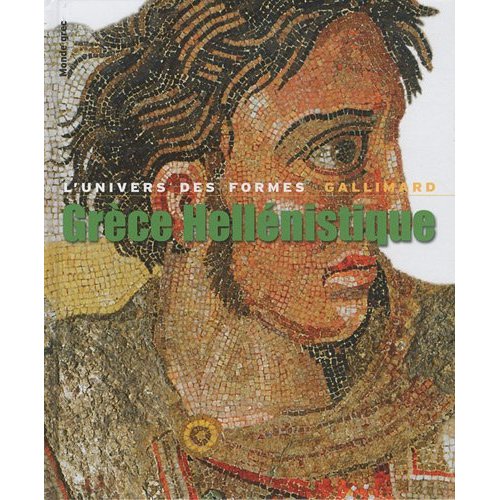
Toutes ces caractéristiques se retrouvent donc dans le présent ouvrage, consacré à la Grèce Hellénistique, de 330 à 50 av.J.-C. – Grèce devant s’entendre au sens large : bien plus que la région géographique portant ce nom, c’est évidemment toute l’aire culturelle ouverte à la culture hellénique par les conquêtes d’Alexandre qui est ici embrassée. Originellement publié en 1970, il est du à la plume de trois éminents scientifiques, déjà auteurs de deux précédents volumes s’attachant à la Grèce Archaïque et à la Grèce Classique, et qui ont chacun pris en charge l’une des trois parties qui le composent.
La première (p.22-99) s’intéresse à l’architecture ; elle est l’œuvre de Roland Martin (1912-1997), qui alliait à un riche parcours universitaire l’expérience de nombreuses fouilles en Grèce et en Turquie. En trois temps, il analyse et illustre les évolutions connues dans ce domaine. Si l’Asie Mineure et les îles supplantent comme cadres des ateliers les plus dynamiques l’Attique maintenant affaiblie, l’architecture hellénistique repose encore sur des éléments et des formes hérités de l’époque classique, qu’elle aménage différemment et avec une certaine liberté. L’ordre dorique, trop contraignant, est progressivement réduit à un rôle utilitaire au bénéfice des ordres ionique et corinthien, qui se prêtent mieux au développement d’effets plastiques et picturaux. A l’exemple des réalisations d’Hermogène, les styles se mêlent et les décors se développent. En découlent l’essor des façades monumentales, des architectures funéraire et domestique… Au cours des IIIe-IIe s., l’édifice cesse d’être traité pour lui-même : il est avant tout conçu pour s’intégrer dans une architecture urbaine, dans de grands ensembles monumentaux, qui sont les reflets de la politique de prestige des rois hellénistiques ayant supplanté les cités comme maîtres des destinées du monde grec ; Pergame en est le meilleur exemple connu. Passionnée, ample et subtile, la rhétorique de Roland Martin emporte, parfois égare ; elle est heureusement complétée en fin d’ouvrage par une série de remarquables plans et restitutions (…à laquelle le lecteur néophyte – qu’il nous soit permis de parler en son nom – n’aurait sûrement pas jugé inutile de voir adjoindre un lexique des principaux termes de l’architecture grecque antique, que l’auteur emploie évidemment à foison…)
La peinture est l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage (p.101-203), due à François Villard, archéologue, professeur à l’université Paris X-Nanterre, qui occupa de 1976 à 1983 les fonctions de conservateur en chef du département des Antiquités grecques et romaines du Musée du Louvre. L’auteur se livre à un exposé brillant, mettant en lumière les lignes de force que va connaître cet art sur les trois petits siècles de la période : la conquête progressive, jusqu’au premier quart du IIIè s., de la profondeur, d’un espace à trois dimensions ; l’utilisation de plus en plus poussée d’un cadre architectural puis naturel animé par des jeux de lumière de plus en plus élaborés, dans les décennies qui suivent ; la place grandissante occupée par la représentation de paysages, de scènes de genre, de natures mortes, traités avec un réalisme poussé parfois jusqu’à l’artifice, entre 150 et 50 av.J.-C. Dans beaucoup de domaines de l’Antiquité, nos connaissances actuelles ne reposent que sur l’extrapolation de maigres indices. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne la peinture hellénistique, entrevue principalement à travers des copies réalisées à l’époque romaine (la tragique éruption du Vésuve en –79, en préservant pour les générations futures celles détenues à Pompéi et Herculanum, s’avérant en cela décisive) dont l’attribution repose souvent sur des simples et imprécises mentions littéraires, et un certain nombre d’œuvres originales de second rang (fresques, mosaïques, stèles peintes…) L’auteur ne manque pas de le préciser, et n’omet pas de conserver cette toile de fond mouvante aux conclusions qu’il brosse.
De semblables incertitudes sont pareillement soulignées par Jean Charbonneaux (1895-1969), en poste à partir de 1926 au Musée du Louvre comme conservateur puis inspecteur général des Musées de France, dans sa présentation des mutations connues par la sculpture hellénistique. A partir du IVè s., celle-ci tend, sous l’influence de Lysippe, à s’éloigner de l’abstraction idéalisée pour mieux saisir le mouvement, accentuer le réalisme des physionomies, rendre compte de la personnalité individuelle. Le IIIè s. semble connaître un léger temps d’arrêt, avec le relatif retour de l’allégorie et au modèle classique, que le mouvement vers la réalité finit par rattraper, particulièrement avec le développement d’un puissant foyer d’art à Pergame à la suite de l’émergence politique des Attalides. Celui-ci trouve son apogée avec la réalisation des frises du Grand Autel de Zeus, au début du IIè s., et surtout la fameuse Gigantomachie, synthèse d’une thématique classique, d’influences orientales (qui s’expriment dans la place laissée à l’animalité) et d’une volonté d’authenticité dans la représentation. Toutes ces tendances continuent à s’exprimer et à muter au IIè s., au travers de la vogue des statues drapées, des effigies-portraits, du retour du nu viril idéalisant les souverains de l’époque, … dans un foisonnement un peu anarchique ; foisonnement né, comme la nature duale des réalisations alexandrines l’illustre bien, de l’étendue et de la diversité du monde hellénistique.
Ces trois études contribuent donc à nourrir le même point de vue, clairement développé par R.Martin dans sa conclusion de l’ouvrage : loin d’être une version décadente d’un âge classique supposé idéal, l’art hellénistique en constitue un réel et dynamique perfectionnement, nourri des multiples influences nées de la dilatation de l’espace grec, et dont l’empreinte culturelle paraît indélébile. Certes, on pourra reprocher au texte sa datation (qui lui fait par exemple qualifier de « récentes » les fouilles menées à Aï-Khanoum par la mission Bernard avant l’invasion soviétique de l’Afghanistan) : bien des découvertes importantes issues des chantiers menés lors des quarante dernières années, à commencer par celui des tombes royales macédoniennes de Vergina (découvertes en 1977) et ceux menés à Alexandrie d’Egypte à partir des années 1990, sont ainsi fatalement passées sous silence. La préface rédigée par Jean-Yves Empereur, fondateur du Centre d’Etudes Alexandrines, équipe du CNRS basée dans cette dernière ville et principal animateur des fouilles qui y ont été conduites, compense cependant partiellement cette lacune. Il replace aussi le thème étudié dans son contexte politique (l’interdépendance étant forte, on l’a vu), et apporte par ailleurs de brèves mais intéressantes précisions concernant les techniques et matériaux utilisés et des arts quelque peu négligés dans le reste de l’ouvrage (arts du feu et arts mineurs). Le même souci d’actualiser et de compléter se retrouve dans l’importante mise à jour qu’il apporte à la bibliographie déjà conséquente de l’édition originale.
La somme de ces différentes contributions, comme des qualités initiales qui restent inaltérées (exceptionnelle qualité des photos, parfaitement légendées, bien mises en rapport avec le texte ; présence d’un index, de cartes de localisation des sites…), continuent donc de faire de cette nouvelle édition une référence certaine.