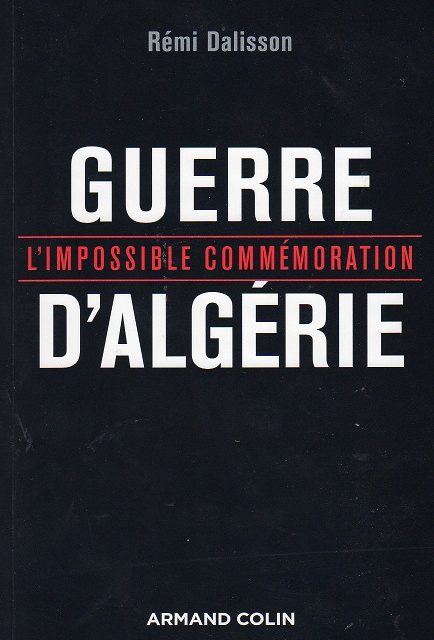Le mercredi 17 octobre 2012, François HOLLANDE, 5 mois après son élection à la présidence de la République, publie ce communiqué : » le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression. La République reconnait avec lucidité ces faits […]. Je rends hommage à la mémoire des victimes. » Puis le 6 décembre 2012 une loi fait du 19 mars la « Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ». Les polémiques sur la mémoire algérienne redoublent alors. En mars 2015, les maires de Béziers et de Beaucaire débaptisent leurs rues du 19 mars 1962. En 2016, le maire de Nice refuse d’organiser une cérémonie à cette date. Ces querelles révèlent à la fois les fractures politiques et mémorielles, les contresens historiques, les représentations idéalisées du passé, les confusions entre histoire et mémoire, les mauvaises consciences et les relectures coloniales. Rémi DALISSON, professeur des Universités à l’Université/ESPÉ de Rouen, spécialiste des rapports entre histoire et mémoire et des politiques commémoratives, tente dans cet ouvrage de mettre à jour ces enjeux mémoriaux, identitaires et historiques de la question algérienne en replaçant son « impossible commémoration » dans son contexte national.
Les racines du problème commémoratif (1945-1999)
Les malentendus commémoratifs sur la Guerre d’Algérie tiennent leurs origines des perceptions différentes des groupes y ayant participé. Pour les engagés, elle s’apparente à une guerre de revanche après les humiliations de 1939-1940 puis la Guerre d’Indochine. Conserver les 3 départements algériens devient une mission. Les harkis, environ 60 000 soldats autochtones travaillant avec les troupes françaises, sont écartelés entre les solidarités locales et la France qui les soutient peu tout en renforçant leurs missions. Pour les appelés (1,343 million participent au « maintien de l’ordre » puis à la « pacification »), l’expérience combattante est un véritable traumatisme. Il s’agit pour eux de subir et de survivre pendant les 24 à 30 mois de leur service. La peur, le désespoir, le mort les changent à jamais. Les pieds-noirs (plus d’un million d’ « Européens d’Algérie » en 1959) se pensent comme les principales victimes de la Guerre d’Algérie car, pour la plupart, ils perdent tout. Ils sont animés par un fort sentiment d’injustice.
Après l’indépendance en 1962, ces mémoires vont rester longtemps enfouies par ces différents acteurs. Le problème commémoratif et mémoriel concerne d’abord les appelés. La plupart gardent leurs souvenirs enfouis, parlent peu ou pas. Ce temps du ressentiment, des cauchemars et de la résilience laisse alors peu de place aux commémorations. La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie) les représente dès 1958 et devient force de proposition commémorative. La mémoire des engagés oscille entre déni et ressassement. La mémoire des harkis,ni vraiment français ni vraiment arabes, est d’abord niée, rejetée par l’opinion publique. La mémoire des pieds-noirs est nostalgique. Ils idéalisent leur terre natale. On parle de « nostalgérie ».
On assiste donc pendant près de 25 ans à un « processus a-mémoriel ». Les amnisties successives permettent d’effacer la « guerre » de la mémoire officielle jusqu’au début des années 1980. Des articles de loi de 1964 et 1966 interdisent de mentionner les faits jugés et amnistiés. Cette « non-mémoire » empêche ainsi toute commémoration officielle. Ce « déni-mémoriel » convient alors à la quasi-totalité de la société : médias, opinion publique, intellectuels. « Sur l’Algérie fantôme règne un étrange silence » pour Pierre NORA en 1982. Mais la Guerre d’Algérie fait un premier retour dans le débat public dans les années 1980. De grands colloques sont organisés. Les archives militaires sont ouvertes à partir de 1992. L’étude de la Guerre d’Algérie est peu à peu intégrée dans les programmes scolaires. Le mot « guerre » est enfin reconnu officiellement en 1999.
Dans ce laps de temps, les hésitations de l’État et les pratiques privées compliquent la question commémorative. D’un côté, la République crée, hors de toutes commémorations publiques, des outils mémoriaux : statuts, ordres, diplômes et récompenses. Ils n’empêchent pas l’apparition de pratiques officieuses et parfois subversives. Les harkis célèbrent ainsi l’anniversaire du 12 mai 1962 comme « Jour de l’abandon des harkis par la France ». Pour les pieds-noirs, le 5 juillet est l’anniversaire du massacre d’Oran en 1962. Pour les anciens combattants, le 19 mars représente le cessez-le-feu au lendemain des accords d’Évian. Les dates de commémoration varient donc selon les mémoires de la Guerre d’Algérie. Malgré ce manque de consensus sur une date commune se développe tout de même un « habitus commémoratif » basé d’abord sur des revendications catégorielles mais qui prépare aux cérémonies officielles du début du XXIème siècle.
Les enjeux de la commémoration de la Guerre d’Algérie (de 1999 à aujourd’hui)
La loi du 18 octobre 1999, votée à l’unanimité, substitue l’expression « guerre d’Algérie et combats en Tunisie et au Maroc » à l’ancienne formulation « opérations effectuées en Afrique du Nord ». La République impulse alors une politique mémorielle passant par des lieux de mémoire concrets (mémoriaux, musées, rues,…) et symboliques (par l’enseignement par exemple). Elle cherche à mettre en place une commémoration fédératrice qui répare les traumatismes mémoriels. Tout au contraire, la loi provoque une « explosion mémorielle » (Benjamin STORA) et relance les polémiques, notamment sur les tortures. Un nécessaire travail d’histoire apparait alors indispensable pour sortir de la guerre des mémoires.
La question de la commémoration se pose avec de plus en plus d’acuité. Le choix du jour se révèle particulièrement délicat entre par exemple les partisans du 19 mars, du 26 mars (fusillade de la rue d’Isly en 1962), du 5 juillet ou même du 24 janvier (anniversaire des barricades d’Alger en 1960). On compte 14 possibilités différentes. Pour certains, la fonction fédératrice des commémorations étant primordiale et face à la concurrence exacerbée des mémoires, une date « neutre » comme le 5 décembre pourrait être une solution. Elle correspond à l’inauguration en 2002 du Mémorial National de la Guerre d’Algérie au Quai Branly à Paris, un lieu pérenne permettant de commémorer le conflit à cette date. Ce choix permet « de ne fâcher personne » car le 5 décembre ne renvoie à aucun fait de guerre. Mais il ne clôt pas le débat d’autant plus que la commémoration du 5 décembre est complétée par celle du 25 septembre « Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives ». Enfin une loi de 2012, au bout de 10 ans de gestation, concrétise la demande sociale de commémoration du 19 mars. 3 dates, 3 commémorations pour un évènement ! et qui ne font, et pour cause, toujours pas consensus. Elles sont régulièrement émaillées de boycotts (médiatisés), de provocations (refus de pavoisement des monuments par certains maires), voire de manifestations « contre-mémorielles » et/ou de violences.
La mémoire est une reconstruction du passé en fonction d’enjeux présents. C’est l’inverse de faire œuvre d’histoire dépassionnée. L’objectif prioritaire est d’articuler les mémoires avec l’histoire, science humaine qui utilise les mémoires en les déconstruisant pour concilier les différentes visions de la guerre. Si la commémoration de la Guerre d’Algérie est indispensable, pour Rémi DALISSON, conserver 3 dates pour 1 seule guerre est intenable. Cela favorise les conflits des mémoires qui anéantissent les efforts historiques. La commémoration doit incarner le « devoir d’histoire », être un lieu d’échange, de sociabilité et de rencontre, « un espace de politisation au sens noble du terme ». Rémi DALISSON propose alors le 8 avril, jour où les accords d’Évian sont acceptés par les Français par référendum. « Le symbole serait beau » car cette date permettrait de célébrer la souveraineté nationale, la primauté du vote populaire pour ratifier un accord international.
La Guerre d’Algérie est abordée au collège depuis 1971, au lycée depuis 1983 et à l’école primaire depuis 2002. Elle est étudiée en tant que telle et plus forcément dans le cadre de la décolonisation à partir des années 1990. Le programme de Terminale depuis 2010 est une nouveauté car il permet d’aborder le conflit sous l’angle mémoriel pour l’historiciser et comprendre la concurrence des mémoires dans une finalité civique évidente. C’est dans le cadre de ce programme que cet ouvrage peut fournir un éclairage intéressant aux professeurs d’Histoire-Géographie par le biais de la difficile voire impossible commémoration de la Guerre d’Algérie. Il intéressera également tout amateur d’histoire contemporaine qui souhaite bien distinguer pour ne pas les confondre devoirs d’ « histoire » et de « mémoire ».