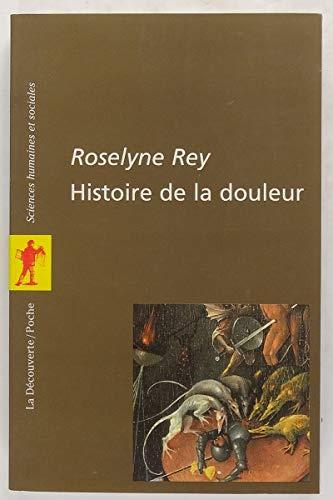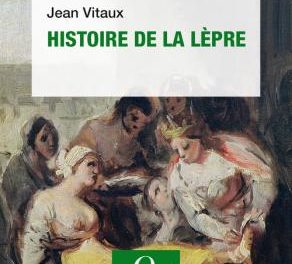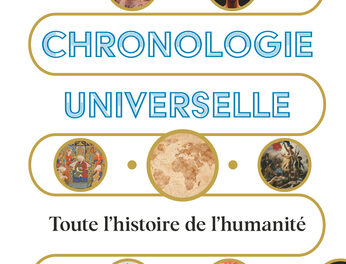Compte-rendu réalisé par Nola Héraudet, étudiante au lycée Claude Monet en hypokhâgne (année 2023-2024), dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Historienne des sciences du siècle des Lumières, Roselyne Rey est née au Maroc en 1951 et décédée en France en 1995. Ancienne élève à l’ENS de Fontenay-aux-Roses, agrégée de lettres en 1974, elle enseigne dans le secondaire avant de devenir professeur en classes préparatoires, puis chargée de recherche au CNRS. Son travail se concentre sur l’histoire de la médecine et des sciences de la vie. A l’Université Paris I sous la direction de Jacques Roger, elle soutient en 1987 sa thèse d’État, Naissance et développement du vitalisme en France de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à la fin du premier empire. Rédactrice en chef adjointe de la Revue d’Histoire des Sciences, elle a pour objectif de remettre à l’honneur les sciences naturelles. Ayant un goût particulier pour le XVIIIe siècle, elle contribue en 1981 aux Documents pour l’histoire du vocabulaire scientifique de Jacques Roger.
Son Histoire de la douleur est publiée une première fois en 1993 avant d’être traduite en anglais. Son ouvrage contient une introduction, une conclusion et deux postfaces, l’une de J. Cambier, professeur de clinique neurologique; l’autre de J.-L. Fischer, chargé de recherche au CNRS et de cours à l’Université Paris VIII. Il comporte sept chapitres et couvre la période de l’Antiquité grecque jusqu’au XXe siècle en analysant les représentations culturelles de la douleur. Il contient un index, une bibliographie et un glossaire. Roselyne Rey fait constamment appel à de nombreuses références d’auteurs, qu’elles soient littéraires, comme Diderot, ou scientifiques, comme Galilée. À travers des théories médicales et des remèdes élaborés, il s’agit de découvrir et d’analyser des mécanismes et concepts qui évoluent et parfois régressent à travers le temps. La relation entre le malade et le médecin est aussi décrite et interrogée. La douleur sous-entend-t-elle nécessairement une maladie ? Est-elle plutôt intérieure ou extérieure, une sensation ou une émotion ? Faut-il y prêter attention ou simplement la fuir ? La douleur est-elle innommable tant par sa complexité que par son ambivalence constante dans les questionnements.
Résumé
Dans l’introduction, le point de départ du raisonnement est l’élaboration d’une idée commune : en tant qu’homme, nous recherchons le plaisir et nous fuyons et détestons la douleur. Dès lors, nous nous rapprochons de l’animal. Roselyne Rey développe une histoire de la douleur dont le long combat a traversé les époques. Elle précise qu’elle va analyser des douleurs physiques et non des souffrances morales, opposition traditionnelle que l’on entend dans l’acception du terme. Cette étude possède de multiples approches car la douleur est une construction culturelle et sociale qui aborde aussi la biologie et la sensibilité. La douleur n’a pas la même signification selon l’époque, le lieu, la population, le moment où on la ressent ou encore la croyance. On peut tout autant fuir la douleur que s’en affliger. De même que la douleur semble à la fois élever et abaisser les capacités physiques. Chez la figure du héros, la douleur modifie ses capacités physiques. Elle soulève aussi la question de l’expression de la douleur, élément qui permet d’atténuer cette dernière ou, au contraire, de l’amplifier. La douleur est également une limite entre soi et le monde si on se réfère à la définition de la peau de Bichat, médecin français du XVIIIe siècle : « la limite sensitive de notre âme ». Ces approches nous amènent à envisager l’objectif de la médecine qui est avant tout de guérir a priori. L’autrice finit par nous présenter une métaphore de l’étude de la douleur avec le poème de Baudelaire, Le Thyrse (1869), bâton où s’enroule des tiges et des fleurs. Toutes ces expressions représentant la diversité des moyens sont mobilisées pour élaborer une histoire de la douleur.
Dans le premier chapitre, il ne s’agit pas de mépriser des méthodes antérieures mais bien d’en souligner la multiplicité dans l’antiquité gréco-romaine et admirer des questionnements pertinents déjà présents. Même si elle déforme certains traits, la littérature – avec L’Iliade et L’Odyssée d’Homère ou les genres épique et tragique avec Philoctète de Sophocle – évoque beaucoup la douleur et permet une approche historique et diachronique du monde homérique jusqu’au Ier siècle avant J.-C. Dans la tragédie, il ne s’agit pas de douleur chronique mais celle liée au combat et qui peut aussi toucher les dieux, résultat d’une diversité des mots en grec. Les textes les plus importants sont ceux du Corpus hippocratique du Ve siècle avant J.-C. qui était utilisé pour la médecine. On peut ainsi cerner à travers ces diverses œuvres comment une culture rend compte de la douleur, donc ce qu’elle tait et ce qu’elle dit. Le genre tragique met en valeur la place du cri et se veut « lieu naturel d’expression ». La douleur est à ce moment-là considérée comme à ne pas cacher par une approche sociale. Ce n’est pas un objet de honte pour un héros mais cela a plutôt au contraire une fonction cathartique pour le spectateur. Le discours médical, lui, réduit la diversité d’expériences singulières. Quand il la codifie, il ne prend pas en compte la charge émotionnelle. La parole du malade dans l’Antiquité est tout de même particulièrement considérée et l’échange entre le malade et le médecin est nécessaire. Étonnamment, le médecin est considéré comme doué non pas que pour la réussite de son remède proposé mais surtout s’il a réussi à envisager un bon pronostic. Le lieu d’une douleur du point de vue antique est inévitablement celui de la maladie. Il y a en effet une faible connaissance atomique et le savoir se repose majoritairement sur l’empirisme. Les conceptions sont encore bien influencées par les religions. A Alexandrie à la fin du IVe siècle av. J.-C., la médecine cherche des bases plus précises sur l’anatomie avec la pratique de dissections. Avec la protection royale et la présence de bibliothèques, cette ville offre des conditions favorables pour étudier la médecine. Objectivement, la douleur est alors l’annonce d’une maladie et permet d’observer son évolution. Malgré les apparences, la douleur est déjà une maladie. Au fond, elle est « l’antagoniste de la santé ». Tous ces savoirs se sont cependant perdus au Moyen-Âge.
Le second chapitre couvre la période de l’Antiquité tardive jusqu’à la Renaissance. Constantinople est, à partir de 330, la capitale de l’Empire Romain d’Orient : c’est un lieu de contacts entre mondes, cultures et savoirs différents. Au XIe siècle, la science arabe arrive en Europe par les voies de l’Italie et de l’Espagne. La conception hégémonique de Galien est fondamentale mais, de toutes ses œuvres, seule une synthèse et des extraits en sont ressortis. La transmission du savoir médical d’Orient s’est faite avec des médecins arabes et des philosophes. La grande partie des traductions s’est faite à Bagdad au IXe siècle, elle est nécessaire pour le réveil de la médecine occidentale. Enfin, on ne sait pas ce que l’homme du Moyen-Âge fait quand il souffre. Le christianisme avait une place considérable et il fallait pouvoir apprendre à supporter la douleur comme un don de Dieu.
Dans le troisième chapitre, l’autrice met en avant la période de la Renaissance du XIVe siècle jusqu’au milieu du XVIe siècle. La fin de siècle est assombrie par des guerres de conquêtes entre France et Espagne, des guerres de religion, beaucoup plus de personnes qui sont engagées mais aussi d’importants épisodes d’épidémies. D’autre part, la création de la poudre à canon en France sous le règne de Charles IX témoigne d’avancées en matière d’armes. La conséquence est que les blessures sont bien plus graves. La religion permet, du point de vue de la Renaissance, de donner un sens à la douleur et à la mort en les faisant passer pour la colère de Dieu. D’autres pensées voient le jour et refusent de considérer cette douleur collective en relation avec la religion et le divin. L’expérience de la maladie et de la douleur doit être ramenée à un rapport individuel et humain. Ainsi, il y a une naissance de l’individu et on commence vraiment à décrire les douleurs intérieures. Le corps social cherche à éloigner la douleur d’elle, ce qui paraît assez paradoxal. Pour finir, une professionnalisation et une spécialisation de la médecine qui s’ensuit sont à souligner.
Dans le quatrième chapitre, la douleur à l’âge classique est évoquée avec une avancée majeure de la connaissance de l’homme au XVIIe siècle. Les caractéristiques de l’activité scientifique sont différentes selon les pays. Le corps de l’homme est amené à être considéré comme une machine complexe. Concernant l’aspect théologique, Roselyne Rey écrit que la religion apporte espoir et consolation aux plus pauvres et démunis, et donc ceux en général qui sont les plus touchés par la douleur. La conception aussi de la femme est très contradictoire pendant ce siècle. D’un côté, elle est considérée comme ayant un seuil de tolérance à la douleur plus faible que celui de l’homme, il ne faudrait donc pas tenir compte de ses cris ou de ses pleurs. De l’autre, elle semble plus habituée à la douleur, comme avec l’enfantement, et donc plus résistante. Tous ces discours ont pris l’apparence d’une science en se glissant subtilement dans les normes de la société. Au moment de l’enfantement, la mère était moins importante que l’enfant, la doctrine de l’Église a encore une influence. Un questionnement plus général ressort : et si cette tendance à sacraliser la douleur ne serait pas juste une tendance narcissique pour se glorifier de l’endurer ? L’expérience individuelle n’est cependant pas encore assez prise en compte, ce qui reste « inacceptable et innommable ».
Dans le cinquième chapitre, la douleur au siècle des Lumières est exposée. Il y a une véritable déchristianisation de la société, une laïcisation de la pensée et une séparation entre science et métaphysique. On étudie beaucoup plus le rapport au sensible. La sensation serait le point de départ avant tout savoir établi. Ces réflexions que portent beaucoup de savants se tournent vers la douleur et le plaisir, et inévitablement vers l’organisation de la société, un contexte sociopolitique et économique jouant son rôle dans les conceptions et les sentiments. D’un côté, pour certains, l’expression de la douleur n’est pas utile. Pour d’autres, les cris sont utiles et un excès de courage n’a rien d’utile au contraire. Un débat sur l’anesthésie naît aussi. La doctrine des « sympathies » est de surcroît établie par Paul-Joseph Barthez, médecin vitaliste. On peut ressentir une douleur qui vient d’une autre partie du corps, d’où une forme de synergie. Aujourd’hui encore, la question de ces transports de douleur se pose malgré des avancées. Les attitudes culturelles vis-à-vis de la douleur demeurent pourtant contradictoires. A la fois, il s’agit autant pour le malade que pour le médecin de résoudre et fuir au mieux la douleur mais le médecin doit aussi parfois infliger la douleur pour le faire guérir. Ceci est constitutif de la médecine aujourd’hui et les réponses à ce paradoxe se retrouvent finalement dans une approche éthique.
Dans le sixième chapitre, ce sont des grandes découvertes qui marquent la période. Amédée Dechambre soulève la confusion constante entre douleur morale et physique. On prend moins en compte l’affectivité du patient et les expériences précédentes trop associées à la morale. C’est aussi un temps des révoltes impuissantes. Au début du XIXe siècle, le corps médical est encore très conservateur étant donné le pouvoir qu’il a. Durant les campagnes napoléoniennes, l’exemple du Baron Larrey, premier chirurgien de la Garde impériale et inspecteur du service général du service de santé des armées, est intéressant. Il étudie l’amputation dans un contexte de guerre : en 1828, Larrey est aux côtés d’Emile de Gérardin qui propose les premières tentatives d’anesthésie qui sont reçues avec mépris. On pense alors qu’il n’y avait pas de moyens acceptables pour diminuer la douleur. « Éviter la douleur par des moyens artificiels est une chimère » déclare le chirurgien Alfred Velpeau en 1840. La majorité des anesthésies sont mortelles au départ, un quart de celles-ci vers 1880 en Grande-Bretagne. Les différents procédés d’anesthésie mettent cependant tout de même un terme au caractère inéluctable de la douleur et changent le rapport de l’homme à celle-ci. Ce n’est d’ailleurs qu’après les années 1870 que les remèdes opiacés sont remis en question par le corps médical. C’est une prise de conscience tardive. Les maladies particulièrement douloureuses font face à une diversification des moyens de traitement et une chimie pharmaceutique qui s’industrialise.
Dans le septième chapitre, les approches de la douleur dans la première moitié du XXe et les stratégies de communication sont mises en avant. Roselyne Rey souligne combien, au début du XXe siècle, la théorie cellulaire est de plus en plus valorisée. Les médecins ont admis que des émotions violentes ont une influence physique, comme par exemple la peur ou les passions amoureuses. La mortalité infantile restant élevée, la question de soigner les nouveau-nés devient nécessaire, voire même sans anesthésie. Beaucoup de pratiques ont alors lieu vers 1950. Des interventions chirurgicales sur les nouveau-nés sont possibles grâce à des recherches embryologiques et une interprétation darwinienne de la physionomie et des émotions. Grand chirurgien de la douleur, René Leriche milite contre toute forme de dolorisme pendant l’entre-deux-guerres. Il refuse que l’on considère la douleur comme utile pour prévenir. Personne ne devrait avoir à subir cela et les maladies sont souvent imprévues : « Contre l’hypocrisie de ceux qui parlent de supporter la douleur sans la connaître, contre ceux qui se sont pas impatients de combattre et de relever le défi de la douleur, la chose innommables entre toutes ». Quand la douleur arrive, il est déjà trop tard.
Dans la conclusion, l’idée dominante est qu’on s’est souvent plus occupé de la maladie que du malade. Entre l’Antiquité et le XXe siècle pourtant, il y a eu des formes de régression et une certaine discontinuité du rythme des avancées et des élaborations de connaissances. Les pouvoirs de la médecine continuent d’être remis en question par la douleur surnommée « pierre d’achoppement de cette confiance et de ces certitudes ». Aujourd’hui, des spécialistes voient encore des horizons d’études complexes sur la douleur. Il ne s’agit pas d’accuser le corps médical, qui a fait serment de soulager la douleur, mais plutôt de s’interroger maintenant sur les conditions d’exercice de la médecine et les problèmes dans les hôpitaux. Par exemple, le problème du statut et de la formation des infirmières plus directement en contact avec le malade souffrant. Une approche sociologique dans cette pratique est souhaitable. La relation malade-médecin demeure fondamentale et essentielle. On pourrait sortir de l’expérience de la douleur que si on se réapproprie son statut de sujet au péril de sa vie. Dans sa postface, J. Cambier relève le rôle du langage dans la mémoire de la douleur avec un vocabulaire élaboré. Désormais, on ne peut plus faire souffrir aussi facilement au nom du bien du patient même. Dans la postface de J.-L. Fischer, on retient l’idée qu’une analyse du passé permet une réflexion sur le présent. Il insiste sur le paradoxe qu’il y a eu un important décalage entre le progrès des connaissances et des traitements à travers l’histoire.
Appréciations
Il est étonnant de faire une œuvre historique sur un domaine a priori avant tout médical. Cela montre que la notion et ses thèmes transversaux peuvent être pluridisciplinaires et abordés sous différents angles. Il est aussi intéressant de relever que l’historienne Roselyne Rey n’apporte pas ici des vérités scientifiques mais permet d’établir des lignes directrices dans l’avancée de sa propre connaissance et des mécanismes de la douleur. Il y a un réel progrès scientifique continu malgré des concepts et savoirs plus ou moins précis à travers l’histoire. On parlait déjà durant l’Antiquité des affections arthritiques et sciatiques. L’étude du passé peut donc être étonnamment mise en relief avec les questions d’aujourd’hui. Dans sa démarche, l’autrice pose de même des questions souvent en fin de paragraphe ou de partie pour nous inviter à questionner certaines pratiques ou savoirs, et ensuite, à les mettre en lien avec aujourd’hui. Elle commence par présenter les contributions scientifiques les plus marquantes dans la connaissance et les pratiques utilisées dans le traitement de la douleur. Puis elle analyse les conditions scientifiques et institutionnelles dans lesquelles ont été construites des hypothèses et théories sur la douleur. Enfin, elle fournit des éléments de la réflexion sur les rapports entre l’Église et la douleur, la littérature et la douleur. A travers un livre dense avec de nombreuses informations, des exemples et des concepts, il y a systématiquement une conclusion opérante de chapitre pour relier au fil conducteur du livre et montrer l’évolution claire à travers l’histoire de la douleur. Cette méthode permet aussi au lecteur de se renseigner sur une partie qu’il décide d’étudier en particulier et s’apparente à une frise chronologique littéraire. Même au sein d’une même période, il est étonnant d’observer la pluralité des pensées et de ce qu’on administre à la douleur. Les références sont surtout très riches, provenant à la fois de livres d’histoire, de dictionnaires et d’encyclopédies. On relève dans l’écriture de Roselyne Rey une démonstration toujours éclairante et pertinente car elle tente de définir des concepts ou méthodes. Néanmoins, à travers un discours médical et un vocabulaire précis, on peut ne pas saisir certaines subtilités si nous ne sommes pas spécialistes d’un domaine. Une abondance constante de références amène parfois à perdre le fil dans le fond et ne pas nécessairement comprendre toutes les idées.