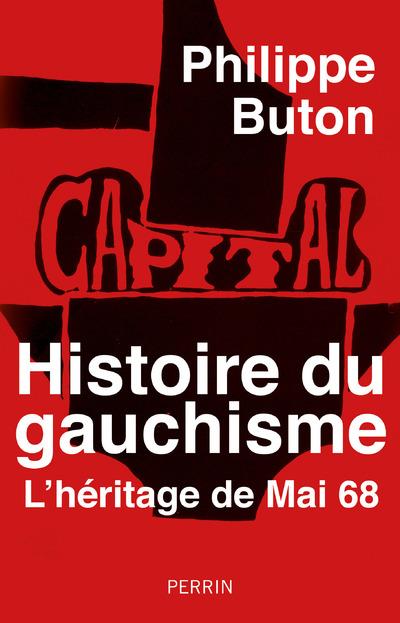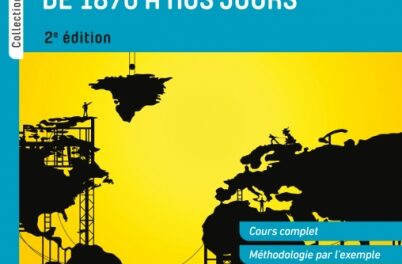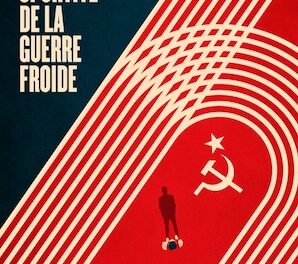Philippe Buton spécialiste d’histoire contemporaine, professeur à l’université de Reims, est l’auteur de Les lendemains qui déchantent : le Parti communiste français à la Libération (Presses de Sciences Po, 1993). Il a publié de nombreux articles sur les courants d’extrême-gauche. Ainsi : « L’extrême gauche française et l’écologie. Une rencontre difficile (1968-1978) » dans Vingtième Siècle (2012/1, n° 113) ou avec Isabelle Sommier et Sébastien repaire : « Les gauches alternatives en France, du bouillonnement des années 1968 aux recompositions de la fin de siècle », Revue Historique (Octobre 2017). Il propose ici un bel ouvrage sur le gauchisme et l’héritage de Mai 68 avec près de 30 pages d’annexes et 70 pages de notes.
Une contribution importante à l’histoire du « gauchisme » en France
Pour mener à bien cette étude, il s’appuie sur des sources variées et nombreuses : archives des Renseignements généraux, de la préfecture de police de Paris, du service historique de la défense, archives de divers groupes d’extrême-gauche, divers périodiques de ces groupes ainsi que sur des entretiens avec des militants ou responsables réalisés par lui ou par d’autres. On le devine déjà, un des intérêts de l’ouvrage réside dans cette diversité et dans la curiosité que suscite l’approche des sources policières.
Surpris en mai 1968, les Renseignements généraux parviennent, après un temps, à mieux suivre les extrêmes-gauches et ne semblent pas adhérer au discours, qu’on dirait aujourd’hui complotiste, de Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur chargé de réprimer les contestations, et qui attribue cette effervescence à un complot communiste.
Philippe Buton met bien en évidence tant l’infinie diversité de ces groupes que leurs points communs. Il souligne les liens entre une génération avide de libertés dans la France corsetée du début des années 1968 et les organisations d’extrême-gauche. Enfin, il montre qu’après avoir surmonté la tentation de la violence et, même s’ils s’étiolent, les militants ou anciens militants de ces mouvements ont participé de manière significative à la transformation de la société.
L’ouvrage est bien l’œuvre d’un historien, dont on peut discuter tel ou tel aspect ou critiquer un point de vue. Ce n’est pas un énième règlement de comptes d’un ancien soixante-huitard devenu honteux des turpitudes de sa jeunesse.
Dans le chaudron de l’extrême-gauche
Plusieurs chapitres sont consacrés à ce que l’auteur, à la suite d’un rapport policier, appelle « l’imbroglio gauchiste » avant le mois de mai 1968 comme dans l’immédiat après 1968. La galaxie est, de fait, des plus complexes. Ph. Buton centre son étude sur trois familles : les libertaires, les trotskystes et les maoïstes mais il porte aussi son attention sur le PSU. Jusque-là, tout va bien, mais les gauches ont, on le sait, une incroyable tendance à la scissiparité, et à l’extrême-gauche, cette tendance est peut-être plus forte – quoiqu’une comparaison avec le printemps 2021 pourrait inviter à une certaine indulgence envers les gauchistes.
En effet, chacune de ces familles est divisée. L’ancêtre de Lutte ouvrière (Voix ouvrière), l’OCI (Organisation communiste internationaliste) et la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire, devenue Ligue communiste puis Ligue communiste révolutionnaire dont est issu le NPA) sont les principaux groupes se réclamant du prophète désarmé (Trotsky). Le grand timonier (Mao) inspire plusieurs organisations qui se disent ml (marxistes-léninistes) sans compter des groupes locaux comme à Rennes ou des maos partisans de l’action directe telle la Gauche prolétarienne. Le PSU quant à lui est partagé en tendances fort diverses et des tensions apparaissent entre diverse sensibilités anarchistes. Par ailleurs, bien sûr, plusieurs groupes naviguent entre ces grandes familles. On comprend mieux à la lecture de cet inventaire – partiel – l’incapacité de ces organisations à structurer un pôle fort et durable.
Au-delà, de ces remarques, faciles, on peut distinguer dans chacune de ces familles : patients et impatients, néo-léninistes et courants plus libertaires, mouvementistes et tenant de l’orthodoxie marxiste… Etant entendu que ces groupes évoluent, qu’ils sont parfois composés de plusieurs tendances et qu’un même militant est parfois hésitant…
Pourtant au lendemain de mai-juin 1968, ces organisations ont « une évidente force d’attraction » (p. 105). Des jeunes les rejoignent et s’y forment intensément, leur presse se vend à des milliers d’exemplaires, ils parviennent à organiser des manifestations importantes et les débats qu’ils portent font l’actualité. Tout ceci oblige l’État à mettre à jour ses connaissances sur cette galaxie, à la surveiller sérieusement et à la punir parfois. Il doit cependant tenir compte du fait que les organisations d’extrême-gauche bénéficient du soutien d’une partie de la population.
Gauchisme culturel et organisations d’extrême-gauche
Pour l’auteur, l’extrême-gauche a été, un temps, « le porte-voix de la nouvelle génération qui frappe à la porte d’une société qui peine à lui octroyer sa place » (p. 7). Il distingue le « gauchisme culturel » des jeunes « du simple gauchisme politique des multiples groupuscules » (p. 8). Il montre cependant la porosité, les liens, entre cette génération qui refuse la société française corsetée d’alors et des organisations qui entendent faire la révolution. D’où la capacité des groupes d’extrême-gauche à recruter des dizaines de milliers de jeunes et à impulser des luttes massives dans l’immédiat après mai 1968.
Ainsi le printemps 1973 vit fleurir mille manifestations contre la loi Debré qui visait à réduire les sursis dont bénéficiaient les étudiants avant d’effectuer leur service militaire. Un regret cependant l’auteur aurait peut-être pu insister davantage sur le côté « passoire » de ces organisations ainsi que sur les contradictions de cette jeunesse. En effet, les mêmes qui s’opposaient à la guerre du Vietnam ou au soutien des États-Unis à la dictature de Pinochet étaient fans de blues, de rock, de Robert Crumb ou de films US.
Les gauchistes, quoiqu’il en soit, partent, après mai 68, à l’assaut de ciel. S’ils arrivent à impulser des luttes massives dans l’université, les lycées et à occuper la rue de manière spectaculaire, leurs efforts pour s’implanter durablement dans les usines sont rarement couronnés de succès. Cependant les actions menées dans ces années par les ouvriers grévistes sont, comme l’a souligné Xavier Vigna, marquées du sceau de l’insubordination que valorisaient ces groupes. Par ailleurs, l’exigence de démocratie dans les luttes portée par ces gauchistes est reprise bien au-delà de leurs rangs. De fait, c’est surtout parmi les employés et les enseignants que ces organisations ont pu, un petit peu, s’implanter[1].
Philippe Button revient aussi sur les tentatives de ces organisations d’agir dans les casernes. Cette dimension de leur action est souvent oubliée et trop sous-estimée. L’auteur souligne l’importance et la diversité des actions menées : tracts, pétitions, manifestations d’appelés, constitution de comités de soldats… Le recours aux sources de la Sécurité militaire permet d’en percevoir l’ampleur et la durée.
La tentation de la violence
Pour certains gauchistes politiques, mai 68 avait constitué une « répétition générale »[2] et la révolution était à l’ordre du jour en Europe. Comment y parvenir se demandaient-ils ? Le recours à la violence était-il à l’ordre du jour ? La France à la différence de l’Italie n’a pas vu une frange significative du mouvement contestataire recourir de manière systématique à l’action violente puis au terrorisme. Philippe Buton considère que s’il y a bien eu une certaine tentation de la violence, en particulier à la Gauche prolétarienne et à la Ligue communiste, ces groupes n’y ont pas cédé pour plusieurs raisons.
D’abord du fait de l’existence de tendances dans ces organisations qui y étaient hostiles mais aussi parce que, à la différence de l’Italie, l’extrême-droite, en France, n’a pas eu recours au terrorisme aveugle. Enfin, la police y a été moins systématiquement violente, a eu moins recours aux armes à feu, et les services secrets n’y ont pas joué au pire… Peu à peu, les organisations d’extrême-gauche, qui voient leur influence décroître, s’assagissent et jouent le jeu des institutions.
Que reste-t-il du « gauchisme » ?
Un des intérêts majeurs de cet ouvrage est que Philippe Buton, s’il ne semble pas favorable eu discours révolutionnaire, ne règle pas de compte avec les organisations qui le portaient. Il considère ainsi que celles-ci ont eu rôle important, un temps, nous l’avons vu. L’auteur pense qu’elles ont favorisé l’insertion des jeunes dans la société française. Philippe Buton souligne le rôle des militants ou des ex-militants de ces organisations, voire après un moment de certaines de ces organisations, dans l’émergence de nouveaux thèmes : écologie, féminisme, défense des minorités sexuelles, relations au travail.
Il repère l’insertion de nombre d’anciens dans des mouvements sociaux : syndicats SUD (Solidaires unitaires démocratiques), grèves de 1995, altermondialisme ou dans des partis de gauche ou écologistes[3]. Il confirme le fait que, contrairement à une vulgate souvent diffusée par des courants réactionnaires, la majorité de ceux qui ont été actifs à l’extrême-gauche ont moins grimpé dans l’échelle sociale que ceux qui se sont abstenus de militer[4].
Un livre d’historien des plus utiles pour comprendre les espoirs d’une génération et qui éclaire les débats politiques, les mouvements contestataires ainsi que les transformations de la société française des années 1960 à nos jours.
[1] Il n’est pas impossible de penser que cette influence soit plus forte parmi les enseignants d’histoire-géographie que dans d’autres disciplines.
[2] Voir : Daniel Bensaïd, Henri Weber, Mai 68 : une répétition générale, Éditions Maspero,1968.
[3] Pour une vision plus pessimiste, Benjamin Stora, 68, et après. Les héritages perdus, Stock, 2018.
[4] Changer le monde, changer sa vie. Enquête sur les militantes et les militants des années 1968 en France, sous la dir. d’Olivier Fillieule, Sophie Béroud, Camille Masclet et Isabelle Sommier, avec le collectif Sombrero, Paris, Actes Sud, 2018, 1118 p.