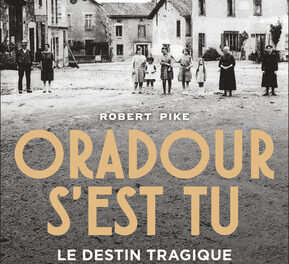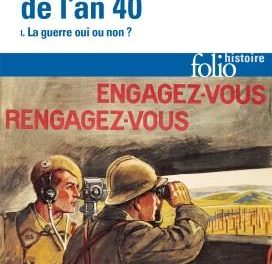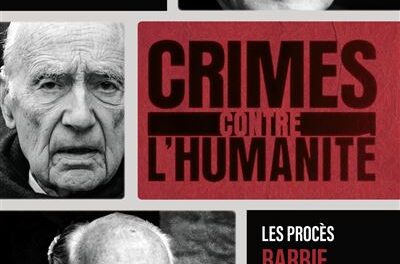Le numéro 5 de la revue est pour l’essentiel consacré à la bataille de mai-juin 1940 et à la défaite de la France. Les 16 pages de chroniques permettent de suivre très simplement les événements principaux, semaine par semaine tandis que l’éphéméride qui se trouve dans la partie inférieure de chaque double page consacrée à une semaine caractérise très brièvement de nombreux autres faits internationaux. Six pages de chroniques bibliographiques dont deux pages jeunesse sont consacrées aux publications récentes.
La plupart des articles traitent de l’effondrement de la France. Notons cependant trois articles intéressants consacrés l’un aux sports mécaniques dans les dictatures fascistes, l’autre à la coupe du monde de football 1934 qui servit de vitrine au régime fasciste, le troisième aux films d’espionnage tournés à Hollywood en 1940 et 1941 par Alfred Hitchcock et Fritz Lang au service de la propagande antinazie.
La revue s’ouvre par un entretien de Thomas Rabino (doctorant à l’Université de Provence, auteur de travaux sur le réseau Carte) avec Jean-Louis Crémieux-Brilhac, l’un des derniers « grands témoins » des années 1940, au parcours assez fascinant.
Né en 1917 « dans une famille politisée, républicaine, socialiste », il se passionne pour le Front populaire alors qu’il est étudiant. Passant tous les ans une partie de ses vacances en Allemagne dans une famille socialiste, il vit « année par année, croître le pouvoir hitlérien » et fut à la fois « très antifasciste et pacifiste jusqu’à Munich ».
Son témoignage sur l’enseignement qu’il reçut à Saint-Cyr et l’état de l’armée française en 1940 est accablant. A Saint-Cyr raconte-t-il « on ne nous apprenait pas qu’il y avait des avions contre lesquels il faudrait nous défendre (…) On ne nous a pas appris qu’il y avait des chars contre lesquels il faudrait nous défendre (…) On nous a montré un canon de 25 antichar sans nous expliquer comment nous en servir. Nous n’avons jamais fait de manœuvre avec chars ». Il est affecté à l’extrême ouest de la ligne Maginot : « A mon arrivée, je suis invité à déjeuner par mon commandant, un peu à l’arrière, dans un village. On bavarde, et puis je demande : « Quand est-ce que les choses vont devenir sanglantes ? » Ce à quoi il répond : « Il y croit le jeunot ! » Pour lui, la guerre n’allait pas vraiment éclater ». Fait prisonnier le 11 juin il est transféré dans un Oflag de Poméranie. Il y voit « des officiers français s’installer dans la captivité » et entend vaguement parler d’un général qui à Londres entend continuer la guerre.
Il prépare son évasion méthodiquement, avec un camarade. Le 6 janvier 1941, « par un froid terrible », ayant estimé que le départ vers la France était impraticable, ils prennent la direction de l’est. « Nous avons fait 425 km et franchi la frontière, après avoir passé une journée à Koenigberg ». Ils franchissent le no man’s land entre le Reich et l’URSS, de nuit, à la boussole. « Au milieu des ruisseaux, les Allemands avaient mis des barbelés sur la glace. Mon manteau était complètement déchiré ». Le consulat français de Kaunas en Lituanie sur lequel ils comptaient, n’existe plus. Arrêtés par les Soviétiques, emprisonnés à Moscou, ils y retrouvent des compatriotes.
Staline accepte enfin de les libérer après l’attaque de l’URSS le 22 juin 1941. Les uns rentrent en France, les plus nombreux choisissent de rallier la France libre. Ils arrivent à Londres le 9 septembre 1941 « gonflés à bloc, accueillis en petits héros ». En quelques mois Jean-Louis Crémieux-Brilhac devient secrétaire du Comité exécutif de la Propagande et chef du service de diffusion clandestine de la France libre.
Après une carrière de haut fonctionnaire (il fut directeur de la Documentation Française jusqu’en 1982) il renoue avec l’histoire (il avait été admissible à l’agrégation d’histoire en 1938) et est l’auteur de deux ouvrages de référence : Les Français de l’an 40 et La France Libre. Il a publié aussi Prisonniers de la liberté : l’odyssée des 218 évadés par l’URSS et très récemment une biographie de Georges Boris qui fut directeur du cabinet de Léon Blum en 1938, cadre de la France libre à Londres, le premier directeur du Plan à la Libération, le collaborateur et l’éminence grise de Pierre Mendès-France dans les gouvernements de 1954 et 1956.
François Kersaudy signe un article consacré à Churchill et à sa détermination à poursuivre la lutte contre l’Allemagne. Nommé Premier ministre par défaut (Halifax, ancien chantre de la politique d’appeasement lui était préféré mais ne se sentait pas de taille à assumer la fonction), à 66 ans, le 10 mai 1940, il constitue un gouvernement et un conseil de guerre d’union nationale. Il est donc « sous surveillance », mais en créant un ministère de la Défense il parvient à prendre en main personnellement la conduite de la guerre.
Son énergie semble inépuisable en mai et juin 1940 : il se rend six fois en France, organise à Londres l’accueil des gouvernements européens exilés, fait transformer le Royaume-Uni en forteresse pour repousser un éventuel débarquement allemand, fait développer la production aéronautique, met sur pied les instruments de la contre-offensive (en créant par exemple le Special Operations Executive, SOE, qui va organiser les réseaux de sabotage et de renseignement et les parachutages dans l’Europe occupée), prononce « des discours soigneusement élaborés qui compteront parmi les chefs d’œuvre de l’art oratoire » et vont remonter le moral de la population. « Depuis sa voiture, son train, son lit et même sa baignoire, il dicte au Comité des Chefs d’état-major et aux divers ministères des centaines de notes incitatives, inquisitrices et comminatoires. »
L’article de Max Schiavon, « Le haut commandement français en 1939-1940 », est sans doute le plus original et l’un des plus passionnants. L’armée française est dirigée par un corps d’environ 600 officiers généraux d’active et de réserve. L’auteur étudie le groupe d’une vingtaine de généraux d’armée qui se trouve en haut de l’édifice : le commandant en chef (Gamelin puis Weygand), son adjoint (Georges), le major général (Doumenc), le chef d’état-major de l’armée (Colson), les quatre commandants de groupes d’armées et la douzaine de commandants d’armées.
Ils sont presque tous issus de milieux relativement modestes ou de la petite bourgeoisie, aucun grand bourgeois ou de famille noble. Ils furent d’excellents élèves de Saint-Cyr et de Polytechnique et ont choisi ce métier par vocation, ainsi que par ambition d’élévation sociale. Très bien notés alors qu’ils étaient sous-lieutenants, ils sont entrés à l’Ecole supérieure de guerre. Ils ont commandé des régiments et la Grande guerre a accéléré leur carrière. Ils sont pour la plupart « retournés dans leurs casernes avec beaucoup trop de certitudes. Notamment celles consistant à croire que les techniques employées lors des offensives finales en 1918 étaient la panacée. » Dans les années 1930, devenus généraux, ils occupent des postes de plus en plus élevés. Ils ont un peu plus de 60 ans en 1940, « certains, trop sédentaires, n’ont pas entretenu comme il aurait fallu leur forme physique et ont pris e l’embonpoint ». Ils sont désabusés, se méfient des hommes politiques (qui le leur rendent bien et les soupçonnent -à tort- de n’être pas assez républicains). Ils sont « devenus des savants, des techniciens, des administrateurs bien plus que des hommes d’action ». Ils manquent d’imagination, découragent toute initiative, et, pendant la drôle de guerre, s’installent dans une routine malsaine.
Ils communiquent par téléphone et par messages chiffrés et non par radio. Aucun n’a imaginé possible une percée aussi rapide des forces blindées ennemies.
Quand les certitudes acquises depuis 40 ans s’effondrent en 48 heures, la faiblesse des hommes se révèle cruellement. Billotte, commandant du groupe d’armées n°1 est fatigué et démoralisé ; Georges est gagné par un stress intense ; une minorité se révèle cependant capable de réagir, avec une mention particulière pour le général Doumenc dont le rôle fut crucial.
Deux articles de Vincent Bernard : « De Sedan à Dunkerque. 10 mai 40 juin 1940 » et « La Bataille de France. De la Somme à l’armistice » fournissent un récit et une analyse des événements, complétés par des cartes et des photographies. S’appuyant sur une bibliographie récente, il s’efforce de montrer la réalité des forces en présence (en exerçant une utile critique des critères retenus par différents auteurs en ce qui concerne les effectifs et les armements), de présenter les stratégies puis de raconter les événements. « De la collusion entre l’incapacité du commandement français à envisager sérieusement ce scénario catastrophe (la percée des blindés et l’utilisation des Stukas) (…) et l’audace manifeste du plan de bataille allemand (…) mais surtout de l’exécution, rapide et brutale sur le terrain, de certains généraux tels Rommel et Guderian », va naître le « coup de faux » des Ardennes qui, de la percée de Sedan à la baie de Somme, va isoler les armées françaises qui se sont avancées en Belgique, les prendre en tenailles et les encercler sur les plages de Dunkerque. A l’annonce de la percée allemande, Gamelin est désemparé et Georges répète qu’il faut « colmater la brèche » sans savoir comment, tandis que Paul Reynaud affirme : « Nous sommes battus ». Il limoge Gamelin et le remplace par Weygand qui ne se montre pas plus efficace.
L’arrêt des Panzer dans les Flandres sur ordre d’Hitler va donner aux Alliés un délai inespéré pour organiser la plus massive opération d‘évacuation de toute la guerre. En moins de dix jours, 340 000 hommes sont sauvés, 120 000 Français échappent à la captivité. Même si, comme le dit Churchill, « on ne gagne pas une guerre avec des évacuations », celle de Dunkerque est un véritable succès stratégique défensif permettant à l’Angleterre de sauver le noyau dur de ses forces sur lequel elle va pouvoir reconstruire une armée.
Cet arrêt des Panzer sur ordre d’Hitler (Haltbefehl) fut-il une erreur militaire ? François Delpla développe sa thèse qui en fait au contraire la traduction d’un calcul politique et diplomatique : « il amène les gouvernements de Paris et de Londres à prendre conscience du désastre imminent, et à en concevoir un désir de paix qui a bien des chances de se révéler irrésistible ». Selon F. Delpla, c’est la détermination de Churchill qui retient in extremis l’Angleterre de sombrer avec la France dans une demande d’armistice.
Sur le papier Weygand trace une ligne de résistance « sans esprit de recul »sur l’Aisne et derrière la Somme. Il n’y a aucune réserve pour rétablir la situation si elle devait céder. On devra se battre à un contre deux et avec un énorme déficit en artillerie. Dans un premier temps les 20 divisons françaises du groupe d’armées B font face avec énergie et « les pertes allemandes montent en flèche » mais « la profonde dissymétrie est insurmontable » ; le repli vers la Seine est autorisé, puis c’est l’ordre de repli général quand le groupe blindé de Guderian s’engouffre en direction de Châlons-sur-Marne, par la brèche obtenue entre des défenses françaises trop étirées.
Le 10 juin l’Italie déclare la guerre à la France (un article de David Zambon est consacré à l’événement) et le gouvernement Reynaud quitte Paris pour les châteaux de la Loire puis pour Bordeaux (un article de Bernard Lachaise est consacré à Bordeaux, capitale politique éphémère en juin 1940). Paris est déclaré ville ouverte, puis toutes les villes de plus de 30 000 habitants. C’est alors l’heure du choix politique qui conduit à la démission de Reynaud, à la désignation de Pétain comme président du Conseil, à la demande d’armistice et à son acceptation malgré les démarches répétées des Britanniques.
On aurait aimé trouver ensuite un article se synthèse qui s’interroge sur les explications à donner à une aussi totale défaite. L’historiographie récente (relativement récente car l’ouvrage de K.-H. Frieser, Le Mythe de la guerre éclair date de 1995 et sa traduction française de 2003 et les actes du colloque La Campagne de 1940 ont été publiés sous la direction de C. Lévisse-Touzé en 2001) insiste sur le fait que la défaite de la France n’était pas inévitable, que l’issue finale a dépendu des stratégies choisies et des initiatives des généraux allemands sur le terrain, des erreurs françaises aussi. Sur tous ces aspects on lira avec profit le dossier publié dans le n° 352 (avril 2010) de la revue L’Histoire sous le titre « Autopsie d’une défaite. France 1940 ».
François Delpla, auteur d’un livre sur l’appel du 18 juin 1940 signe un article sur « Les débuts chaotiques du gaullisme » qui analyse avec minutie la genèse de l’Appel et ses lendemains immédiats. A Londres, deux tendances s’opposent qui ne voient pas de la même manière une éventuelle allocution du général de Gaulle revenu le 17 dans la capitale britannique : ceux qui, avec Halifax, envisagent encore de demander l’armistice en spéculant sur le silence de Hitler qui n’a pas encore fait connaître ses conditions à la France, ne souhaitent pas que le général s’exprime ; Churchill accepte qu’il parle mais le texte qu’il prononcera doit être rendu compatible avec les derniers efforts faits auprès de Pétain pour qu’il ne signe pas l’armistice. F. Delpla montre que le texte connu n’est pas celui que de Gaulle a prononcé le 18 juin à 22 heures qui ménageait bien davantage le gouvernement français. Le texte connu est celui qui a été publié par les journaux anglais du 19 juin au matin et qui a été durci par Churchill (à moins que ce soit celui d‘une précédente version manuscrite, celle dont les Anglais ont souhaité qu’elle soit adoucie). Il révèle également un discours radiophonique inédit du général de Gaulle prononcé le 23 juin 1940 en soirée pour annoncer la reconnaissance par les Anglais du « Comité national français ».
Signalons enfin un court article de Vincent Bernard consacré à l’exode; il ne tient pas compte de l’ouvrage essentiel que vient de publier Eric Alary sur ce thème et dont la Cliothèque proposera bientôt un compte-rendu.