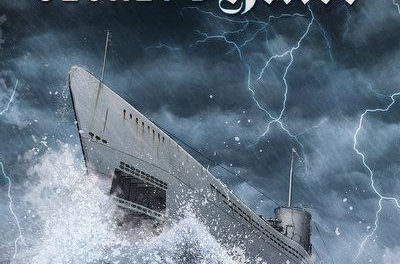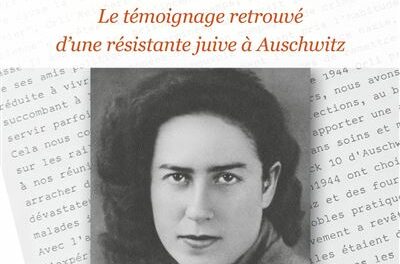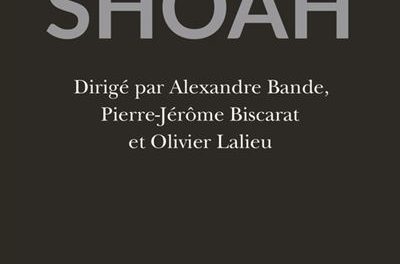Le numéro 14 de la revue est un numéro spécial consacré intégralement à Adolf Hitler, sous le titre « Qui était-il ? Hitler sans masque ». Il s’agit d’un numéro de 96 pages, très abondamment et richement illustré, rassemblant 10 articles tous signés par François Kersaudy, avec la participation de Yannis Kadari.

Chacun de ces articles se présente comme une claire et courte réponse à une question, les 10 questions constituant le sommaire du numéro :
– Un homme exceptionnel ?
– Était-il juif
– Un orateur né ?
– Soldat inconnu de la Grande Guerre ?
– L’antisémite de toujours ?
– L’organisateur ?
– Le vaste monde, une énigme ?
– L’homme à femmes ?
– Était-il fou ?
– Un stratège génial ?
Si certaines de ces questions sont un peu «racoleuses» dans leur formulation, les réponses sont néanmoins sérieuses, claires, bien documentées, sans originalité particulière.
Les photographies sont regroupées dans six « albums » thématiques : Nuremberg, Hitler et la peinture, les manifestations populaires, Hitler et l’automobile, Hitler et les enfants, les horreurs du nazisme. Une iconographie très riche et de bonne qualité : des photographies très nettes, bien mis en page et parfois fort originales est donc intéressantes. Mais il y a aussi plusieurs photographies dont l’utilité n’était pas évidente au regard du thème proposé, photographies très connues concernant le ghetto de Varsovie ou la découverte des camps de concentration. Du moins aurait-elle pu être assorties d’un commentaire critique plus complet : ainsi en est-il à la page 90 de la photographie de l’enfant du ghetto de Varsovie ou de celle, à la page suivante, des déportés photographiés lors de la découverte du camp de Buchenwald.
Un numéro agréable à feuilleter, intéressant à lire pour aller à l’essentiel, un numéro qui répond sans doute davantage à une logique commerciale qu’à des impératifs historiographiques.
Le numéro 15 est consacré aux deux derniers mois de l’année 1941. La majorité des articles traite de l’évolution des opérations militaires. Comme c’est trop souvent le cas de ce type d’article, leur contenu est très pointilliste dans le détail des faits relatés, donnant des précisions dans la masse desquelles le lecteur peine à trouver l’essentiel. Il s’agit là évidemment d’un point de vue subjectif. Avouons-le, ce numéro n’est donc pas celui que nous avons préféré dans la mesure où il nous semble s’éloigner un peu de ce qui faisait l’intérêt des premiers numéros. L’historiographie récente des débuts de la Résistance n’a, par exemple, pas encore trouvé sa juste place. Il n’est sans doute pas facile de s’adresser à la fois à un public qui s’intéresse d’abord aux opérations militaires et à un autre qui cherche à mieux comprendre les questions géopolitiques, politiques, sociales ou culturelles.
La rubrique « Passeurs d’histoire » propose un entretien recueilli par David Zambon avec Pierre Passavin, un dissident martiniquais rallié à la France libre.
« Un matin, alors que je naviguais à bord d’une petite gabare, barrée par le quartier-maître Bianic de la Marine nationale, qui avait l’habitude d’effectuer un peu de cabotage pour transporter les habitants et des marchandises agricoles, nous avons pris brusquement le large. J’ai demandé à Bianic : « Où allons-nous ? » ; « Nous allons rejoindre le général ! » me répondit-il tout de go. » Nous sommes en 1941 et Pierre Passavin n’a que 16 ans.

Leur petite embarcation est arraisonnée le lendemain matin par un destroyer de la Royal Navy. Un officier français se trouvait à bord, « ce qui prouve que les évasions de dissidents étaient parfaitement connues et que des patrouilles étaient sciemment organisées afin de les récupérer. » Les deux hommes sont interrogés à Sainte-Lucie puis conduits à Trinidad. En janvier 1942 Pierre Passavin est transféré aux États-Unis où il suit une formation militaire. Il est ensuite recruté par une délégation française qui a pour mission de constituer un groupe de marins. Il est affecté sur un navire américain, mais au titre des Forces navales françaises libres. Il endosse l’uniforme de la marine américaine, avec l’insigne de la France libre. Il occupe les fonctions de cuisinier ainsi que celle de tirailleurs au canon de DCA en cas d’attaque.
Philibert de Loisy consacre un article au « Camouflage du matériel militaire », un peu abusivement sous-titré « Les débuts de la Résistance française ».
La convention d’armistice stipulait dans ces versions allemande et italienne que « les armes, munitions et matériels de guerre (…) devront être entreposés ou mis en sécurité sous contrôle allemand et italien. » Le camouflage du matériel, dont quelques militaires prirent l’initiative, fut effectivement une des premières manifestations de la Résistance, mais il est exagéré de dire que ce fut le début de « La » Résistance, car celle-ci se manifesta en d’autres lieux, et par d’autres moyens, à la même époque. Il conviendra en outre d’aborder dans le numéro de novembre 2012, le sort d’une partie de ce matériel camouflé, quand viendra l’heure de l’invasion de la zone Sud.
L’article traite des premières initiatives de camouflage de matériel, et donc de la naissance du réseau Camouflage du Matériel (CDM). Cette organisation clandestine de l’armée d’armistice est due à l’initiative de quelques officiers de l’État-major de l’Armée, avec l’accord tacite de ses chefs successifs, les généraux Picquendar et Verneau. L’armée de 100 000 hommes, tolérée par les conventions d’armistice, chargée d’une mission de maintien de l’ordre, n’était dotée que d’un armement léger. Tout l’armement lourd (chars, canons etc.) et les matériels de l’armée vaincue devaient être versés dans les dépôts, sous contrôle des autorités d’occupation. Préparer la revanche impliquait donc de soustraire une partie de ces matériels à ces reversements. Le colonel Zeller, chef du premier bureau de l’État-major de l’Armée, charge le commandant Mollard, d’organiser une structure clandestine, ramifiée jusqu’aux unités, pour regrouper entretenir armement et matériel dans des dépôts camouflés en zone libre, bien souvent chez des civils. Ainsi naît le Camouflage du Matériel (CDM) qui s’installe à Marseille sous la couverture d’une entreprise de mécanique générale. En 1941, il aurait stocké notamment 65 000 armes individuelles, 400 canons, des tonnes de munitions et du matériel de transmission. Les véhicules automobiles sont loués à des entreprises de transport, à charge pour elle de les entretenir. Le revenu de ces locations assure une part importante du budget de l’organisation.
Nicolas Anderbegani propose un portrait de Ferdinand Porsche, « De la Coccinelle au Tigre ».
Ferdinand Porsche est né en 1875, au coeur de la bohème austro-hongroise. Il entre à la manufacture impériale qui fabrique les voitures de la couronne d’Autriche ainsi que celles des royaumes de Suède, Norvège et Roumanie. À Paris, en 1900, il remporte un prix en présentant un prototype de véhicule essence-électrique. Ces compétences lui permettent d’attirer l’attention des grands constructeurs. En 1906, il est recruté par Austro-Daimler en tant que concepteur en chef et, quelques mois plus tard, c’est la Daimler Motoren Gesellschaft, l’ancêtre de la marque Mercedes-Benz qui le recrute. En 1931 il s’installe enfin à son compte à Stuttgart, il travaille en tant que consultant, recrute certains de ses anciens collègues ainsi que son fils. Les activités de son bureau d’études résident dans le conseil pour la construction de moteurs et de voitures. Mais il ne parvient toujours pas à pouvoir construire sa propre voiture.
C’est sa rencontre avec Hitler qui va lui permettre de réaliser son rêve. Pour le régime nazi, l’automobile est un enjeu de taille, industriel, mais surtout social et politique. Le projet Volkswagen était conçu comme un vecteur de paix et d’intégration sociale et comme un outil de propagande « que le pouvoir pourra exploiter pour inscrire le Troisième Reich dans une dynamique de progrès et de modernité ». Porsche, qui voit l’occasion de mener à bien ses projets personnels, répond à l’appel d’offres. « Le courant passe immédiatement » entre Hitler et Porsche : Hitler admire Ferdinand Porsche et « une certaine complicité se tisse » entre les deux hommes.
Porsche devient le personnage le plus influent de l’automobile allemande, s’impliquant à la fois dans le projet Volkswagen, ainsi que dans les projets de compétition automobile. Hitler inaugure la nouvelle usine de Wolfsburg en 1938. Il s’agit de produire une voiture de qualité, en masse à un prix peu élevé, sur le modèle industriel de l’Américain Ford. La commercialisation prévoit une formule de financement révolutionnaire, basée sur la constitution d’une épargne par l’achat de timbres. La réalité sera différente car les ventes de Volkswagen ne concerneront les ouvriers que pour 5 % seulement. Parallèlement à ce projet, Porsche se lance dans la compétition, dominée depuis le début des années 1920 par les écuries italiennes, françaises et britanniques. Porsche produit entre 1934 et 1939 une série de monoplaces très performantes appelées « flèches d’argent », qui remportent des victoires de prestige hautement symboliques.
À partir de septembre 1939, l’usine Volkswagen est affectée à la sous-traitance et à la réparation des avions militaires. Ferdinand Porsche et son bureau d’études sont intégrés au complexe militaro-industriel allemand. Porsche développe un véhicule militaire tout-terrain, puis travaille à la conception de blindés lourds, voir « super lourds ».
Ferdinand Porsche et son fils sont arrêtés en France le 15 décembre 1945, accusés de crimes de guerre pour avoir fait travailler de force des ouvriers français dans leurs usines, durant le conflit. Ils ne peuvent payer que la moitié de la forte amende qui leur est demandée, seul le fils est donc libéré, et son père est retenu 20 mois à la prison de Dijon, sans procès. Libéré en 1947, il retrouve son entreprise, maintenue par son fils. Peu avant sa mort, en 1951, il assistera à la naissance du premier modèle 100 % maison, la fameuse Porsche 356, que James Dean immortalisera dans La fureur de vivre.
L’auteur de l’article pose la question de la responsabilité de Porsche et de la réalité de ses convictions nazies. Il apparaît que Ferdinand Porsche était « pleinement conscient des méthodes employées » et qu’il « pesa de tout son poids pour que ses usines soient bien pourvues en travailleurs ». Il intervint directement auprès d’Hitler pour obtenir la déportation de huit directeurs de l’usine Peugeot de Sochaux. La famille refusant d’ouvrir les archives personnelles aux historiens, il est difficile d’approfondir la recherche sur son idéologie. « Il incarne l’indifférence morale et le productivisme sans bornes d’une élite de capitaines d’industrie qui ont exploité sans vergogne l’Europe et plusieurs millions de travailleurs. »
David Zambon consacre un article à « L’Afrika-Korps en Cyrénaïque », « Le jeu du chat et de la souris ». Il s’agit du récit des événements militaires qui de juin à décembre 1941 chassent Rommel de Cyrénaïque.
Nicolas Bernard, sous le titre « Typhon sur Moscou » relate le « Premier coup d’arrêt pour la Wehrmacht ».
Face à la probabilité grandissante d’une entrée en guerre des États-Unis, Hitler « mise sa propre survie sur un triomphe militaire décisif contre Staline ». La dernière offensive allemande sera donc celle « qui mènera à une paix carthaginoise, laissant survivre le régime communiste, mais se traduisant par des annexions territoriales aussi larges que possible ». Le coup fatal sera porté dans la région de Moscou, avec des effectifs partiellement reconstitués, mais face à un adversaire que les services de renseignement allemands ont, une fois de plus, sous-estimé.
Déclenchée le 30 septembre 1941, l’offensive allemande apparaît d’emblée une réussite presque totale. Von Bock proclame la victoire allemande dans son ordre du jour du 19 octobre 1941, tendis que le général Jodl affirme : « Nous avons enfin, et sans exagération, gagné la guerre ». En Union soviétique le moral est bas, des évacuations massives commencent à Moscou qui perd plus du tiers de sa population, et qui voit partir pour Kouibychev le corps diplomatique et plusieurs institutions politiques. Des incidents antisémites éclatent, les magasins d’alimentation sont pillés, des ouvriers se mettent en grève, on recense des vols de bétail et des kolkhozes arborent des drapeaux blancs. Staline vacille, mais, à la dernière minute, il décide de demeurer au Kremlin et décrète l’état de siège. Une brutale répression rétablit l’ordre et l’Armée rouge reconstitue en hâte un périmètre défensif.
Deux facteurs vont jouer contre la Wehrmacht : d’une part, la résistance soviétique, qui ne faiblit pas, et qui engage des chars T 34 de bonne qualité ; d’autre part les difficultés du ravitaillement : le réseau ferroviaire est saturé, la neige commence à tomber, la pluie aussi, la boue « aspire les véhicules ». Les munitions, les pièces de rechange, les véhicules, l’artillerie et la nourriture cessent d’être acheminés. Puis les températures chutent, « l’état d’hypothermie, de diarrhées, de crampes d’estomac se multiplient ». Les tenues chaudes font défaut, aussi les Allemands décident-ils d’une part, de s’équiper aux dépens de la population locale qui se voit dépouillée de ses vêtements chauds, d’autre part, d’acheminer par le train des tenues hivernales jusqu’au front. Mais le réseau ferroviaire allemand est saturé et l’aggravation du froid finit par endommager les locomotives.
Malgré ses pertes, l’armée soviétique dispose d’importantes réserves tandis que l’armée allemande est usée. Ses chefs décident pourtant de tenter une dernière offensive, le 15 novembre 1941. Les 5 et 6 décembre, les Soviétiques contre-attaquent. Partout, les troupes hitlériennes décrochent, se replient, voire fuient, abandonnant leur matériel. Ce qui a été conquis en novembre est perdu en deux semaines. Hitler ordonne de tenir sur place et destitue les officiers qui manifestent leur désaccord ou leur lassitude. « Pour la première fois, l’armée nazie est battue en rase campagne est contrainte à la retraite (…) L’échec de l’armée allemande résulte avant tout de ses choix opérationnels délirants (…) Sous-estimant la réalité du terrain et du climat, l’État-major n’a cessé de s’accrocher à l’idée d’un immense encerclement de la capitale. Cette chimère s’est vite noyée dans la boue, laissant à l’armée rouge le répit indispensable pour se renforcer. »
Trois articles constituent le dossier de ce numéro, consacré à la « Guerre dans le Pacifique ».
« Tora, Tora, Tora ! » de Yann Mahé relate l’offensive japonaise du « 7 décembre 1941 : jour d’infamie ».
Dans, « Pearl Harbor : un complot américain ? », Nicolas Bernard fait le point sur la fameuse accusation portée contre Roosevelt d’avoir laissé faire les Japonais afin de pouvoir engager son pays dans la guerre.
Il montre qu’il s’agit là de « théories fumeuses », qui « pêchent par simplicité et, surtout, reposent sur un nombre ahurissant de contrevérités ». Roosevelt n’était pas désireux de déclencher la guerre dans le Pacifique ; il a davantage répliqué aux agressions impérialistes japonaises qu’il ne les a préméditées. Ainsi l’embargo pétrolier, prononcé contre le Japon en juillet 1941, ne faisait-il que répondre à l’occupation militaire de l’Indochine et visait à dissuader les Japonais d’étendre leur conquête. Il cherchait, en outre, à gagner du temps pour consolider ses défenses aux Philippines et, de toute manière, personne à Washington n’imaginait que Pearl Harbor put constituer la cible. Ajoutons que le racisme a conduit les Américains à sous-estimer le niveau technologique de l’aéronavale japonaise et, enfin, que les dysfonctionnements du renseignement américain le rendaient peu efficace. « Il faut considérer que ni Roosevelt ni Churchill n’ont sciemment poussé le Japon à la guerre, ni envisagé un seul instant qu’il allait s’en prendr à Pearl Harbor. »
Dans « L’Asie-Pacifique s’embrase », Fabrice Jonckheere présente la conquête japonaise de la « Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale » dans les premiers mois de 1942 : conquête de la Malaisie, des Philippines, de l’île de Guam, de Hong Kong, de Singapour, de Sumatra, de Java, de la Birmanie. « L’empire nippon atteint son apogée territoriale lors des mois d’avril et de mai 1942. Il contrôle peu ou proue l’ensemble de l’Asie, de la Corée et à la frontière indienne et aux eaux territoriales australiennes. » Désormais la stratégie de l’amiral Yamamoto ne consiste plus à étendre la ligne de front mais à écraser la flotte américaine dans le Pacifique central, d’où la bataille de Midway, premier revers sérieux pour les Japonais.
Un article de Xavier Tracol raconte un « raid audacieux des hommes-grenouilles italiens » dans le port d’Alexandrie en décembre 1941, « Le viol d’Alexandrie ».
Un article d’Alexandre Thers est consacré à « L’épopée des tigres volants », une escadrille de volontaires américains combattants aux côtés des troupes de Tchang Kaï-chek avec, apposé sur le fuselage de leurs appareils, un insigne représentant un tigre ailé, imaginé par Mme Tchang Kaï-chek est réalisé par les studios Disney.
Ajoutons pour être complet :
– Quelques extraits d’un livre de François Kersaudy, « Le monde selon Churchill. Sentence, confidences, prophéties, réparties »
– Un petit article de Jérémy Ferrando consacré au « cinéma soviétique à l’épreuve de la guerre ». Mobilisés pour l’effort de guerre au même titre que le reste de la société, des dizaines d’opérateurs sur le front produisent, en 1941, « des documents filmés impressionnants ». En décembre 1941, les combats autour de Moscou sont filmés par des équipes mobiles, et montrés en février 1942 en URSS sous le titre : « Défaite allemande devant Moscou ». Hollywood rebaptise le film en « Moscou Strickes Back » et lui décerne un Oscar en 1943. « De par sa force de propagande, ce film d’actualité, devint l’emblème évident de l’alliance, le temps d’une guerre, entre les deux grands États du globe. »