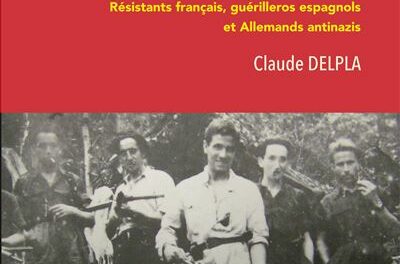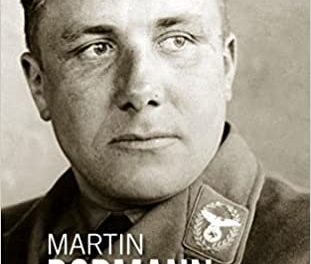Quatre articles composent un dossier de vingt pages consacré à « La Shoah par balles ». Ils montrent la grande diversité des modalités d’assassinat de masse (qui ne se réduisent pas aux fusillades), la participation active de l’armée allemande aux côtés des commandos de tueurs et la sauvagerie hallucinante des populations civiles qui participèrent activement et volontairement aux opérations de tueries collectives.
Marie Moutier travaille depuis deux ans dans l’association Yahad-in-Unum, présidée par le Père Patrick Desbois (le numéro 4 de cette revue a publié un entretien avec Patrick Desbois); doctorante, elle se rend sur le terrain en Ukraine et en Russie. Elle propose un article sur les unités mobiles de tueurs : « Les Einsatzgruppen et la Shoah par balles ». Les chercheurs utilisent diverses sources complémentaires pour étudier ces massacres de masse : les rapports rédigés par les chefs des Einsatzgruppen et envoyés à Berlin, les travaux de la Commission extraordinaire soviétique, les procès d’après-guerre (dépositions des victimes rescapées et des tueurs), les enregistrements récents des témoins des fusillades par l’équipe de Patrick Desbois. Les Einsatzgruppen sont des unités SS créées en 1938 mais dont le premier champ d’intervention important fut la Pologne où ils éliminèrent une grande partie de l’intelligentsia et où ils expérimentèrent les techniques de tueries de masse. Après l’invasion de l’URSS, les quatre Einsatzgruppen (3000 hommes) ont pour mission d’éliminer les opposants au Reich au fur et à mesure de l’avancée de la Wehrmacht. Ils nomment des responsables politiques locaux qui leur sont favorables et qui leur indiquent les domiciles et les identités des populations juives. Ils sont aidés dans leurs actions de tueries par des milices locales composées de volontaires. Les fusillades génocidaires commencent dès août 1941 (33 000 personnes sont assassinées dans le ravin de Babi Yar, près de Kiev, du 28 au 30 septembre 1941). La rapidité d’action des unités de tueurs est étonnante ; « face à des ordres flous, ils prennent de nombreuses initiatives, concernant notamment l’organisation des fusillades elles-mêmes ». Marie Moutier insiste sur l’implication de la population locale dans l’organisation des massacres, « intégrée de gré ou de force dans le processus génocidaire ».
Alexandre Thers fait le point sur « L’implication de l’Armée allemande » dans la Shoah. Les hauts responsables de la Wehrmacht ont été séduits par la doctrine nazie ; ainsi Von Manstein affirme-t-il que « le système judéo-bolchévique doit être exterminé ». Dès la campagne de Pologne, la collusion entre Wehrmacht et Einsatzgruppen est évidente ; ils travaillent de concert et de façon complémentaire. La Wehrmacht apporte sans rechigner son soutien aux tueries génocidaires, très peu d’officiers généraux protestent. Les rapports des Einsatzgruppen louent l’état d’esprit des militaires qui leur apportent un indispensable soutien logistique. La Wehrmacht livre aux Einsatzgruppen les commissaires politiques de l’Armée rouge qui sont prisonniers de guerre pour qu’ils les assassinent.
Mathieu Boisdron traite de « La Roumanie d’Auntonescu dans la Shoah ». Dans ce pays où l’antisémitisme est une réalité profonde, les Juifs sont considérés comme les alliés objectifs des Soviétiques qui se sont emparés de la Bucovine et de la Bessarabie en juin 1940, en vertu du pacte Molotov-Ribbentrop. La reconquête des provinces perdues dans le cadre de l’offensive contre l’URSS en juin 1941 est « l’occasion tant attendue de régler des comptes avec une communauté stigmatisée depuis des décennies ». Les massacres sont réalisés par les autorités roumaines (police, gendarmerie, armée) avec une importante participation de la population civile, armée à cette fin. D’innombrables massacres accompagnent la reconquête de la Bucovine et de la Bessarabie, « exécutions sommaires au bord de la chaussée au hasard des rencontres, mutilation des corps, incendies des habitations, exécutions dans des fosses communes, pendaisons, viols suivis de meurtres, noyades, humiliations et lynchages publics, etc. ». « C’est bien la diversité inouïe des méthodes employées qui sont la règle de cette Shoah à la roumaine ». En août 1941, les Roumains se voient confier une zone d’occupation en URSS, la Transnistrie (entre Dniestr et Bug). Ils y massacrent les populations juives et tziganes.
La situation est tout aussi horrible dans les pays baltes comme le montre l’article de Yann Mahé, « Le génocide des Juifs dans les pays baltes ». La Wehrmacht y fut accueillie en libératrice par la population ; « ivres de vengeance après un an d’occupation soviétique, les organisations nationalistes lituaniennes, lettones et estoniennes –dont certaines sont connues pour leur antisémitisme viscéral- suivent allègrement les recommandations qui leur ont été faites par leurs parrains allemands de monter la population locale contre les Juifs et les communistes qui n’ont pas eu le temps de fuir ». La propagande affirme que les Juifs ont accueillis les Soviétiques à bras ouverts en 1940 et se sont engagés dans le NKVD. La haine des populations civiles baltes est d’autant plus dévastatrice que les élites intellectuelles porteuses de l’idéologie des Lumières ont été massacrées par les Soviétiques. Une violence inouïe se déchaîne, « remontée de la barbarie ». A Kaunas par exemple, « la mise à mort se déroule selon un rituel d’une sauvagerie à peine imaginable. Elle a lieu la plupart du temps de jour et en place publique, à la vue de tous. Sur une esplanade de la ville, des miliciens (…) amènent des dizaines de Juifs devant les badauds et les mettent à mort à coups de barres de fer et de pieds-de-biche. A chaque coup asséné sur la tête d’un malheureux, des cris de joie, des applaudissements, des « bravos » s’élèvent de la foule (…) Crânes ouverts, membres désarticulés provoquent l’hilarité (…) Les corps sont emmenés et un Lituanien passe un coup de tuyau d’arrosage pour nettoyer la place… et le cycle infernal reprend avec un autre groupe de victimes (…) ». Par la suite les nazis s’installent. C’est le brutal général SS Friedrich Jeckeln qui est chargé d’assassiner les Juifs baltes qui ne l’ont pas encore été. Il le fait avec efficacité et ingéniosité durant tout l’hiver. A la fin du mois de décembre 1941, 180 000 des 220 000 Juifs lituaniens, 59 000 des 74 000 Juifs lettons et la moitié des 2000 Juifs estoniens ont été assassinés. Ce bilan terrifiant résulte en grande partie de la participation active et directe de la population locale aux opérations génocidaires nazies.
Johann Chapoutot consacre un article à « Adolf Eichmann. Bureaucrate insignifiant ou soldat de l’idéologie nazie ? ». Une brève biographie d’Eichmann rappelle qu’il adhéra au parti nazi et à la SS dès 1932 puis qu’il intégra rapidement le SD (service de renseignements SS créé par Heydrich). D’abord chargé de réfléchir à l’émigration des Juifs en Palestine, il fut nommé en octobre 1939, chef d’une direction du RSHA (Office central de sécurité du Reich, créé par Himmler et Heydrich) et travailla au projet de déportation des Juifs à Madagascar. Il fut enfin le responsable de l’acheminement des Juifs vers les camps d’extermination. Repérer, dénombrer, spolier, rassembler, transporter : « il a été l’ordonnateur efficace de la logistique criminelle nazie et a fait preuve, jusqu’au bout, d’une énergie sans concession ». Une récente biographie de D. Césarini (Tallandier 2010) met en évidence le fait qu’il fut un responsable (et non un simple agent d’exécution) et qu’il était un homme de terrain (et non un bureaucrate), faisant de fréquents et nombreux voyages.L’article de J. Chapoutot est une démonstration en trois points.
1. Eichmann a mis en scène son personnage durant son procès à Jérusalem en 1961. Face à l’accusation, pour tenter de sauver sa vie, il a joué le rôle d’un petit fonctionnaire subalterne, d’un rouage, d’une machine à recevoir et à appliquer les ordres. Il a nié toute adhésion au projet nazi, toute motivation idéologique. « Jouant sur les poncifs , il flatte un horizon d’attente alternatif à celui du montre nazi, en prétendant qu’il ne fut qu’un officier borné, dont le sens critique était anesthésié par une éducation autoritaire et les vertus contraignantes d’un serment d’obéissance ».
2. Hannah Arendt a pris l’image qu’il donnait pour la réalité, d’autant plus facilement que cette image confirmait sa lecture du monde contemporain. « Comme Heidegger, son ancien professeur et ami, Hannah Arendt voit dans les phénomènes sociaux du temps présent (développement des bureaucraties publiques et privées, du capitalisme destructeur du monde et des hommes) l’œuvre d’une humanité qui ne pense pas, qui calcule certes les moyens de ses fins (comment faire ?), mais qui n’interroge jamais ces fins elles-mêmes (pour quoi faire ?) (…) Eichmann est une validation empirique de cette thèse : le crime majeur de l’histoire humaine, qui a exigé la mise en œuvre de moyens logistiques et industriels considérables, habituellement consacrés à la production et à l’échange marchand, qui a exigé une planification et une coordination rationnelle sans faille, a été commis par des hommes comme Eichmann (…) Il n’était pas méchant, il était indifférent. » Eichmann devint un « criminel de bureau », illustration de « la banalité du mal ».
3. Eichmann n’était pas celui qu’il s’efforcé de faire croire qu’il était. En 1956 et 1957, à Buenos Aires, Eichmann a eu de nombreux entretiens avec un ancien SS hollandais, Willem Sassen. Des dizaines d’heures de conversation ont été enregistrées sur 67 bandes magnétiques déposées aux Archives fédérales allemandes. Un autre Eichmann s’y révèle : « un assassin de masse convaincu, un criminel idéologique qui embrasse pleinement les fins et les justifications nazies », un être imprégné de la vision du monde nationale-socialiste, convaincu que « le Juif nous a déclaré la guerre » et que l’extermination des Juifs est un acte de combat, nécessaire et honorable, regrettant de n’avoir pas atteint le chiffre fixé à la conférence de Wannsee. « Ce qu’il dit librement à Buenos Aires est plus fiable que ce qu’il prétend à Jérusalem : le bureaucrate méticuleux était bel et bien, comme il le dit lui-même, un combattant fanatique ».
Signalons que se tient actuellement au Mémorial de la Shoah à Paris l’exposition « Juger Eichmann. Jérusalem,1961 ».
La rubrique « Passeur d’Histoire » propose un entretien avec l’historien américain Robert Paxton. Il revient sur les raisons qui le conduisirent à prendre la France des années Quarante comme champ de recherche, sur sa thèse consacrée au corps des officiers de l’Armée de l’armistice et bien sûr sur la publication en France de « La France de Vichy » en 1973. Rappelons que cet ouvrage mit à mal la théorie du « bouclier et de l’épée » exposée par Robert Aron en 1954, selon laquelle Pétain et de Gaulle auraient eu deux fonctions complémentaires durant la Seconde Guerre mondiale : l’un servant de « bouclier » devant les exigences allemandes, l’autre combattant aux côtés des alliés. Paxton rappelle que l’ouvrage fut refusé par Gallimard et que Le Seuil engagea deux jeunes historiens, Jean-Pierre Azéma et Michel Winock, « pour passer le texte au peigne fin (…) et être certain que tout était bien fondé sur des documents ». Certaines critiques furent violentes, les recherches de Paxton démontrant que la collaboration n’avait pas été une exigence allemande mais un choix politique du régime de Vichy et qu’elle avait permis au Reich d’exploiter la France. Ce livre ouvrit une ère nouvelle de la mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale. Paxton confirme enfin les conclusions de ses travaux sur les effectifs des troupes d’occupation en France : 30 000 à 40 000 hommes seulement ; « les Allemands ne contrôlaient pas vraiment le territoire français », ce sont les services de police allemands, aidés par des informateurs français qui ont réprimé la Résistance. Il annonce un article à paraître sur ce sujet à la fin de l’année.
Alexandre Thers revient sur un événement qui n’est pas exactement contemporain des deux mois qui sont le cadre chronologique de ce numéro, « La révolte arabe en Palestine de 1936-1939. Les débuts d’un conflit sans fin ». Depuis 1933, arrivée de Hitler au pouvoir, on assiste à une recrudescence de l’immigration juive en Palestine. En 1935, on dénombre 443 000 colons et les Arabes craignent de les voir constituer la majorité de la population, d’autant plus que leur impact sur la vie économique est très fort (ils détiennent 70% des terres et des entreprises industrielles). Le contentieux débouche sur une insurrection nationaliste arabe en avril 1936, dont le mufti Hadj Amin al-Husseini devient le chef spirituel. Les revendications sont claires : arrêt immédiat de l’immigration juive, interdiction de tout transfert de propriété d’Arabes palestiniens à des colons juifs, établissement d’un gouvernement démocratique dans lequel les Arabes palestiniens seraient dominants, conformément à leur supériorité numérique. Les Britanniques optent pour la répression tandis qu’interviennent aussi deux organisations juives : la Haganah et l’Irgoun. En octobre, la révolte est écrasée. Une commission d’enquête (la commission Peel) est mise en place par les Britanniques en novembre 1936 ; elle recommande la fin du mandat et la partition en deux Etats, l’un palestinien, l’autre juif. Cette proposition est rejetée par les Arabes et par une partie des sionistes ; l’insurrection reprend. Cette nouvelle phase de la révolte est essentiellement antibritannique ; elle repose sur les paysans et sur les bédouins, les classes moyennes et aisées se faisant discrètes. La révolte est de plus grande ampleur et culmine à l’automne 1937. Irgoun et Haganah joignent leur forces à celles des Britanniques ; l’insurrection se divise ; plusieurs chefs sont assassinés et elle s’éteint finalement en mai 1939. Elle engendre un revirement complet de la politique britannique qui va désormais freiner l’immigration juive pour se concilier les populations arabes dans une zone de grande importance stratégique.
François Delpla consacre un court article à « La conférence de l’Atlantique » : rencontre du 9 au 12 août 1941, dans une baie de Terre-Neuve, de Churchill et de Roosevelt, et signature de la « Charte de l’Atlantique » qui marque pour les Etats-Unis une étape supplémentaire vers l’entrée en guerre et vers leur participation aux décisions de l’après-guerre.
Dominique Lormier présente « La campagne de Syrie ». En juin-juillet 1941, les forces armées anglo-gaullistes combattent les troupes vichystes du général Dentz qui adhère pleinement à la politique de collaboration accrue avec l’Allemagne, inaugurée par Darlan avec la signature des Protocoles de Paris. Vaincu, Dentz signe avec les Britanniques l’armistice de Saint-Jean d’Acre, ignorant le général Catroux, représentant de la France libre. De Gaulle ne pouvait accepter un accord qui permettait à la Grande Bretagne d’avoir la mainmise sur tout le Proche Orient. Il rétablit la souveraineté française sur la Syrie et le Liban et contraint Churchill à l’accepter.
Yannis Kadari signe un article consacré à « Malte, verrou de la Méditerranée ». A 90km de la Sicile, 300 km de la Tunisie, 350 km de la Libye, cette possession britannique commande les lignes de communication entre l’Italie et l’Afrique du Nord ainsi que la route Gibraltar-Alexandrie ; elle est aussi un pont-clef du système de communication télégraphique sous-marin reliant Londres à l’Inde et à Hong-Kong, sans aucune possibilité d’écoute. C’est une base navale moderne que les Italiens et les Allemands se sont efforcés de conquérir à de multiples reprises et que les Britanniques sont parvenus à défendre.
A noter enfin, deux très courts articles consacrés l’un à « Monaco durant la guerre » (Patrick Rouveirol), l’autre au « cinéma sous l’Italie fasciste » (Jérémy Ferrando).