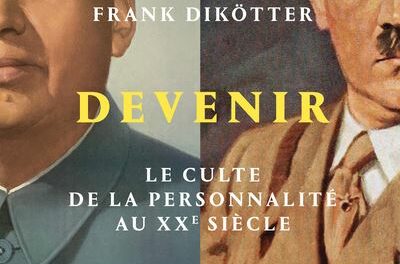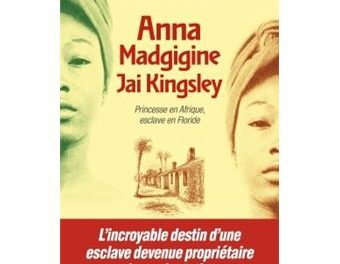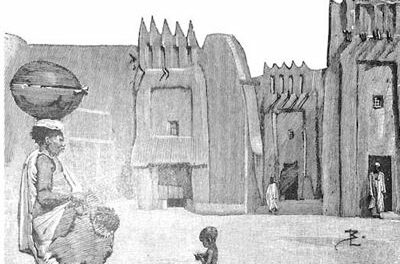L’histoire culturelle ne cesse d’élargir ses territoires de recherches. Après s’être intéressés et avoir depuis longtemps étudié toutes les formes d’art et les artistes qui leur sont attachés, les historiens de la culture s’intéressent désormais aux « intermédiaires culturels » : « Plutôt que d’observer soit les artistes et leur environnement, soit les publics ou les commanditaires et leurs pratiques, nous avons choisi de nous intéresser aux activités intermédiaires qui s’emploient, à travers des activités diverses, à les mettre en relation : agents d’artistes, galeristes, programmateurs, financeurs, promoteurs, etc. » (page 3). Outre le présent numéro du Mouvement social, Olivier Roueff et Séverine Sofio, dans leur éditorial, signalent deux autres publications sur le sujet : Intermédiaires du travail artistique, à la frontière de l’art et du commerce (2010) et les actes d’un colloque de 2012, intitulés Intermédiaires et prescripteurs au centre de la création, à paraître.

Les articles de ce numéro du Mouvement social, dont la majorité des auteurs ne sont pas des historiens mais des sociologues ou des « politistes », et dont beaucoup sont écrits à plusieurs mains, sont regroupés en trois parties thématiques : une première porte sur « Les intermédiaires collectifs et la question du placement », une seconde sur « Les collectifs d’employeurs et la fabrique des territoires professionnels » ; la troisième et dernière partie est intitulée : « Intermédiations collectives et marchés mondialisés »Le sommaire complet est consultable sur le site de la revue, http://www.lemouvementsocial.net/, ou sur le site Cairn.info, http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm.
Dans la première partie, on peut notamment lire un article sur l’histoire de personnages que l’on peut voir de temps en temps sur les écrans de télévision ou dont on peut lire le nom dans la presse : les agents artistiques. Delphine Naudier, l’auteure de cet article intitulé « La construction sociale d’un territoire professionnel : les agents artistiques », replace l’histoire de cette catégorie professionnelle particulière dans le contexte de l’histoire du placement qui a concerné l’ensemble des professions au moins jusqu’à la Deuxième guerre mondiale. Elle rappelle notamment que cette activité, après avoir été totalement libéralisé sous la Révolution, a connu « un long processus de réglementation qui a d’abord concerné principalement l’embauche des ouvriers, des artisans et des domestiques. » (page 41). Dans le domaine des arts, l’activité de placement émerge au XVIIIe siècle du fait du développement des marchés artistiques. Elle s’organise assez rapidement en agence : « Au début du XIXe siècle, quatre agences sont répertoriées. Elles placent les artistes et éditent des pièces de théâtre où sont définis les emplois de comédiens, activités qui échappent aux auteurs. Elles participent en outre à la diffusion en province et à l’étranger de mises en scène qui échappent aux auteurs » (page 42).
Le placement est exercé aussi en dehors des agences par des personnages plus ou moins honnêtes si bien que la nécessité de « contrôler et moraliser l’activité » (page 44) s’impose rapidement : « L’entreprise de moralisation des pratiques se développe selon un double mouvement qui passe d’abord par la stigmatisation des « escrocs » à l’intérieur même de l’activité de placement. Une catégorisation très révélatrice de l’hétérogénéité du monde du placement distingue « les agences assises, [avec] un domicile, et une adresse », les « agences debout, qui sont moins stables », et les « agences au pied levé » dont les « vagues mais très actifs représentants […], également baptisées « les pieds humides », se tiennent également sur le trottoir, devant certains cafés où les artistes en quête d’engagements ont établi leurs lieux de réunions sur le coup de six heures, au moment de l’apéritif » (page 44Les citations sont tirées par Delphine Naudier de G. REUILLARD, « Marchands d’artistes », Excelsior, 5 février 1932.). Cette situation entraîne un développement de la réglementation de la profession et la création d’une législation spécifique, en particulier après la Première Guerre mondiale comme le montre Delphine Naudier.
L’encadrement légal et réglementaire de la profession d’agent artistique est cependant remis en cause en 1945 par une ordonnance et deux conventions de l’OIT qui posent le « principe de la suppression des bureaux de placement payants » (page 45). Dans ce contexte, les agents artistiques en place, disposant d’une licence leur permettant d’exercer leur profession, obtiennent une dérogation « viagère » qui leur permet d’exercer leur métier et d’engager des collaborateurs, qui exercent la même activité mais ne possèdent pas de licence. Certains de ces collaborateurs finissent par gérer des « portefeuilles d’artistes » beaucoup plus importants que ceux de leur parton, à l’instar de Felix Marouani qui compte parmi ses clients, entre autres, Tino Rossi, Maurice Chevalier, Mistinguett et Joséphine Baker. Cela ne va pas sans engendrer des tensions. En outre, le développement de la télévision transforme les conditions d’exercice du métier d’agent d’artistes. Une loi de 1969 vient donc modifier la réglementation, notamment l’attribution des licences qui sont désormais renouvelables chaque année. En 2010, une nouvelle loi change à nouveau le cadre réglementaire dans lequel s’exerce cette profession, dans le sens d’une libéralisation. Elle est en effet le fruit de la transposition dans le droit français de la fameuse « directive Bolkenstein ». Elle prévoit en particulier la suppression de la licence : « La loi du 22 juillet 2010 et ses décrets d’application parus en mai et août 2011, qui appliquent la directive « services », modifient les conditions d’entrée dans l’activité. La licence n’est plus nécessaire pour exercer. Les aspirants doivent s’inscrire sur un Registre national des agences artistiques auprès du ministère de la Culture » (pages 49-50). A travers ce rapide résumé, on voit bien comment l’histoire des « intermédiaires culturels » participe à l’histoire sociale et comment l’histoire d’une catégorie socioprofessionnelle bien singulière, celle des agents artistes, donne à réfléchir sur l’histoire du travail et du marché du travail en général à l’époque contemporaine.
On peut par ailleurs lire dans cette livraison du Mouvement social plusieurs contributions qui portent sur des problèmes transnationaux et montrent les effets de la mondialisation dans le domaine de la culture. Julie Verlaine présente ainsi une étude comparée de deux associations professionnelles de marchands d’art à Paris et New-York après la Deuxième guerre mondiale qu’elle a intitulée : « Les associations professionnelles de marchands d’art après 1945 : lobbying et modernisation à Paris et New-York. » Elle s’intéresse donc indirectement à un marché largement mondialisé, celui des œuvres d’art. Elle montre notamment comment le Comité professionnel des galeries d’art, fondé en 1947 à Paris, et l’Art Dealers Association of America créée la même année à New-York mais qui ne fonctionne véritablement qu’à partir de 1962, ont connu des histoires à la fois parallèles et croisées : parallèles car ces deux associations professionnelles ont des objectifs en partie communs ; croisées car l’une a pu inspirer les actions de l’autre et parce qu’elles incarnent en partie la rivalité entre les deux « capitales historiques du marché de l’art » (page 53).
Dans « La Fédération internationale des associations de production de films : un acteur controversé de la promotion du cinéma après 1945 », Caroline Moine montre l’importance de cette organisation transnationale dans l’histoire du cinéma au XXe siècle. Créée dans les années 1930 en Europe, la FIAPF change de visage après la Deuxième guerre mondiale lorsqu’elle est rejointe, en 1951, par l’association des producteurs américains, la Motion Picture Association of America, qui a auparavant joué « un rôle essentiel dans les accords signés à Washington avec différents pays européens » (page 95), en particulier les accords Blum-Byrnes pour ce qui concerne la France. Contre les partisans du protectionnisme national, la FIAPF devient le porte-parole des pays producteurs et exportateurs favorables à l’établissement d’un vaste marché sans barrières. » (page 97). Caroline Lemoine revient ensuite sur les oppositions et les résistances qu’a rencontrées la FIAPF au sein même du monde du cinéma. Son article, dont tous les aspects n’ont pas été évoqués, permet au total de disposer d’un regard historien sur une question d’actualité à l’heure où l’on critique la volonté de la France d’écarter les produits culturels des négociations d’un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et Union Européenne.
La lecture des articles de ce numéro du Mouvement social, sur un sujet que l’on pourrait considérer de prime abord comme une « affaire » de spécialistes de l’histoire culturelle ou même d’un domaine de celle-ci, permet pourtant d’aborder sous un angle original des questions qui traversent toute l’histoire contemporaine. A ce titre, il ne peut qu’enrichir la réflexion des enseignants d’histoire.