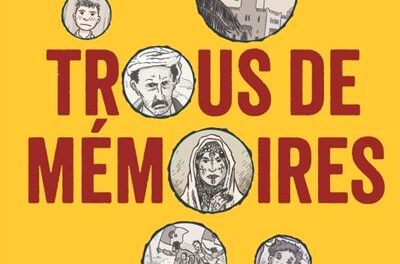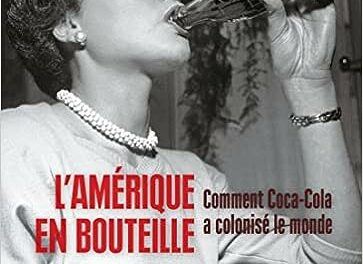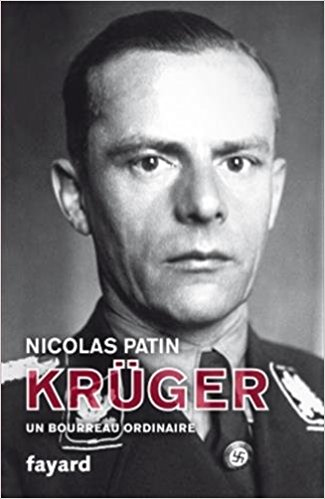
Le 10 août 1914 un jeune homme en uniforme se recueille devant une tombe dans le village de Retinne en Belgique. Cette tombe est celle de son père, Alfred Krüger, colonel dans l’armée de Karl von Bülow et tombé cinq jours plutôt. Ce jeune homme, Friedrich-Wilhelm Krüger, est officier dans le régiment « von Lützow ». En ce jour Krüger, pourtant militaire de carrière, est loin d’imaginer les quatre années qu’il va passer en France, Belgique, Ukraine… A la fin de ce cauchemar, en novembre 1918, il refuse de déposer les armes et s’engage dans un corps-franc. En cela il est un bel exemple de cette génération qui reste une génération de soldats et déplace la violence guerrière des tranchées dans l’espace politique où pour eux le combat continue. Krüger ne revient à la vie civile qu’en 1920 avec des perspectives peu encourageantes.Le 6 avril 1944 le SS Obengruppenführer et général de police Krüger adresse une lettre à Maximilian von Herff qui gère l’EM personnel d’Himmler dans laquelle il dresse un bilan amer de sa participation à la guerre. Ce jour là Krüger quitte Cracovie où il est en poste depuis octobre 1939. Il estime avoir perdu son honneur, celui proclamé par la devise SS « Mon honneur s’appelle fidélité ». En effet, cette fidélité n’a pas été récompensée puisqu’il a été désavoué par Himmler en personne et relevé de ses fonctions de HSSPF (Chef suprême des SS et de la police) en novembre 1943. Krüger demande alors à Himmler de redevenir un « vrai soldat ». Dans une lettre adressée directement au Reichsführer SS il écrit : « Je viens d’une famille de soldats ; je me suis toujours senti soldat intérieurement ». Il souligne par ailleurs qu’il a jusqu’alors accepté de se battre « politiquement ».
L’éviction de Krüger pourrait laisser croire qu’il n’a pas accompli correctement sa tâche. Il n’en est rien. Il est tout simplement évincé pour avoir perdu le bras de fer qui l’opposait à Hans Frank, le gouverneur civil de la Pologne occupée (Gouvernement Général). En effet, dès 1940 une lutte acharnée s’est installée entre les deux hommes qui représentaient pour l’un les intérêts d’Himmler et de la SS (Krüger) et pour l’autre ceux d’Hitler ainsi que les siens propres (Frank). Krüger dirigeait une zone de colonisation de 500 km (de Cracovie à Ternopil et de Varsovie à la Roumanie). Il a donc opéré sur une vaste échelle. Dans cet espace il a dirigé « l’opération extraordinaire de pacification » (AB-Aktion) qui visait à détruire la résistance polonaise ainsi que l’intelligentsia. Par ailleurs, le ghetto de Varsovie se trouvait sous son contrôle et il était le supérieur direct de Jürgen Stroop, le responsable de la liquidation du ghetto en 1943. C’est sur le territoire de Krüger qu’ont été érigés Belzec, Treblinka, Sobibor et Majdanek. Si l’on retient habituellement les noms de Himmler et d’Odilo Globocnik, chef de la police du district de Lublin, « créateur des camps de la mort » et « architecte du génocide », entre les deux on trouve Krüger.
Le 19 juillet 1942 Himmler envoie à Krüger une lettre ordonnant que « la transplantation de la totalité de la population juive du Generalgouvernement soit menée à bien et achevée d’ici au 31 décembre 1942 ». Cette lettre n’est autre que l’annonce, à peine codée, de l’extermination des juifs polonais. La région dirigée par Krüger est particulière car l’on y trouve 1,8 million de Juifs dont très peu survivront. De plus des Juifs d’autres nationalités sont acheminés pour être exterminés (dans les camps ou par les Einsatzgruppen). Cependant, Krüger n’était pas omnipotent et la compétition faisait rage entre les différentes officines nazies. Néanmoins c’est lui qui dirigeait les différentes formations policières (Orpo, Sipo…) et durant les quatre années de son mandat la Pologne fut ravagée. Krüger signa tous les décrets mettant en œuvre la politique de destruction. En 1944, 30 ans se sont écoulés depuis « l’entrée en guerre » de Krüger. Il a alors 50 ans, une femme, deux enfants. Krüger continue cependant à se battre jusqu’au bout sur le front car, en réalité, il ne s’est jamais « démobilisé » au cours de cette « Seconde Guerre de Trente Ans » (Albert Muller, « La Seconde Guerre de Trente Ans. 1914-1945 », 1947).
Nicolas Patin se pose la question de l’intérêt d’un tel livre qui va s’ajouter à la longue liste des ouvrages consacrés aux bourreaux et alimenter une historiographie du nazisme qui jamais ne se tarit. En effet, depuis la parution des « Bienveillantes » de Jonathan Littell en 2006, la figure du bourreau occupe l’espace intellectuel et ce phénomène, qui ne se limite pas à l’Hexagone, suscite de vifs débats. Or, c’est un peu par hasard (ce n’était pas l’objet de ses recherches) que Nicolas Patin découvre le volume V du journal personnel de Krüger dans les archives de Coblence. Il lit ainsi le récit de Friedrich-Wilhelm Krüger, jeune soldat des tranchées de 14-18. Cette lecture aiguise sa curiosité et, sachant que ce Krüger était devenu par la suite un des principaux bourreaux nazis, il se met à rechercher les quatre premiers volumes. Après une quête difficile il découvre ces volumes du journal de Krüger qui s’étend jusqu’en 1932 et qui offre une explication exceptionnelle de l’adhésion au nazisme. Il découvre ensuite un nouveau volume datant de 1938-1939 à Stanford en Californie. Pourquoi un tel éparpillement des sources entre l’Allemagne (Fribourg, Coblence) et les Etats-Unis ? Ainsi d’autres feuillets de la main de Krüger datant de 1944 se trouvent eux au Mémorial de Washington. Cette dispersion des sources explique en partie qu’il n’existait pas jusqu’alors d’ouvrages consacrés à Krüger. Enfin, Nicolas Patin a réussi, non sans mal, à rencontrer l’un des fils de Krüger.
L’auteur souligne la difficulté de l’exercice auquel il s’est livré : la fréquentation quotidienne d’un bourreau nazi peut se révéler douloureuse (ceci n’est pas sans rappeler les propos récents de Johann Chapoutot quant à sa volonté de s’éloigner de l’étude du nazisme). S’il est évident que l’empathie ne peut être convoquée, un rejet radical et absolu empêche toute compréhension. En effet, la figure du bourreau pose des questions morales essentielles et les réponses toute faites ou trop hâtives se révèlent peu satisfaisantes. Tout d’abord Nicolas Patin ne comprend pas comment ce jeune soldat, plutôt sympathique, de la Grande Guerre a pu devenir ce monstre fanatique. Il s’interroge également sur l’historiographie du nazisme et en particulier sur le genre à part que constituent les biographies de bourreaux. Selon lui, depuis 1945, ce genre est passé par deux phases. Dans la première phase le bourreau est placé « hors humanité » et est réduit à une figure barbare et monstrueuse, à un malade, un fou (voir Robert Merle, « La mort est mon métier », 1952 ou Dino Buzzati « Le K. Nouvelles », 1967). Or ce courant historiographique, quels que soient ces apports, n’explique en rien le système nazi. En effet, la déviance de certains responsables nazis ne saurait rendre compte du nazisme dans sa globalité. Dans un deuxième temps un autre courant apparaît avec l’étude d’Hannah Arendt, « Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal » (1963). On assiste alors à une véritable inversion : le bourreau d’abord, on l’a vu, placé « hors humanité », devient ici humain, trop humain comme aurait dit Nietzsche. Banalement humain donc. Il y a dans cette démarche une dimension psychologisante qui laisse à penser qu’un bourreau sommeille en chacun de nous.
Dans les années 1990 un débat historiographique a délimité les champs d’explication du crime collectif. D’un côté Christopher Browning qui a étudié le 101e Bataillon de police allemand pour rédiger son ouvrage « Des Bourreaux ordinaires » (1992) a souligné l’importance des conditions particulières (la guerre, la hiérarchie, le groupe, la solidarité, la peur) qui conduisirent ces hommes non fanatisés à se transformer en bourreaux (cette approche peut s’appuyer sur le précédent de « l’expérience de Milgram »). En réponse à cet ouvrage, Daniel Goldhagen précisa qu’il s’agissait « d’Allemands ordinaires », sous-entendu des hommes imprégnés par une culture germanique antisémite (« Les Bourreaux volontaires de Hitler », 1996). D’une part nous avons une approche par la structure, de l’autre une approche par la culture. Les deux démarches présentent des failles. L’une oublie des déterminants idéologiques réels (présents également dans la Wehrmacht comme cela a été démontré), l’autre ne prend pas en compte un antisémitisme largement répandu en Europe et donc non spécifiquement allemand ainsi que la participation des populations locales au génocide (Cf. Christian Ingrao, « Croire et Détruire », 2010).
Entre ces deux perspectives présentant des faiblesses d’analyse s’est développée une nouvelle école qui étudie la trajectoire des bourreaux dans le moyen terme des deux guerres mondiales. Ainsi Michael Wildt, Ulrich Herbert ou Christian Ingrao ont analysé en détail cette génération née entre 1900 et 1910, trop jeune pour avoir fait 14-18 et qui a fourni les cadres de la Solution finale. Cette génération a été traumatisée par 1918 et a développé une « angoisse eschatologique » (Ch. Ingrao). Himmler, Heydrich, Eichmann sont les figures emblématiques de cette génération tandis qu’Hitler, Göring ou Röhm représentent la « génération du front ». Krüger est lui aussi représentatif de cette « génération du front » et il nous conduit à tenir compte des concepts de « brutalisation » et de « déshumanisation » développés par G.L. Mosse. Cette approche n’est donc pas celle du « sonderwerg » allemand ni celle de la théorie de « l’accident » dû aux circonstances de la Deuxième Guerre mondiale. En résumé ni approche intentionnaliste ni analyse fonctionnaliste. Nicolas Patin concentre son étude sur la période 1914-1945 et constate : « il y eut bien un processus de radicalisation à l’échelle individuelle et collective » (p. 18). Il se propose donc d’étudier un processus de transformation comme l’a fait David Cesarani dans son ouvrage « Devenir Eichmann » (2004). Dans cette perspective, Krüger se révèle être un bourreau ordinaire mais forgé par une époque.