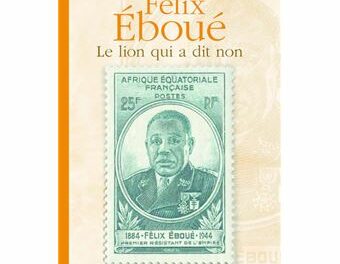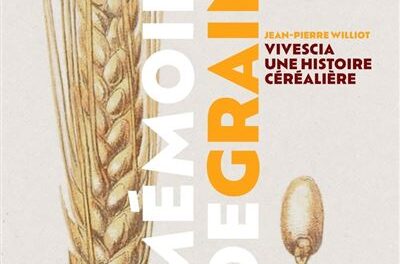L’argumentation est précise, claire et simple. La problématique de l’ouvrage se résume dans le titre. Nous avons le choix entre la Bourse ou la vie. Pour éclairer notre réflexion, les auteurs entendent nous montrer l’envers du décor. Ils s’attaquent d’abord à la nouvelle économie (17-57). A son sujet, loin d’insister sur les caractères novateurs, ils montrent au contraire sa proximité avec l’ancienne économie : l’exploitation, l’augmentation de la souffrance au travail (sur ce thème, on ne peut que renvoyer à l’ouvrage de Chr. Dejour, Souffrance en France, récemment ressorti dans le Livre de Poche), la « bidonvillisation »… On sent déjà poindre une réflexion sur la nature de la croissance et sur la valeur qui parcourt l’ouvrage comme un fil rouge et qui apparaît explicitement dans les dernières pages. Ensuite, un rapide chapitre aborde la question des privatisations (59-73). Puis, les auteurs s’attardent plus longuement sur les fonds de pension (75-111). Ils commencent par rappeler les arguments de leurs adversaires qu’ils citent abondamment : démographie, le capitalisme français n’a pas assez de capitaux, le système par répartition va imploser… Ils s’intéressent ensuite au rapport Teulade qui met en avant la productivité (83-87). En effet, si on tient compte de l’augmentation de cette dernière, il est possible de penser qu’un nombre moindre d’actifs peut financer les retraites d’un nombre croissant de retraités. Tout dépendra de la croissance respective de ces deux quantités. Du reste, en 1990, Denis Kessler qui aujourd’hui défend la création de fonds de pension en France le reconnaissait : « Prenons la période de dégradation la plus rapide, c’est-à-dire la période 2005-2025. Dans cette période, il suffirait d’un progrès de productivité de l’ordre de 0,5% par an pour compenser la diminution relative du nombre d’actifs » (cité par Labarde et Maris, 84).
En outre, les possibilités d’épargne sont variables selon les revenus. « L’épargne augmente beaucoup plus que proportionnellement au revenu » (91). Or, les Français épargnent déjà en grande quantité, l’enjeu est plutôt d’opérer un transfert que de créer une épargne nouvelle. Mais l’essentiel est dans la question de la valeur. En effet, pour que le capital rapporte, il faut que les actifs le fassent travailler. Dans la langue des deux auteurs, cela donne : « Placez un billet de 100 francs dans une boîte, secouez, laissez reposer une semaine, ouvrez, il y aura toujours un billet de 100 francs » (94). La conséquence est simple, l’argument démographique atteint également les fonds de pension, la baisse du nombre d’actifs agira à la baisse sur les valeurs (97-102). Le chapitre 4 est l’occasion de dénoncer un certain nombre de lieux communs sur la Bourse et la finance (113-161). Ainsi, les auteurs nous rappellent que la Bourse ne crée pas de valeur (149-152). Ils développent surtout la question des stock-options, sur laquelle on les sent particulièrement remontés. Pour eux, il s’agit de faire partager le risque au salarié. Dépouillé de son revenu, il ne lui reste qu’une promesse de profit. Ils ironisent longuement sur « la veuve écossaise » pour laquelle les salariés français sont censés travailler alors que les fonds de pension ne possède que 3% du capital des entreprises (140).
Bien évidemment, le risque était de dénoncer et de ne rien proposer. Les auteurs ne sont pas tombés dans le piège. Si les deux derniers chapitres ne sont pas un programme de gouvernement (« Au-delà du profit » 163-183 et « Au-delà du capitalisme » 185-197), ils tirent néanmoins de leur réflexion un certain nombre d’enseignements ou d’interrogations. On appréciera particulièrement la question de l’accumulation sans fin et la description des fonds éthiques américains. Les dernières pages de l’ouvrage sont une réflexion sur la nature du capitalisme, ses limites et donc son dépassement éventuel.
Les mérites de cet ouvrage sont multiples. La précision, la diversité et la richesse des informations n’en sont pas les moindres. Il n’est pas question ici de juger le fond de l’ouvrage qui adopte résolument un ton pamphlétaire. C’est au lecteur de trancher. Encore faut-il pour cela disposer de connaissances théoriques ou statistiques qu’il n’est pas toujours aisé de rassembler. Tout l’intérêt de La Bourse ou la vie est justement de les mettre à notre disposition.
Par Christophe Pebarthe