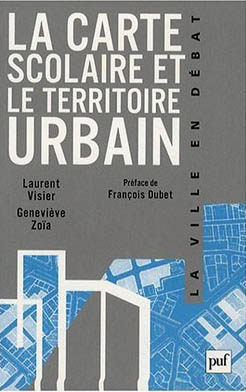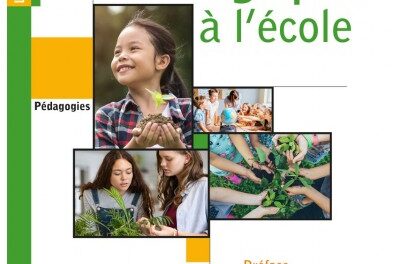Laurent Visier, sociologue au Cadis centre d’analyse et d’intervention en sociologie, EHESS, Paris et Geneviève Zoïa, anthropologue, commencent par rappeler à grands traits l’histoire, déjà oubliée, de la « carte scolaire » ou sectorisation, en France : mise en place en 1963, elle est alors un outil purement technique et a pour objectif exclusif d’aider à la planification des besoins en personnels et en moyens, en fonction des effectifs. Ce n’est que bien plus tard qu’on lui assigne la mission d’assurer la fameuse « mixité », notion récente (en 1963, ce terme n’évoquait rien d’autre que la scolarisation des filles et garçons ensemble !) et désormais placée au cœur des enjeux: en témoignent les débats nourris autour de ce thème lors de l’élection présidentielle de 2006, les candidats se déclarant, qui pour la suppression de la carte scolaire (Nicolas Sarkozy), qui pour son maintien (François Bayrou), qui enfin pour son aménagement (Ségolène Royal), comme si tous les enjeux de la justice sociale et de l’égalité en France se cristallisaient autour de ce fameux découpage du territoire. Au moment où l’on s’achemine vers un assouplissement, voire une suppression de la carte scolaire, les auteurs affirment que celle-ci, dans son état actuel, « n’est pas plus aujourd’hui qu’hier, un outil pour atteindre l’objectif de la mixité sociale ».
D’autre part, nier que le public d’un établissement a un effet sur le niveau d’enseignement, indépendamment des moyens, de la qualité ou de la motivation des équipes, telle est la véritable hypocrisie, dénoncent–ils.
Paradoxe : la mixité du collège de centre-ville
Les deux chercheurs ont observé le territoire où ils vivent : soit Montpellier, agglomération de 500 000 habitants, relativement représentative des tendances des grandes villes de France hors Paris (croissance forte et périurbanisation). Ils ont suivi les trajectoires de 6000 élèves de CM2 en 2005-2006, au moment de la « grande rupture » que représente l’entrée en 6e : comment se répartissent les inscriptions sur les 43 collèges de l’agglomération, entre public et privé, établissements périurbains et de banlieues, collèges à réputation de « ghettos » ou de centre-ville ? Ils ont d’abord essayé de mesurer la mixité sociale de façon pertinente, c’est à dire en combinant le critère classique des CSP (catégories socioprofessionnelles des parents), déjà utilisé par les établissements scolaires mais n’aboutissant qu’à un « niveau social moyen »,et la variance (qui mesure les écarts à l’intérieur du public d’un collège), seul indicateur capable, soulignent-ils, d’évaluer vraiment la mixité sociale.
Reprenant la typologie de Jacques Donzelot de « la ville à trois vitesses » Jacques Donzelot, Quand la ville se défait, le Seuil, 2006., ils distinguent d’abord des espaces de « relégation », où les habitants sont « parce qu’ils ne peuvent pas être ailleurs » et où les publics des collèges, sont à la fois socialement défavorisés et très peu mixtes : les catégories « moyennes » s’efforcent de les fuir ; puis ceux de la « périurbanisation », où généralement « on ne contourne pas » parce que « les choix résidentiels ont été effectués en amont » en tenant compte de l’offre scolaire : la mixité y est là aussi limitée ; et enfin les espaces de la « gentrification » en cours, où se trouve le collège de centre-ville, perçu comme « le collège bourgeois » mais paradoxalement le plus mixte de l’aire urbaine, parce qu’il accueille les nombreuses demandes de dérogation de familles cherchant à contourner les collèges « difficiles » : ses élèves de 6e proviennent de 50 écoles différentes, alors que 6 se rattachent à son secteur ! Ces demandes des familles ont en elles-mêmes créé de la mixité, remarquent les deux chercheurs, dans un établissement qui sans elles serait bien plus homogène socialement.
Les parents sont-ils coupables ?
Ils ont aussi interrogé des parents, et pris au sérieux leurs plaintes, refusant de les stigmatiser comme nombre de leurs collègues sociologues. Là où ces derniers dénoncent les stratégies personnelles individualistes, ou le pur consumérisme des classes moyennes, ils voient des parents tiraillés entre leur désir d’être de bons citoyens (« au départ, je trouvais normal de l’inscrire sur le collège du secteur ») et celui d’être de bons parents, capables d’offrir le mieux à leur enfant : (« dans ce collège, il se serait fait bouffer »), et surtout convaincus de subir de profondes injustices ; tels les habitants d’une commune périurbaine à la carte scolaire nouvellement redécoupée, sommés d’envoyer soudain leurs enfants dans un collège plus lointain et de niveau social beaucoup plus défavorisé que l’ancien, et se percevant comme « pris en otages » par une politique de mixité « décrétée d’en haut ». Devant les refus de dérogations, le choix de nombre de ces familles a été celui de l’enseignement privé, souvent contre leurs convictions de départ, pour une solution jugée « acceptable » pour leur enfant.
« Si tous les parents n’exigent pas le collège le plus huppé, en revanche il serait très injuste d’avoir à se sacrifier au nom d’un intérêt général, de surcroît indémontrable », estiment Laurent Visier et Geneviève Zoïa, persuadés que l’idéal de mixité est largement partagé par les familles. Pour eux, les parents se plaignent légitimement de l’opacité des discours de l’Education nationale comme de ses suspicions à leur égard. En témoigne un chapitre original du livre, véritable reportage tragi-comique au cœur d’une commission de dérogation. On y voit que les demandes sont acceptables si le motif est médical ; en revanche, la famille qui ose évoquer sa crainte pour son enfant, à la suite d’incidents de notoriété publique dans un établissement auquel elle souhaite échapper, est montrée du doigt par les principaux de collèges réunis : « l’évocation du niveau différencié des établissements constitue un tabou et (..) revient à offenser l’Education nationale », notent les auteurs, qui décrivent parallèlement des marchandages entre chefs d’établissements pour préserver le plus possible de CSP + entre leurs murs, et les comportements des enseignants, les premiers à « fuir » les établissements « difficiles »…
Reste, après le constat, à proposer des solutions pour une « politique de mixité concrète » : c’est là que, comme souvent, le lecteur reste sur sa faim, et dans le flou : il faut d’abord, estiment les auteurs, mesurer enfin la mixité avec des indicateurs fiables ; puis mettre fin à l’opacité et instaurer la transparence vis à vis des familles, sauf à laisser leurs choix reposer sur des réputations parfois infondées ; ensuite mettre en place une « mixité durable » en « composant » avec les familles, qui ne resteront que si elles jugent le collège « acceptable » pour leurs enfants. On aimerait là plus de précision : s’agit-il de créer des classes de niveau, d’ouvrir des options attractives, ou d’autres solutions ? Elles ne sont hélas pas détaillées. Enfin, les auteurs proposent de recruter le public scolaire selon d’autres critères que géographiques : en fixant peut être des quotas en fonction du niveau scolaire ou socioprofessionnel pour diversifier les établissements les plus favorisés, et en offrant aux établissements les moins attractifs, ceux que personne ne demande, une « discrimination positive effective, et non pas un affichage symbolique comme celui des ZEP ». On en est encore loin !