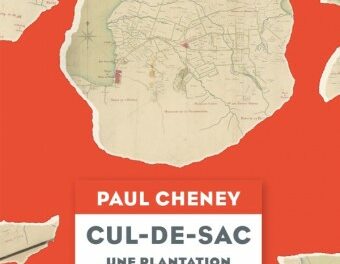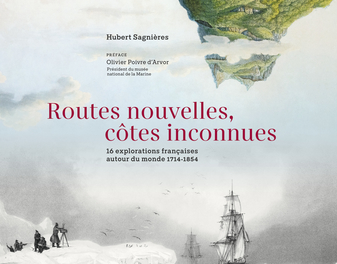« Cet ouvrage n’est qu’un essai dans le sens strict du mot ; l’auteur est conscient d’avoir entrepris une tâche ardue avec des moyens limités ». C’est par ces mots emprunts de modestie que Burckhardt introduit en 1860 son pensum qui influencera un Friedrich Nietzsche.
L’œuvre est un classique, plaisant à découvrir, déconcertant et partiel dans son analyse, toujours utile en le complétant par des références plus contemporaines. Il y développe la thèse d’une transition des temps obscurs du Moyen Âge aux lumières de l’humanisme : un temps qui commence au XIIe et s’arrête au XVIe siècle, un monde disparu mais qui nous éclaire encore aujourd’hui, qui nous interpelle et nous fascine, une approche des faits humains, en privilégiant une présentation d’événements considérés comme simultanés par synchronie.
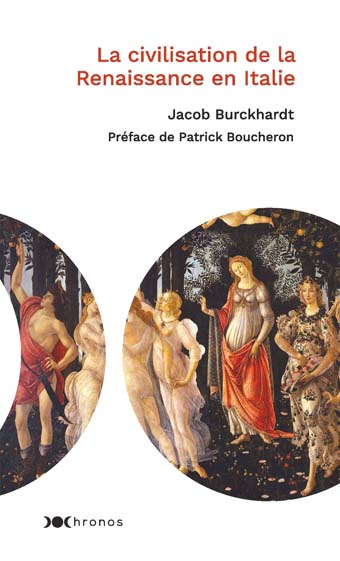
C’est donc un classique indispensable pour comprendre la formation des périodes historiques, car il a renouvelé profondément notre façon de percevoir la Renaissance. L’idée centrale de l’ouvrage (sur 322 ouvrages de l’auteur) est de plus à comprendre dans le contexte de la concurrence politique et idéologique des États. Il manque à cette édition de poche des illustrations d’œuvres d’art, mais pour une œuvre qui … ne parle pas d’art en Italie, et ne s’appuie que sur des témoignages écrits, laissés par des artistes illustres. Cependant, les qualités littéraires et didactiques sont indéniables et l’auteur a renouvelé à son époque les études historiques, en y apportant un éclairage sur l’histoire, les mœurs, l’art de la guerre, la politique, la vie quotidienne, … sans s’appuyer sur une chronologie figée.Qui est cet auteur prolifique ? Jacob Burkhardt (1818/1897) est un historien de l’art célèbre, un historiographe suisse, un philosophe, un professeur réputé à Bâle qui consacre l’essentiel de son œuvre à l’étude de l’histoire antique et moderne.
Il s’agit d’un fils de pasteur calviniste, d’abord destiné à la théologie, puis qui mène des études historiques à Berlin à partir de 1839. Il y est influencé par Léopold von Ranke (1795/1886) – on se souvient notamment de lui pour sa tentative de mise au service de l’histoire au service du nationalisme prussien – L’influence est certaine pour le premier ouvrage de Burkhardt. A partir de 1848, il cherche à concilier histoire politique et histoire de l’art et pose la problématique de la mutation entre le monde antique et le monde chrétien dans son ouvrage L’époque de Constantin le Grand (1853). Après s’être intéressé à la peinture flamande et hollandaise, de nombreux voyages en Italie (nous noterons qu’il rédige un guide touristique, le Cicérone, en 1855) et son expérience de l’enseignement de l’Histoire de l’art, à partir de 1858, le décide à se consacrer à l’histoire italienne. La publication de son ouvrage en 1860 lui confère immédiatement la célébrité.
Patrick Boucheron, éminent spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, notamment italienne, également président du conseil scientifique de l’École française de Rome, professeur émérite au Collège de France, préface cet ouvrage et écrit « La civilisation de la Renaissance en Italie est moins une histoire qu’un portrait : celui de la mentalité d’un peuple (Volksgeist) et de l’esprit d’un temps (Zeitgeist), l’une et l’autre indissociablement liés dans une civilisation « qui la mère de la nôtre, qui représente toujours une force vivante parmi nous » et qu’on ne peut appréhender que par l’histoire culturelle, la Kulturgeschichte ». Il y souligne l’écriture flamboyante de Burckhardt, souligne ses nombreuses qualités, mais ciblent les manques de l’ouvrage : l’auteur se désintéresse de l’économie, de l’histoire du travail, de celle des techniques, et nous y trouvons peu d’éclairage sur les classes populaires. Et aujourd’hui, quelle est la place de cet essai monumental ? La période étudiée n’est pas une synthèse immobile, l’ouvrage, selon Boucheron, fait bien de l’histoire totale, mais celle d’un objet imaginaire. Nous y apprenons peu ce que la société italienne a été, plus sur l’image qu’elle voulait se donner.
La civilisation de l’Italie (XIV -XVIe) est le lieu de l’émergence de l’individualisme qui se donne ses propres lois et devient le sujet de son histoire en déchirant « le voile médiéval », tissu de foi, de préjugés, d’ignorance et d’illusions.
Au-delà de la variété des régimes politiques de ces territoires italiens de la Renaissance, l’auteur s’attache à montrer ce qu’ils en commun, à savoir de souffrir d’un déficit de légitimité, compensé par la rationalisation de leurs modes d’exercice. En passant par l’art de la guerre, le jeu de la diplomatie naissante, ou les techniques de maniement des armes par la propagande et l’historiographie, Burckhardt voit l’État comme « une création calculée, voulue, comme une machine savante ». Il construit une vision d’une sorte de darwinisme social, créant les conditions de l’individualisation (« désir de gloire », essor de la « raillerie et du mot d’esprit »). S’ensuit une quête passionnée et passionnante des vertus de l’Antiquité (présentée comme la conséquence de cet imaginaire nouveau). Les humanistes puiseraient dans le passé romain de quoi les armer dans leur découverte du monde et de l’homme.
– Une première partie présente l’État comme une création d’art. C’est certainement la partie la plus intéressante de l’ouvrage. Le contexte de départ est à rappeler, malgré la synchronie. Il s’agit de la lutte entre les papes et les Hohenstaufen. L’Italie avait rompu avec l’unité monarchique, pour une foule de corps politiques, de villes, de souverains despotiques. Mais, l’État apparaît quand même comme une création savante. Burkhardt l’illustre en reprenant l’exemple célèbre de Frédéric II, l’exemple même d’un empereur centralisateur. L’intérêt des portraits de l’auteur est bien là dans sa plus belle expression. Car, ce tableau est ébauché en dressant un corollaire bien sordide, celui de son beau-fils et vicaire Ezzelino de Romano, premier à essayer de fonder un trône par des massacres généraux, encore pires que ceux de César Borgia, suscitant une terreur sans nom. Quelles sont les ressources de ces princes ? Essentiellement les impôts, les revenus particuliers de la maison régnante. Ces familles régnantes cherchant tant bien que mal à faire face à toutes les dépenses que leur imposent leur rang, leur illégitimité d’origine du pouvoir et leur isolement conséquent. Les relations les plus honorables qu’ils entretiennent, sont finalement entretenues avec des hommes dotés de capacités intellectuelles, quelle que soit leur origine. Les princes s’offrent ainsi une légitimité, comme l’un des tyrans de Vérone, Can Grande della Scala.
L’auteur nous présente alors un tableau général de l’évolution de la tyrannie au XVe siècle, nous devrions écrire qu’il s’y complait en ébauchant ces portraits de condottieri et de leurs efforts pour arriver à une souveraineté indépendante. N’y arrivant pas, les voici à se vendre au service d’États plus puissants avec pour certains, beaucoup de talent, de prudence, de calcul. L’influence de la personnalité des princes est remarquablement dépeinte, l’historien soulignant encore l’importance de l’illégitimité originelle, avec le rôle important des empereurs, dressant une comédie politique par les « camera imperii ». Mais, soulignons la propre indifférence de ces princes à l’égard de la légitimité de leur naissance, accordant souvent la même reconnaissance de droits, aux enfants issus de lits différents (dont le droit d’aînesse), accordant des privilèges contestés et contestables, selon l’autorité du chef de clan, véritable pater familias avec des figures exceptionnelles comme François Sforza (1450-1466), « père commun des soldats », image même du condottiere à son apogée. Burkhardt présente alors les efforts des quatre grands États (Naples, Milan, les États de l’Église et Venise) pour mettre un terme à cette cacophonie de corps politiques irréguliers, tout en gardant au passage en leur sein des petits tyrans en s’arrêtant sur des portraits singuliers, celle d’Aragon, entre autres, avec Alphonse le Grand qui règne à partir de 1435, meurt en 1448, estimé et aimé, d’une grande libéralité à l’égard des travaux littéraires ou encore François Sforza, déjà cité plus haut, appartenant à la maison des ducs de Milan. Dans la seconde moitié du XVe siècle, c’est au tour de principautés d’être traitées comme celle de Gonzague de Mantoue Montefeltro et de sa femme Isabelle, dont la cour est nombreuse et en représentation, avec un mécénat particulièrement fécond, preuve selon l’auteur, d’une société élégante se connaissant en œuvres d’art. Un règne aux dépenses faites avec raison, pas de jeux, pas de blasphèmes, une école d’éducation militaire pour les fils d’autres seigneurs, … Un autre panégyrique s’arrête sur le Grand Frédéric (1444- 1482), rappelant son surnom de « lumière d’Italie ».
Ensuite, l’étude porte sur les villes, ainsi Ferrare, la première ville moderne d’Europe aux yeux de l’auteur. Souvent éclairés, voyageant dans toute l’Europe, leurs dirigeants comme Alphonse 1er qui séjourne dans le royaume de France, aux Pays-Bas et qui fait de son séjour un voyage d’études et/ou de connaissances approfondies du commerce et de l’industrie de ces pays. Un trait intéressant est souligné : les princes ne sont pas obligés de vivre et de côtoyer des nobles et ils peuvent aussi imposer à leur population la considération dont il honore des serviteurs utiles au mépris des catégories sociales. La protection est alors accordée au mérite, ce dont profitent les universités.
Des adversaires ? Toute résistance intérieure est impuissante, inutile. Ces territoires sont ainsi dépeints particulièrement divisés entre les Guelfes, les Gibelins, … Quand le meurtre des tyrans est réussi, c’est souvent à l’église, car leur garde armée se restreint. Ainsi, les habitants de Fabriano tuèrent en 1435 leurs tyrans, les Chiavelli, pendant une grande messe.
Les Républiques ont, elles aussi, leur présentation soignée et non dénuée d’emphase. Burkhardt souligne leur volonté de former une fédération, et les moyens qui n’ont rien à envier à la pire des tyrannies : inquisition d’État, espionnage, exécutions nocturnes, Gênes connaissant, semble-t-il, une histoire plus orageuse, Venise restant étrangère, limite dédaigneuse aux divisions du reste des territoires italiens. Mais, l’historien revient bien vite à son cheval d’arçon : toutes les cités n’ont pas le goût des belles-lettres, s’ensuit une comparaison des actions culturelles réciproques des cités.
Qu’en est-il de la politique extérieure des États italiens ? Elle est dépeinte par l’auteur très active et très objective en général, mais pas sans intrigues, trahisons, tentatives de corruption, ligues. Il la représente très active avec les deux puissances modernes que sont la France et l’Espagne qui finit par triompher. Le XVe siècle voit des princes ne pas hésiter à nouer des relations avec les Turcs, certains envisageant même leur asservissement sous une autorité ottomane, comme finalement une politique sans état d’âme, un moyen d’action comme un autre.
L’art de la guerre est d’abord limité par un service militaire obligatoire et les nombreuses restrictions qu’il impose, de même que par l’ambition des seigneurs. L’auteur évoque alors que l’Italie est la première à employer des mercenaires du Saint-Empire romain germanique, puis qu’elle développe ses propres soldats de métier. Il souligne la démocratisation de la guerre grâce au perfectionnement des armes à feu, assez précoce, semble-t-il. Les Italiens deviendraient alors les maîtres de toute l’Europe par leur art des fortifications et de la balistiqueCe qui n’empêche pas un Paolo Vitelli de faire crever les yeux des arquebusiers ennemis capturés avant de les faire exécuter « parce qu’il lui semblait monstrueux qu’un vaillant et noble chevalier fut tué par une vulgaire et vil fantassin ».. De nombreux récits de guerre sur lesquels s’appuie l’auteur pour enrichir son propos. En reprenant l’exemple d’un amateur éclairé, Machiavel qui écrit son Arte della guerra.
Et les États de l’Église ? Ils ne sont pas absents de son analyse, la puissance spirituelle masquant la faiblesse temporelle. Ils affrontent ainsi de nombreux dangers, par exemple quand le pape est envoyé prisonnier dans le midi de la France. Burkhardt évoque même la crainte de leur dissolution pendant le grand schisme d’Occident. L’unité est retrouvée sous Martin V, de nouvelles crises les affectent dans la seconde moitié du XVe siècle. Ils affrontent aussi les colères de la ville de Rome, les complots, le rejet de la vénalité du Saint-Siège, le népotisme qui règne avec les neveux ou fils des papes, avec le cas particulier des Borgia, qui réussissent à obtenir une totale soumission des États pontificaux.
L’auteur met un terme à cette première partie par une brève évocation de l’Italie des patriotes, trop brève à mon goût, mais qui reprend cependant l’élan du patriotisme, l’idée de résistance face à l’état d’incertitude politique.
– Une seconde partie s’arrête sur le développement de l’individu. Selon l’auteur, c’est dans les territoires italiens que l’homme devient un individu à part entière. Il s’arrête sur plusieurs personnalités marquantes, mais place d’abord l’individu dans l’État italien. L’individualité du souverain d’abord, puis du talent qu’il protège en tant que mécène. Soulignons une présentation très « littéraire » et incomplète de l’émergence de l’individu qui ne saurait s’arrêter aux frontières de cette Italie. Souvent, les villes républicaines servent de cadres au développement du caractère individuel.
Devons-nous y voir la causalité avec le cosmopolitisme de beaucoup d’Italiens, fuyant les tyrannies, les trahisons, les dénonciations, les territoires instables des Condottiere, les retournements de situation qui jettent sur les routes des familles entières, trahies parfois par leurs propres membres. Fuir les troubles politiques se transforme sous la plume de l’historiographe comme l’un des plus hauts degrés de l’individualisme. Il cite alors l’exemple de Dante qui se voit proposer un retour à Florence avec des conditions dégradantes et honteuses et qui clame trouver sa nouvelle patrie dans la langue et la culture de l’Italie.
Le développement de l’homme universel (l’uomo universale) n’appartiendrait alors qu’exclusivement à la péninsule italienne. Pour appuyer ses dires, le critique se fait hagiographe et offre des tableaux de plusieurs personnalités remarquables, avec une exaltation sans objectivité des artistes italiens. La gloire moderne (signe extérieur du développement de l’individu) s’ébauche sous les traits des Dante, Albertinus Musattus on Musattus, Pétrarque (qui dans sa Lettre à la postérité, se plaint des honneurs, lui dont le tombeau dans la ville d’Arqua devient un séjour aimé des Padouans), Aecurse, Boccace, le juris-consulte Zanobi della Strada, Fra Filippo Lippi et tant d’autres … Pourquoi s’arrêter alors aux gloires locales quand nous pouvons nous voir élaborer un panthéon des gloires du monde à l’instar du panégyriste de Padoue Michel Savonarole, commençant son énumération de portraits d’hommes illustres dans les années 1440…
Raillerie et mot d’esprit sont d’abord l’apanage des grands de ce monde, mais l’auteur reprend l’historique de la dérision, soulignant le manque d’ironie dans les Cent vieilles nouvelles de la fin du XIIe siècle (malgré la présence de la comédie et du burlesque), le mépris qui transparait dans la Divine Comédie de Dante ; il faut attendre un Franco Sacchetti avec son recueil de mots piquants dits à Florence qui ne sont pas des « histoires proprement dites, mais des réponses faites dans certaines circonstances, d’horribles naïvetés que débitent des écervelés, des bouffons de cour, des fripons, des courtisans, pour excuser leurs méfaits… ». Mais, le trait d’esprit devient un art dans sa période d’étude et Burckhardt évoque alors son théoricien le plus connu, Joviano Pontano. L’Italie devient même une étonnante école de blasphème, sans équivalent en Europe, avec aussi un maître de calomnie auprès de qui, nos femmes et hommes politiques contemporains prennent leurs leçons, un Pierre Aretin (1527/1556), pensionné par les plus grands, craignant autant ses mots d’esprit que pour son rôle d’agent espagnol particulièrement dangereux, une figure considérable de son temps.
– Une troisième partie offre un tableau saisissant de la résurrection de l’Antiquité. De Rome, la ville célèbre par ses ruines « Les pierres des murs de Rome méritent la vénération de tous, et le sol sur lequel la ville est bâtie est plus respectable que les hommes ne le disent » Paroles de Dante dans Wright, Walther Mapes, 1841, poème qui reprend un conte paru sous plusieurs formes en France., l’historiographe reprend dans une longue énumération les auteurs anciens, plus nombreux et considérables que les monuments eux-mêmes « On les regardait comme la source de toute science dans le sens le plus absolu du mot » (page 162).. Soulignons au passage que tous les écrits des auteurs grecs et latins ne sont pas parvenus jusqu’à nous et que si certains l’ont été, c’est bien grâce à la passion dévorante d’hommes comme le pape Nicolas V, qui avouait ostensiblement « partager les deux grandes passions de la Renaissance, celle des livres et celle des monuments »« Devenu pape, il resta fidèle à ses goûts, il paya des copistes pour transcrire les œuvres de l’Antiquité et des émissaires pour chercher partout des manuscrits anciens » (p. 163). À sa mort, le Saint-Siège s’énorgueillit de posséder désormais le noyau de la bibliothèque vaticane, comprenant de 5000 à 9000 ouvrages. Et Burckhardt complète le tableau en y rajoutant le rôle précurseur des universités et des écoles, insiste sur la naissance de l’humanisme et l’imitation de l’Antiquité devient une norme aux règles précises, concernant notamment l’épistolographie et le discours latin, finissant d’ailleurs par latiniser la culture. L’humanisme entre alors en déclin, à découvrir en lisant directement l’ouvrage par petites touches ou en s’y plongeant à ses heures perdues.
– Une quatrième partie présente la découverte du monde et de l’homme. La présentation ne se veut pas exhaustive « Une observation générale sur les voyages entrepris par les Italiens dans des contrées lointaines » (page 239).. Burkhardt la rattache au phénomène des croisades qui « avaient ouvert le monde à tous les Européens et fait naître partout le goût des voyages et des aventures » (page 239). Christophe Colomb est évoqué avec beaucoup d’intérêt, symbole génois de ces voyageurs intrépides, payant de leur fortune, des gloires éphémères. Quelques observations générales sur les progrès de la géographie et de la cosmographie suivent. Une troisième sous-partie aborde l’émergence des sciences naturelles, avec le goût précoce pour les collections, les cabinets de curiosité que ramèneront des conquérants plus tard dans les autres royaumes, tel François 1er. Ce sont les études comparées des animaux et des plantes, les premiers jardins botaniques, les jardins d’agrément remarquables (celui de la villa du cardinal Trivulce, avant le magnifique jardin de la villa Carreggi appartenant aux Médicis). L’entretien d’animaux étrangers – dont les fameuses ménageries (les serragli) est présenté comme se rattachant à un intérêt scientifique, discutable aujourd’hui tant il parait difficile de séparer l’animal de son milieu naturel. On jette cependant, et Burkhardt le reprend avec sagesse et raison, les bases d’une zoologie scientifique, ainsi que d’une botanique. Fait surprenant, l’auteur reprend l’anecdote à mettre en parallèle avec les zoos humains de la période colonialeÀ mettre en parallèle avec le roman Didier Cannibale de Daeninckx. : un certain cardinal Hippolyte de Médicis entretient une ménagerie composée d’une troupe de barbares parlant une vingtaine de langues, dont des voltigeurs du Nord de l’Afrique, des archers tartares, des lutteurs « nègres », des plongeurs indiens, … qui l’accompagnent lors de ses funérailles. Ensuite, cet œuvre présente l’attrait des Italiens pour la nature, la découverte de l’homme et sa description par la poésie, l’art de la biographie, des tableaux dressés des peuples (à l’instar d’un Brunetto Latini), la peinture de l’homme extérieur à la péninsule. Physiologie survolée, éducation sur la beauté et la laideur, répondant aux « canons » de l’époque avec un Boccace se distinguant, non dans son Décaméron, mais dans ses romans. Une peinture de la vie active semble bien superficiellement dressée.
– Une cinquième partie s’arrête sur la sociabilité et les fêtes, sans doute la moins aboutie de l’ouvrage, mais de qualité indéniable, liée à son interprétation partielle de la société. Elle part du postulat qu’« une classe sur laquelle la naissance et l’origine n’ont plus d’influence que si elles sont jointes à la fortune et aux loisirs qu’elle assure » Page 301, c’est l’évocation des modifications de la société et l’arrêt sur une classe cultivée, avec un nivellement par rapport à la société médiévale, selon l’auteur. (page 301). Burkhardt reprend les raffinements de la vie, la langue considérée comme la base de la sociabilité, cette dernière liant et force suprême des relations entre individus, l’auteur dresse un portrait de l’homo sociabilis, dépeint une société féminine plus riche qu’il n’y parait, la vie domestique, les fêtes pour conclure, occasions de célébrer des triomphes, les carnavals, les fêtes vénitiennes qui ressortent du lot, des spectacles féériques dont l’écho est parvenu jusqu’à nous. Le tableau littéraire s’achève par cette comparaison avec la brièveté de la Renaissance(« Quantoè bella giovinezza, che si fugge tuttavia ! Chi vuol esser lieto, sia : Di doman non c’è certezza ». D’un auteur inconnu. En m’excusant pour la traduction approximative qui fait penser à un Carpe Diem : « Comme c’est beau la jeunesse, qui fuit cependant à toute vitesse ! Qui veut être heureux, en profite : demain n’offre pas de certitude »..
– Une excellente sixième partie présente les mœurs et la religion. Dans une terre chrétienne par excellence, qui impose ses règles morales, l’auteur dépeint un humanisme au croisement du paganisme et du christianisme et jette des portraits remarquables de mages, nécromants, dans une terre consacrée où la religion chrétienne fixe les règles de la vie journalière, mais où progressivement monte un amollissement de la foi en général, ébranlée par « la vue de l’injustice triomphante et du mal partout répandu » qui se maintient longtemps à la seule condition de l’espoir d’une élévation de l’être humain, de la haute destinée de l’homme dans une autre vie. Cet affaiblissement est lié selon l’historien à la volonté de ne rien devoir à l’Église, devenue objet de haine. Les incrédules existent et osent s’exprimer, maudissant la foi et refusant les derniers sacrements, … Fait « surprenant », il était possible de se revendiquer « incrédule », à la seule condition de ne pas s’attaquer à l’Église, un Pierre Aretin l’avait parfaitement compris.
Il est vrai que l’Antiquité a transmis ses superstitions, le fatalisme aidant, c’est alors l’affaiblissement de la croyance en une immortalité, comblée par la montrée de l’intérêt pour l’astrologie antique, puis arabe, tableau que l’auteur dépeint avec brio jusque dans ses aberrations dans les hautes sphères, puis dérive vers l’évocation des présages dans tous les milieux, dans ses croyances profondes dans les spectres, les ombra, pas si différentes des créations spectrales du reste de l’Europe. De spectres aux démons, il n’y a qu’un pas, et Burckhardt nous ébauche alors avec talent le portrait de ces incantatore, ou magiciens, directement concurrents des sorcières et sorciers.
Un ouvrage qui se relit avec intérêt, pas forcément d’un bloc monolithique, mais bien par petites touches. Il a donc encore sa place dans les bibliothèques virtuelles ou de papier.