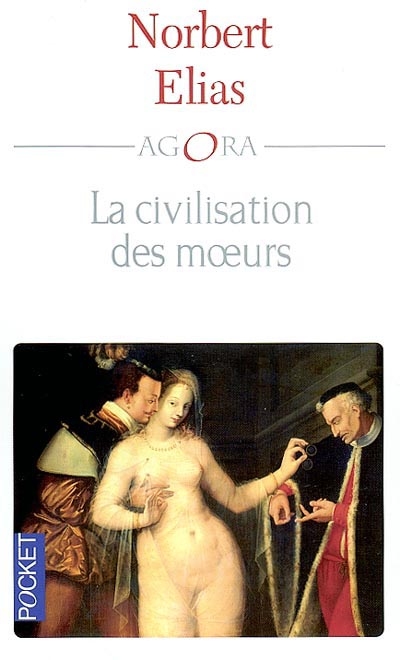
Le personnage de Norbert ELIAS, intellectuel atypique, ne laisse pas indifférent. Allemand, né à Breslau en 1897 et mort à Amsterdam en 1990, il a traversé le XXe siècle et a contribué à féconder les sciences sociales par des théories empruntant à la fois à la sociologie, à l’histoire, à l’anthropologie, aux sciences politiques, à la psychologie, …
Son apport principal réside dans sa théorie du « processus de civilisation », qu’il développa après avoir œuvré à une thèse sur la société de cour. L’arrivée des Nazis au pouvoir le contraint à l’exil en Angleterre en 1935 où il fera l’essentiel de sa carrière, excepté 3 années passées au Ghana (1962-1964). Il enseigne d’abord à la London School of Economics jusqu’en 1954, puis à Leicester.
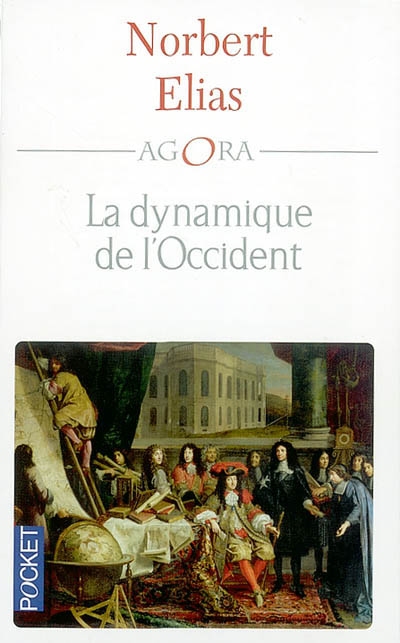
En 1975, il migre aux Pays – Bas où il termine sa vie. Il connaît donc la célébrité sur le tard, à l’image du prix Theodor-W-Adorno qu’il reçut à Francfort en 1977, pour son œuvre majeure. Celle-ci, parue en allemand sous le titre Über den Prozeß der Zivilisation en 1939 (à Bâle), ne fut éditée en langue française qu’en 1973 puis 1977, sous la forme de deux volumes respectivement intitulés La civilisation des mœurs et La dynamique de l’Occident.
Il est vrai que certains aspects du travail d’Elias ne constituaient pas vraiment des objets de recherche usités, en lien avec les interrogations du temps dans les domaines de la sociologie ou de l’histoire. Paradoxalement, certains éléments de son discours étant relativement proches d’apports de la sociologie française et notamment de Pierre Bourdieu (le thème de l’ « habitus » par exemple), il ne put se faire connaître plus rapidement en France.
C’est pourquoi la notoriété lui vînt d’abord du monde historien du fait des développements du courant de la « Nouvelle histoire ». Caractérisé par un moindre intérêt pour l’évènement et la narration de la vie des grands hommes, ce courant historiographique, dont les thuriféraires suivaient l’Ecole des Annales, mettaient en valeur d’autres objets de recherche sur des échelles géographiques plus vastes et en suivant une perspective de temps long. Ainsi, Roger Chartier et André Burguières furent les deux premiers à introduire Norbert Elias, à se l’approprier et à le diffuser en France. De fait, les différentes sciences sociales avaient chacune matière à prendre (et à apprendre) chez Elias, du fait du décloisonnement opéré par celui-ci dans son travail. Ainsi, les politologues s’y intéressèrent (1er colloque consacré en France à Elias, en avril 1994), mais aussi les anthropologues (colloque à Nancy en septembre 2000) et, bien évidemment, les sociologues, …
Les deux livres de Norbert Elias portent sur l’histoire de l’intériorisation des émotions et l’autocontrôle de la violence dans la civilisation occidentale entre le XIIe siècle et le XIXe siècle, avec la période charnière que représente aux yeux d’Elias la Renaissance. La civilisation des moeurs analyse le processus séculaire de maîtrise des instincts, de domestication des pulsions humaines les plus profondes (Il emprunte ainsi beaucoup à Sigmund Freud et à la psychanalyse). La dynamique de l’Occident met en rapport cette économie individuelle avec la formation d’un pouvoir étatique et centralisé.
L’organisation des cours royales a joué un rôle majeur dans cette lente évolution. Elias montre l’extension des pratiques de la cour à l’ensemble de la société (« curialisation »). Ainsi l’idéal comportemental est-il le fait de l’élite, d’abord nobiliaire, puis bourgeoise, servant de modèle au reste de la société et étant enjeu de mobilité sociale par imitation. L’attraction de ce modèle avait sa traduction géographique, le pouvoir étant fortement concentré auprès de la personne royale, notamment en France. Ce modèle fut ensuite copié dans les autres cours européennes à l’époque classique.
La conséquence de la mise en avant de la noblesse curiale mais aussi de son pendant, sa domestication (afin d’éviter toute révolte) fut la pacification des mœurs (interdiction du duel à partir Louis XIII et Richelieu) et un contrôle de soi extrême, en toute circonstance, pouvant aller jusqu’à affecter la plus parfaite indifférence. L’homme du monde se devait dès lors de s’imposer, non par sa force physique, mais par l’usage savamment dosé de la parole et d’un langage « noble » et « distingué », devant lui permettre précisément de se distinguer du « vulgaire ». Cette nécessité de l’élite étant précisément sa raison d’être. La mobilité sociale peut dès lors se faire par l’adoption des « manières » adéquates, témoins du prestige acquis, que la simple richesse économique ne saurait à elle seule apporter. Ce fut là une manière pour les nobles désargentés, jouissant du prestige lié au mode de vie (fait d’excellence) et à la résidence à la cour, de faire pièce à la montée de la bourgeoisie comme classe sociale. Par la suite, les classes populaires s’adonnèrent au même parcours, par effet de mimétisme et toujours dans un but d’ascension sociale. L’apport d’Elias fut aussi de montrer, notamment à travers l’utilisation des écrits du Marquis de Saint Simon, que la Cour était « the place to be » (pour utiliser une terminologie actuelle et « tendance »), l’espace référent en terme identitaire, évoqué par Michel Lussault (L’homme spatial, 2007) puisque la cour représentait un monde à elle seule, un modèle social, dont l’attraction ne se démentait pas, pour le plus grand profit de celui qui en constituait le centre, c’est-à-dire le roi, arbitre des conflits entre groupes sociaux, sachant merveilleusement jouer des interdépendances et diviser afin de mieux asseoir son pouvoir.
Cette évolution sociale, extérieure à l’individu, fut en constante interaction avec l’économie psychique de l’homme occidental par l’intégration des sentiments de honte, de gêne et de pudeur caractérisant l’habitus de l’homme « civilisé » (cet état de « civilisation » étant à la fois un processus, mais également un but à atteindre …). Progressivement, la contrainte extérieure céda la place à l’autocontrainte, de façon inconsciente.
Ce travail monumental fut réalisé à partir de l’étude d’objets aussi mineurs (ils étaient considérés comme tels à l’époque de la réalisation de l’œuvre) que les règles de politesse du XVe au XVIIIe siècle contenues dans les manuels de savoir-vivre qui se faisaient fort de « civiliser » les mœurs de table ou les fonctions physiologiques du corps humains telles qu’uriner ou cracher. Le travail du chercheur s’intéresse à un objet spatio-temporel très vaste puisqu’il correspond à « l’Occident » sous forme européenne (les sources furent rédigées en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en France). L’encart chronologique atteste de cette même ampleur d’analyse, prenant en compte une durée séculaire : la volonté de réaliser une vaste synthèse est évidente, même si le corpus de sources semble relativement limité.
Elias utilise l’histoire pour faire œuvre de sociologue car sa réflexion, teintée de philosophie et de psychologie, prend comme matière la société et son évolution. Il s’agit de montrer que celle-ci n’est pas extérieure à l’homme et de réconcilier l’individu et la société. Schématiquement, Elias se différencie en cela, à la fois, de la démarche holiste qui met en avant une vision globalisante de la société (le tout l’emportant sur les parties et la logique sociale dominant l’individu) mais également de l’individualisme méthodologique qui postule que tout phénomène social est la résultante des stratégies personnelles mises au point par l’individu (le tout n’est que la somme des parties). Elias considère contrairement à ces deux théories, que le processus d’individualisation a historiquement été lié à un processus de socialisation. Ainsi, dans sa vision, les individus interdépendants constituent la société qui n’est donc pas extérieure à eux. Cette notion d’interdépendance se caractérise par le fait que toute action accomplie par un individu appelle inévitablement un contre – coup d’un deuxième individu (voire d’autres), ce qui limite donc la liberté d’action du premier.
Ces formes d’interdépendances entre individus ainsi définies sont nommées « configurations » et peuvent être de taille variable, d’un simple rapport entre deux individus jusqu’à une échelle nationale voire internationale. Les déséquilibres dans les interdépendances (qui ne manquent pas de se produire) sont à l’origine du pouvoir que possède un individu sur un autre, un groupe social sur un autre. Elias allie donc les aspects sociologiques et psychologiques du vécu individuel aux réflexions sur les constructions collectives et notamment étatiques (c’est notamment l’objet de son deuxième volet) et il montre que le mouvement séculaire de modification psychique des individus en Occident a été de pair avec l’évolution politique dans le sens de la constitution progressive des sociétés au fur et à mesure du développement des inter-relations jusqu’à la mise en place des Etats modernes à des échelles de plus en plus vastes (jusqu’à englober l’ensemble de la planète par l’intégration des territoires colonisés). Cette théorie peut trouver encore sa raison d’être à l’échelle du Monde, cette fois-ci, dans le cadre du processus de mondialisation actuel. Pour autant, la mondialisation est – elle une occidentalisation ? Vaste sujet, qu’un développement continu et approprié de l’histoire connectée pourrait permettre d’éclaircir quelque peu. Il contribuerait sans doute à mettre définitivement à mal la vision qu’Elias a des peuples « primitifs », vision datée d’un intellectuel certes brillant, mais baignant dans un contexte culturel propre …
Par ailleurs, les thèses de Norbert Elias ont été réfutées par l’anthropologue allemand Hans – Peter DUERR dans un ouvrage en 4 tomes, publié en 1998, au titre éloquent : Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation. Les critiques de Duerr tournent autour de deux points principalement.
D’une part, Elias commettrait des erreurs méthodologiques, notamment dans l’approche de l’iconographie sur laquelle il travaille. Son analyse apparaît simpliste et naïve, par exemple concernant une représentation de scène de bain en Bourgogne en 1470. La promiscuité et le mélange des sexes induiraient, selon lui, une absence de pudeur à une époque où le processus de civilisation n’était pas encore prégnant. Duerr montre qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un établissement de bain « convenable », mais d’un « bain – bordel » (« Badepuff ») régit par des relations sociales tout à fait particulières. Cette différence est analogue à celle qui existerait aujourd’hui entre une piscine municipale et un salon de massage érotique. De plus, Elias néglige dans son analyse le principe de représentation simultanée c’est – à – dire le fait que des scènes représentées sur un même plan ne se déroule pas forcément en même temps. Il analyse de façon « littérale » un document qui n’est peut-être qu’une image métaphorique à visée moralisatrice, ce qui a pour conséquence de considérer comme courant et banal un comportement atypique voire inexistant. Enfin, Elias considère que le fait de vivre nu et en public signifie une absence de pudeur, ce qu’une étude plus fine de certaines sociétés « archaïques » (pour reprendre la terminologie éliasienne) ne tarde pas à infirmer (le Japon du XIXe siècle par exemple où la mode des bains publics mixtes n’empêchait pas un comportement par ailleurs marqué du sceau d’une pudeur élémentaire).
D’autre part, le cœur de la théorie d’Elias est fondamentalement erroné d’après Duerr. D’abord parce que tout n’est pas construction sociale : il existe des invariants anthropologiques qu’Elias ne prend absolument pas en compte. Le sens de la pudeur n’est pas une invention de la Renaissance mais une disposition humaine élémentaire que l’on retrouve dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Tout ne peut donc être historicisé ou « sociologisé », d’après Duerr. Ensuite, l’anthropologue affirme que les règles de pudeur ne sont consignées par écrit qu’au XVIe siècle, dans un but normatif. Il ne s’agit pas là de réfréner les pulsions, mais simplement de mettre en œuvre une modification du contrôle social qui est alors exercé par certaines institutions et non plus par le groupe d’appartenance. Enfin, son dernier reproche concerne l’ethnocentrisme de la théorie de Norbert Elias ainsi que son évolutionnisme. Duerr rejette en bloc la vision de l’archaïsme supposé des peuples « primitifs », comme les appelle Elias, vision sommaire et naïve selon lui (sous-estimation des règles de pudeur chez ces peuples). A toutes fins utiles, la question est peut-être de réarticuler nature et culture. Il convient certes de battre en brèche le sens commun qui est spontanément naturalisant, sans pour autant tomber dans l’excès inverse consistant à penser que « tout est culture ». C’est du moins l’opinion développée par Hans – Peter Duerr, anthropologue de son état.
D’autres critiques portent sur la négligence de l’ouvrage concernant la société du XIXe siècle, traitée très rapidement ou sur l’oubli des institutions ecclésiastiques (organisation des communautés monastiques notamment) dans le schéma évolutif. Zygmunt BAUMAN, enfin, voit dans l’existence de l’holocauste, un démenti cinglant à la théorie éliasienne basée sur le rapport entre la construction des Etats modernes et la pacification des mœurs, même si Elias s’est toujours défendu d’avoir une conception linéaire de l’histoire. La pacification des mœurs est un mouvement qui se joue constamment, sans se soucier de sa finalité. Le système mis à jour par Elias fonctionne tant que le lien avec l’autre, basé sur l’interdépendance, fonctionne : le processus de civilisation continue. Si ce lien se rompt, le processus est mis à mal et la civilité recule. C’est pourquoi les Nazis ont tenu à extraire de la société allemande les Juifs pour pouvoir agir à leur guise en les retranchant de l’humanité. Cette forme de barbarie fait donc partie intégrante de la civilisation.
L’intérêt didactique d’un tel ouvrage est de montrer qu’un grand penseur peut s’inspirer de différentes matières, la transdisciplinarité pouvant être féconde, que ce soit dans la recherche intellectuelle la plus pointue mais aussi à l’humble niveau de l’enseignement secondaire, entre disciplines du cursus scolaire au collège et au lycée.
La période de la Renaissance (en 5e et en Seconde) se prête fort bien à l’étude de « la civilisation des mœurs ». Il s’agit alors de montrer, de façon certes un peu réductrice, mais néanmoins démonstrative d’un certain conditionnement social, la différence sous forme de portrait entre l’homme médiéval, en proie à l’exacerbation des passions et des sentiments, et l’homme « renaissant » et de l’époque moderne qui apprend à dompter ses pulsions et extériorise moins ses sentiments. L’apprentissage de la civilisation est celui de la politesse. On mettra ainsi à profit l’utilisation démonstrative en classe de quelques exemples choisis dans le chapitre V de La civilisation des mœurs : le cas concret et toujours édifiant des manières de table (faire moins de bruit en mangeant, ne plus utiliser son corps directement mais des accessoires de table comme la fourchette) et montrer ainsi l’influence de l’Italie à la Renaissance puis de la Cour de France à Versailles au XVIIe et XVIIIe siècle à travers l’Europe.
Sur un plan social et politique, le cours permet de valoriser « l’apogée » de l’histoire nationale, moment où la France devient alors un modèle social à travers ses manières de cour, considérées universellement (en Europe et dans les catégories supérieures de la société !) comme prestigieuses et bienséantes, basées sur le respect de l’étiquette et des convenances. La cour de France est aussi le reflet politique de la supériorité de la noblesse curiale (utiliser un extrait de Le bourgeois gentilhomme de Molière pour montrer le caractère d’exception de la noblesse d’alors, « singée » par le personnage du bourgeois, parvenu stupide en mal de reconnaissance sociale) mais également de sa domestication progressive.



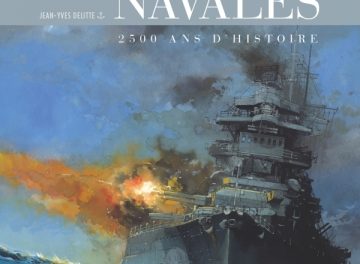
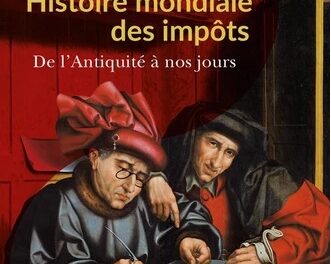









Trackbacks / Pingbacks