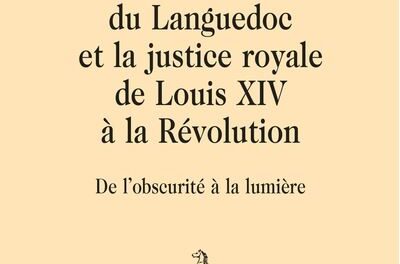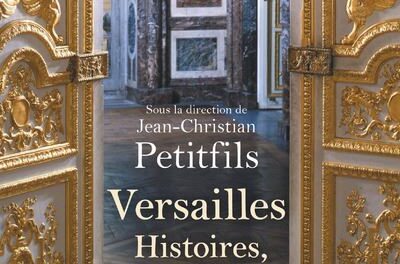Dans son premier ouvrage L’art français de la guerre primé en 2011 par le prix Goncourt, Alexis Jennni avait démontré ses qualités de conteur pour évoquer l’épopée ratée des guerres de décolonisation française. Par le biais d’une narration croisée dont celle d’un des peintres des guerres coloniales enrôlé au sein de l’Armée coloniale française, il avait alors utilisé son talent à montrer le rapport de force entre dominants perdus moralement par l’utilisation de la violence et dominés.
Son dernier ouvrage, La conquête des îles de la terre ferme paru chez Gallimard en 2017 reprend et réutilise les thèmes déjà abordés dans ce précédent opus. De manière très documentée, il évoque en effet sous forme d’épopée tragique la conquête du Mexique par Hernan Cortès entre 1519 et 1521. On y distingue deux thèmes majeurs qui s’entremêlent tout au long du récit: une épopée menée par des héros portant un regard lucide sur leur exploit mais également sur le tragique de cette conquête marquée par la violence et l’incompréhension entre deux peuples.

L’ouvrage débute comme une tragédie antique. Dès le début, le lecteur connaît la fin de l’histoire et prend la mesure de la catastrophe morale et humaine vécue par les Amérindiens. Au terme de sa vie, le narrateur, Juan de Luna, ancien compagnon et rédacteur de Hernan Cortès, devenu grand propriétaire terrien entreprend de raconter son histoire personnelle et de l’insérer dans la grande histoire de la conquête du Mexique. Il se désespère de la manière dont les Indiens se laissent mourir et de la violence dont lui-même fait preuve. Ainsi en est-il de cette scène de bûcher imposée à une indienne qui s’est fait avorter et lui a refusé une âme pour sa ferme. En contrepoint des épopées contemporaines du XVIe siècle qui en vantent les exploits et en particulier La Historia Verdadera de la Nueva Espana de Bernal Diaz de Castillo, le narrateur pose un regard lucide sur cette aventure historique.
Jeune hidalgo issu de la noblesse désargentée de la province d’Estrémadure, Juan de Luna incarne le destin de nombreux cadets de la noblesse espagnole n’ayant plus d’ambition militaire après la Reconquista. Il grandit dans la pauvreté au contact des autres enfants. Dans ces paysages secs de haut plateau, il s’endurcit, se bat avec les autres, apprend à chasser et subit la violence des réprimandes paternelles. Il passe ensuite plusieurs années dans un monastère où il découvre le rythme régulier du travail et de la prière. Il passe aussi beaucoup de temps à lire des romans de chevalerie, fasciné par l’amour courtois et l’idéal chevaleresque. Il s’identifie ainsi à Amadis dont la référence revient au cours du roman pour expliquer le nom donné à la Californie. Epris de Dona Elvira, femme noble, Juan de Luna s’enfuit à Séville, une ville présentée comme une métropole dynamique, commerçante, grouillante à la vie mondaine intellectuelle. Il y mène une vie de libertinage qui l’oblige à fuir vers l’Amérique. La traversée est longue, éprouvante pour des jeunes qui ne sont pas habitués au roulis des bateaux. Le narrateur n’épargne aucun détail. Lui et ses compagnons n’ont rien à perdre et cherchent tous en Amérique à faire fortune, à avoir une vie meilleure, à fuir la société espagnole qui ferme toute possibilité d’ascension sociale.
Arrivé à Cuba, il découvre une société coloniale marquée par la violence subie par les Indiens et les intrigues de pouvoir entre espagnols. Certaines scènes évoquent de manière explicite les violences sexuelles imposées aux Indiennes. Juan de Luna se rapproche de nombreux aventuriers dont Hernan Cortès à qui il restera fidèle. Celui-ci, premier maire de Santiago de Cuba avait participé à la conquête de l’île en 1511 mais ne se satisfait pas de sa situation et veut poursuivre explorations et conquêtes. Le lecteur assiste au retour d’explorateurs comme Francisco Hernandez de Cordoba et Juan de Grijalva. Ils évoquent leurs défaites face aux Indiens sur les côtes du Yucatan et ramènent également des objets en or. La soif de ce métal précieux imprègne tout au long du roman les pensées des Espagnols qui le vénèrent.
L’épopée de Cortès n’est pas sans rappeler celle de Christophe Colomb évoquée dans le film 1492. Dans un premier temps, on y voit un jeune homme ambitieux, avide de conquêtes et de reconnaissance comploter et s’imposer face aux puissances dominantes pour mener ses expéditions puis conquérir des territoires. Sa gestion des territoires est contestée et déconsidérée. A la fin, seules de nouvelles expéditions lui permettent de s’affirmer à nouveau.
Ainsi, tout au long du roman, Cortès est présenté comme un fin stratège tant envers les Espagnols que les Indiens. Il déjoue les plans du gouverneur de l’île de Cuba en précipitant le départ de l’opération. Il découvre de nouvelles îles, touche le Yucatan et plus au Nord fait construire l’actuelle Vera Cruz. Régulièrement, il tend des pièges aux membres de l’équipage qui seraient susceptibles de le trahir comme ce moment où il fait détruire les bateaux pour les empêcher de retourner à Cuba. Sa tactique s’élabore aussi vis-à-vis des Indiens. Il utilise des traducteurs, se rapproche d’une jeune esclave maya, la Malinche prénommée Marina qui apprend très vite l’espagnol. Tel César dans la Guerre des Gaules à qui il se compare, il divise les peuples indiens pour mieux s’imposer et s’appuie sur ceux soumis aux Aztèques pour faire la conquête de Tenochtitlan –Mexico.
Les batailles sont extrêmement violentes. Une grande partie du roman les évoquent de manière très détaillée comme des scènes de boucherie. La scène la plus impressionnante est celle racontant la fuite de nuit du château de Moctezuma. Aucun détail n’est épargné comme les cadavres s’enfonçant dans l’eau du lac, les soldats marchant sur eux….
Mais si la conquête militaire s’avère réussie, la domination du pays l’est beaucoup moins. Les Indiens meurent de mystérieuses maladies dont les Espagnols sont immunisés, ils fuient, le pays se vide et ceux qui restent, réduits en esclavage se laissent mourir, paraissant insensibles aux pires violences. Les Espagnols eux, contestent la domination de Cortès à qui ils reprochent d’avoir volé tout l’or, d’avoir confisqué tous les biens précieux et de s’être arrogé un pouvoir exorbitant. Cortès ne reprend son énergie, à la fin du roman pour mener ses dernières découvertes, celle terriblement meurtrière du Guatemala et celle de la Californie qu’il prend pour une île.
Dans ce roman, la question du contact avec les populations indiennes est très importante. On y voit s’ébaucher l’évolution des rapports entre populations espagnoles nouvellement arrivées et les différentes populations indiennes. A Cuba, les Indiens sont décimés et n’ont peu le droit à la parole. En revanche, les Espagnols sont surpris par l’organisation militaire des Aztèques et leur maîtrise du territoire. Un motif d’effroi et de dégoût est la découverte des rituels de sacrifices humains et d’ «idolâtrie ». De nombreux moments les évoquent et montrent également la réaction des Espagnols qui imposent de rendre des cultes à Marie et à Jésus. Pour autant, le narrateur, découvrant des tâches de sang sous la statuette de Marie est bien conscient que les formes traditionnelles de la religion sont conservées. Les épisodes les plus marquants sont ceux pendant lesquels le narrateur découvre le temple, en décrit les puanteurs, l’effroi du sang et des personnages jetées dans l’escalier chaque matin comme sacrifice au Dieu Soleil.
Les récits de conquête sont ponctués de textes indiens marquant leur mesure du temps et donnant leur point de vue sur les Espagnols. On peut y constater l’importance et la qualité du réseau d’information que les Aztèques possédaient. Ainsi étaient-ils informés de l’arrivée des Européens sur le sol mexicain. Par ailleurs, dans ces différents textes, les Indiens portent un regard très méprisant sur ces hommes qui ne semblent pas en être. Ils méprisent les cadeaux qu’ils leur font, pensent qu’ils devraient mourir de honte d’être si pauvres et considèrent leur victoire rapide et assurée. Cette mise en perspective évoque les travaux de Serge Gruzinski qui avait utilisé des textes en nahuatl pour montrer la vision que les Indiens portaient sur ces conquistadores espagnols. Un des rares textes en nahuatl du roman est un poème d’amour que Elvira, l’épouse indienne renommée par Juan de Luna lui enseigne à la fin du roman. Car, de fait Juan de Luna reste fidèle à la femme indienne qui lui a été donné lors d’un échange. Il éprouve pour elle un amour sincère et noble au point de la chercher pendant les batailles et de finir par l’épouser, au contraire des autres espagnols qui épousent plus tard des Espagnoles. Le livre se termine par le décès d’Elvira et la naissance de leur enfant métis, qui symbolise le Mexique métissé, syncrétique et mélangé des deux peuples.
Pour conclure, il est possible de penser à une exploitation pédagogique de cet ouvrage. Des extraits de ce roman peuvent ainsi être utilisés en classe de Seconde dans un travail sur la ville de Tenochtitlan car on y trouve de belles descriptions de la ville ou dans une étude sur la conquête elle-même et sa violence en lien avec des documents historiques indiens ou espagnols. Il peut également donner lieu à un travail en interdisciplinarité avec les professeurs de lettres dans le thème du rapport à l’Autre. Ceux-ci utilisent parfois les Essais de Montaigne ou la controverse de Valladolid. Enfin, un travail est également envisageable avec les professeurs d’espagnol qui travaillent sur les notions de « mythes et héros », de « lieux et formes de pouvoir » et d’« espaces et échanges ». Cette histoire de la conquête espagnole brasse ces trois notions.