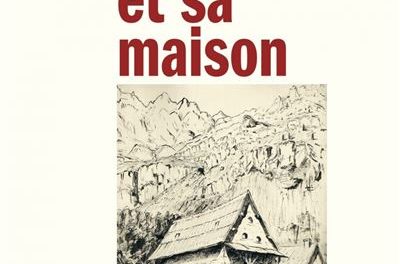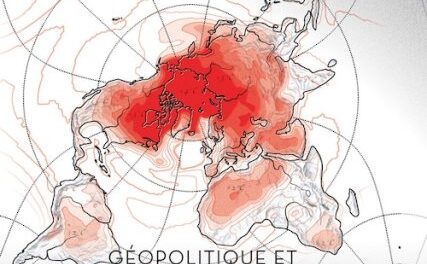L’espace public au coeur de l’urbain
Denis Delbaere part d’une réflexion sur ce qu’est l’espace public comme lieu. Il en propose une brève histoire dont il tire deux enseignements.
D’abord, l’espace public est en tout lieu qui se trouve investi par la société civile. A ce titre, les places centrales et le coeur des villes n’ont pas plus d’importance comme espace public que les lieux de la périphéries qui sont effectivement appropriés par les habitants. L’espace public associé à la place ou à la rue relèvent d’une lecture architecturale et fonctionnelle de la notion : la place est le lieu du rassemblement, la rue le lieu de la rencontre. Or Denis Delbaere critique sèchement ce regard, rappelant avec un art consommé de la description (le talent du paysagiste) que la place tend à devenir le lieu du contrôle social et que la rue n’est plus que le support des déplacements fonctionnels (consommation, mobilité pendulaire). Ce n’est certainement plus un espace de rencontre ; au contraire une « gymnastique du trottoir » dans la fluidité des circulations permet surtout d’y développer des stratégies d’évitement de l’autre. La fonctionnalisation croissante des lieux de la ville-centre anéantit toute possibilité d’y produire vraiment de l’espace public.
Ensuite, la ville et sa centralité entraînent une « évidence » du dynamisme de la métropole qui va à l’encontre de la réalité des relations sociales. En effet, la société civile se trouve dépossédée de sa capacité à investir les lieux centraux, donc à leur donner du dynamisme. Dans le centre, tout est contrôle : contrôle de l’occupation (par l’aménagement des lieux comme l’installation d’un mobilier urbain qui anticipe la possibilité de stationner ou la refuse), contrôle des circulations (signalisation, aménagement des axes), contrôle des activités (par zonage, par la multiplication des dispositifs de surveillance). Mais la réalité vécue et sensible met en avant l’archipel des quartiers urbains et leur enclavement liée à la résidentialisation des espaces publics : les places et les axes s’insèrent dans un rythme de l’urbain mais n’en conditionnent pas de sens.
Denis Delbaere propose une démonstration par la description du paysage urbain que traverse celui qui va rendre visite à un ami. « Quittant l’autoroute, il s’engage sur la voie urbaine dont le profil symétrique et les plantations d’alignement évoquent ce qu’il est convenu d’appeler un « boulevard urbain ». Il veille à ne pas mordre la glissière en béton qui délimite le terre-plein central entre les deux séries de voies de circulation centrales. Il actionne son clignotant pour gagner la voie de gauche et s’engager sur le tourne-à-gauche prévu à cet effet; Il traverse alors la série de bandes parallèles qui occupe la bordure du boulevard : une bande de stationnement, puis une seconde bande de terre-plein plantée d’arbres décoratifs, puis une piste cyclable monodirectionnelle, puis par une seconde bande de terre-plein occupée cette fois-ci par des arbustes et des massifs de fleurs, ceci afin de na pas occulter excessivement la visibilité et ne pas réduire la luminosité des logements riverains, pourtant bien éloignés de la voie. Longeant ce terre-plein, un trottoir de deux mètres de large permet le croisement confortable de deux individus, mais pas l’avancée de front d’un groupe de plus de trois. Aucun banc, pas la moindre assise afin d’éviter la fixation des passants à proximité des maisons riveraines. Le trottoir est régulièrement incliné pour abaisser la bordure et permettre, tantôt la traversée en certains points précis des piétons (passages piétons), tantôt le franchissement des véhicules des riverains, dont les maisons sont dotés de garages individuels. Ces maisons sont construites en retrait de quelques mètres vis-à-vis de l’espace public, laissant le long du trottoir une bande de terrain enclose par une épaisse haie doublée d’une grille de trois mètres de haut, en sorte que les façades sont pratiquement imperceptibles depuis le trottoir et qu’on ne saurait les regarder sans s’arrêter et les scruter de manière ostentatoire » [p. 18-19]. En réhabilitant par le regard et l’arpentage l’espace sensible, Denis Delbaere questionne très utilement nos habitudes de déplacement et nos perceptions d’un urbain « allant de soi » qui ne sont au fond que l’intériorisation et la validation de la proposition habituelle d’aménagement urbain.
Vers un aménagement de la marge : le rôle du paysage
Denis Delbaere investit dans son ouvrage les lieux de la périphérie, ceux qui n’ont pas encore subit le travail de normalisation et de formatage par les aménageurs. L’auteur n’hésite d’ailleurs pas dans son ouvrage à éreinter les métiers et professionnels de l’aménagement, rappelant à quel points ils obéissent à des catégories et des critères qui rétrécissent le champ des possibles de leur travail.
Denis Delbaere propose un point de vue rafraichissant sur l’urbain et le périurbain. Il abandonne les centres à leur dévitalisation pour s’intéresser aux lieux qui font l’objet d’une réelle coproduction, quartiers périphériques où les habitants produisent de l’espace public, interstices entre deux lieux qui sont arpentés par des usagers qui leur donnent sens. Il développe une réflexion sur l’aménagement fondé sur le paysage, c’est à dire sur un espace perçu par les usagers. Il pose l’idée d’un paysage qui dispose du potentiel d’aménagement et de renouveau de l’espace public, prenant des exemples dans ces marges : la levée de la Loire. Et « dans les formes émergentes de l’espace public, il est impossible de maintenir l’ordre classique selon lequel les pouvoirs publics tracent les plans de voirie, découpent le territoire en ilôts, attribués ensuite aux investisseurs privés qui n’ont qu’à se soumettre à ce plan d’ensemble. C’est l’inverse qui se passe : l’appropriation privée des espaces produit des formes et des traces, à l’intérieur desquels chemins et infrastructures doivent se positionner » [p. 106].
Cette réflexion d’urbaniste doit être rapprochée des travaux des géographes sur l’organisation des territoires urbains. Dans Les nouvelles périphéries urbaines. Formes, logiques et modèles de la ville contemporaine dirigé par Marc Dumont et le Emmanuelle Hellier (Presses Universitaires de Rennes, 2010) critiquent ainsi la notion de centralité urbaine comme « urbanité vertueuse » et partent à la recherche des territoires « intermédiaires ». L’opposition urbain-rural est sérieusement remise sur le métier, car la forme d’organisation sociale qui s’impose même dans les espaces réputés ruraux est un mode d’organisation urbain fondé sur la mobilité. Les espaces indéterminés dans leur fonctionnalité et ouverts sont ceux où s’invente un nouveau rapport à l’espace public et une redéfinition de l’urbanité. Les différentes contributions à cet ouvrage complètent et prolongent très utilement le travail de Denis Delbaere, lui donnant un surcroît de cohérence en le mettant au contact de la recherche en cours.
Enjeu et limites des espaces « naturels »
Les friches intéressent particulièrement Denis Delbaere, les parcs agri-urbains comme le parc de la Deûle à Lille ou les bases de loisirs qui se mettent en place dans les accotements et parcs naturels régionaux sont autant d’espaces appropriés informellement par les citoyens, qui parfois se battent pour en repousser l’aménagement et maintenir leur caractère informel. Ils sont en commun d’être grands, ouverts et faiblement aménagés ; ils « autorisent et fournissent un cadre social admissible à la sociabilité diffuse de l’entre-soi » et à « l’évènementialité » [p. 70]. Leur naturalité est ce qui fait leur potentiel, mais « la nature, en soi, n’est pas un espace » [p. 72], plutôt un réservoir pour l’émergence des espaces publics. C’est dans ces lieux que l’on trouve de la « mixité sociale et fonctionnelle » [p. 74] et leur marginalité leur donne une identité qui ne les limite pas au support aux axes de transports mettant en relations des centres.
Denis Delbaere évoque largement le cadre d’élaboration des aménagements, les acteurs privés et publics qui s’y trouvent associés et le cadre mis en place par le législateur depuis les années 1970 jusqu’à l’étape récente de promotion du développement durable dans le cadre du Plan Climat [p. 161 sq.]. Il en profite pour tacler le discours incantatoire du développement dont la durabilité ne constitue pas un projet ni de société ni d’aménagement du paysage. Ce dernier est modelé par l’activité humaine, et il est vain de sanctuariser le paysage. Au contraire il faut admettre la non durabilité du paysage, qui n’empêche toutefois pas la préservation des écosystèmes.
Quelle place pour une démocratie spatiale ?
Denis Delbaere questionne l’espace public comme espace politique symbolique et comme lieu de la publicisation des idées. Il en propose un survol historique, mettant en relation et en comparaison l’espace public antique décrété, de l’espace public médiéval et de l’autoritarisme moderne. L’époque contemporaine se caractérise dans la République française par la tension entre plusieurs échelles, le pouvoir accru des pouvoirs locaux, notamment des communes, en relation avec la réaffirmation de l’Etat aménageur après la Seconde Guerre mondiale. La « superposition des pouvoirs fait que le moindre projet d’espace public mobilise, directement ou indirectement, plusieurs maîtrises d’ouvrage, dotées chacune de leur propres services de planification et d’expertise, et aménageant sur la base de la passation de marchés publics souvent distincts les uns des autres, faisant intervenir des maîtres d’oeuvres (architectes, paysagistes, éclairagistes) et des entrepreneurs différents » [p. 85]. Mais la multiplication des acteurs conduit à des espaces publics qui ne sont plus l’expression d’une volonté d’aménagement lisible mais d’une négociation entre les acteurs où les usages sociaux des espaces ne sont plus pris en compte. On trouve ici le coeur de l’argumentation de Denis Delbaere : « plutôt que de modifier le territoire pour l’adapter aux enjeux socio-environnementaux, il faut partir de ce que le territoire nous donne, des formes d’esace que la société génère spontanément, et activer ses singularités par le projet de paysage : la qualité environnementale suivra automatiquement, autant que la qualité sociale » [p. 175].
La place de la population dans la gestion de l’espace public est en fait en débat depuis les révolutions du XVIIIe siècle, d’autant que pour Denis Delbaere, « la démocratie est hostile aux grands projets ». Les révolutions posent deux dimensions importantes de l’espace public en relation avec l’émergence d’une société civile distincte de l’Etat. D’abord l’espace public est celui qui est concrètement approprié par les citoyens : la rue évidemment, mais également les clubs et les églises. Ensuite, l’espace public est celui du débat de la société civile ; il peut être totalement déterritorialisé, hors des cadres spatiaux que les pouvoirs publics construisent comme des instruments de contrôle. C’est l’un des rôles que l’on peut trouver dans l’existence de la presse qui permet l’ubiquité du débat et la non-coprésence de tous les acteurs du débat, de tous les citoyens. L’intérêt que porte Denis Delbaere au parc de la Deûle dans le sud-ouest de Lille [p. 137 sq.] tient dans la plasticité de cet espace qui en fait le paradigme de l’espace public : un espace vaste, et en extension, ouvert et disponible pour une grande variété d’usage comme de recompositions. Surtout si cet espace public est disponible, « son appropriation relève d’une décision » [p. 141] et sa constitution d’une volonté ancienne (1960), donc d’une continuité dans la volonté qui selon Denis Delbaere doit être soutenu comme un élément essentiel de l’identité urbaine lilloise.
La défense d’un « urbanisme critique »
L’approche revendiquée faite d’ironie et de d’acuité du regard fait toute la saveur de cet ouvrage. D’autant plus qu’elle est placée au service d’une ambition louable.
Toutefois, la question de la coproduction des paysages est un point sur lequel Denis Delbaere n’est pas le plus convaincant. En effet, il se réclame d’une approche critique de l’urbanisme et ne se gène pas pour tancer les modes de l’aménagement. La coproduction des espaces par les acteurs de l’aménagement et le public est essentielle, et l’auteur conteste intelligemment le discours de « l’exactitude technique » et de « l’objectivité des experts » [p. 136]. Mais s’il rappelle que l’aménagement fait appel à un nombre croissant d’acteurs, il prête assez peu d’attention aux raisons qu’ils invoquent pour mettre en oeuvre une normalisation de l’espace.
Mais s’il y a coproduction, il y a quelque part un compromis entre le public et de l’aménageur dans la production de l’espace public tel qu’il est, sauf à considérer que le public se fait manoeuvrer (ce qu’il ne démontre pas). Les acteurs multiples semblent au final vouloir cet espace ; en tout cas ils le font. Il n’y a pas opposition radicale entre des conceptions de l’espace mais des pratiques différentes des espaces qui font parfois triompher un point de vue minoritaire (un groupe de pression par exemple), mais c’est le jeu de cette coproduction. On n’est pas dans une logique du « peuple contre les gros », ce que parfois l’analyse sous-tend. Mais les exemples développés ne vont pas dans le sens de la domination symbolique bourdieusienne des aménageurs. Ils sont eux-mêmes pris dans des contraintes budgétaires, ou de préservation d’un paysage qui les obligent. Or, l’ouvrage ne rend pas toujours justice aux discours des acteurs dans leur diversité, et surtout au discours des habitants de ces espaces remodelés qui semblent ambivalents quant à la question du contrôle qu’ils espèrent et redoutent.
L’ouvrage a sur ce point la séduction du complot : il est agréable de voir une doxa de l’urbanisme contre la société plutôt qu’une lecture de l’individualisme comme paradigme urbanistique. Par exemple, Denis Delbaere oppose l’urbanisme raisonné des centre villes déshumanisé aux quartiers populaires dont la vie tient à ce qu’ils n’ont pas été qualibrés par les aménageurs. Mais cette lecture donne aux aménageurs une toute puissance qui les déconnecte des populations, comme si à l’échelle locale les comités de quartiers et les édiles n’étaient pas l’un des rouages importants de cette normalisation de l’espace. Elle crée également l’impression d’une extériorité de la volonté de contrôle sociale, comme si le discours sur la sécurisation ne produisait pas d’effet de réel ou de transformation des représentations. C’est en favorisant le dialogue social dans le cadre des questions urbaines que peu se faire le changement.