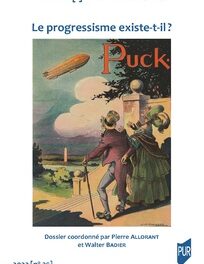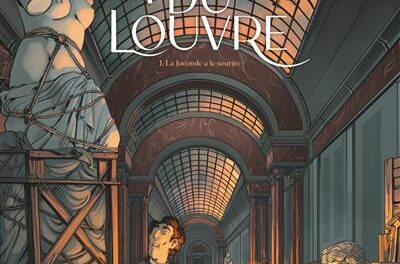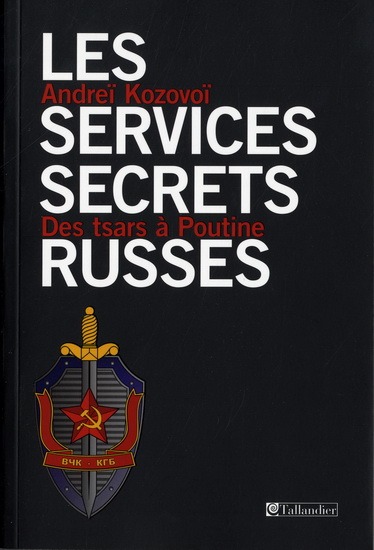
Du tsarisme au stalinisme
L’essentiel du propos est logiquement consacré à la confrontation Est-Ouest, revisitée côté coulisses. Cependant, en amont du mythique KGB, les antécédents des services secrets russes s’ancrent dans un lointain passé tsariste. La création précoce par le tsar Alexis Ier, en 1654, d’une chancellerie privée chargée des affaires secrètes, présente des analogies manifestes avec le Secret du Roi Louis XV en France, un siècle plus tard.
Des méthodes de chiffrement rudimentaires sont rapidement adoptées. Pierre Ier amplifie et perfectionne ce dispositif dont l’apport est précieux pour la diplomatie impérialiste de la jeune puissance conquérante. Il crée aussi la première police politique russe. Le XIXe siècle rationalise et regroupe les différents services. Les États-Unis sont déjà une cible privilégiée de leur intérêt ! Les services de renseignement militaires sont fondés officiellement en 1856. L’assassinat du tsar Alexandre II détermine la création de l’Okhrana en 1881. L’activité du nouveau département est protéiforme, et allie à la recherche du renseignement des opérations de « désinformation », au rang desquelles s’inscrit la fabrication d’un faux antisémite tristement renommé : les nauséabonds Protocoles des sages de Sion. A la veille de la Grande Guerre, un premier agent double majeur au service de la Russie est démasqué : c’est le colonel autrichien Alfred Redl, dont la vie torturée a inspiré un beau film interprété par Klaus-Maria Brandauer.
Contrairement à ce qu’on aurait pu supposer, la Révolution russe ne bouleverse pas les services. La continuité des méthodes et des spécialistes, dont les compétences sont trop précieuses pour être éradiquées, est forte entre l’Okhrana tsariste et ses réincarnations bolcheviques, jusqu’à ce que l’épuration stalinienne décime aussi les plus sanguinaires serviteurs de la Loubianka. La profession obtient néanmoins son adoubement idéologique avec la création en 1938 d’une école des cadres du renseignement. La bipolarité entre les services militaires (GRU) et policiers (Tchéka successivement rebaptisée Guépéou, NKVD, MGB, KGB et aujourd’hui FSB) est maintenue. Le Komintern constitue un précieux faux-nez pour les actions extérieures et un outil de déstabilisation révolutionnaire. Les opérations à l’étranger ciblent d’abord le milieu des réfugiés russes blancs, puis se polarisent sur le péril trotskiste à partir de la Guerre d’Espagne, parvenant à éliminer Trotsky lui-même dans son refuge mexicain. Les années Trente sont un âge d’or de l’infiltration et du recrutement idéologique aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon. En revanche, l’Allemagne nazie est négligée, en conformité avec la cécité obstinée de Staline, qui rejette les informations pourtant nombreuses et concordantes l’avertissant de l’imminence de Barbarossa.
De la Guerre Froide à Poutine
Durant la Seconde Guerre Mondiale, l’URSS ne cesse pas d’espionner ses alliés anglo-saxons : outre le renseignement militaire, ses oreilles paranoïaques épient de chimériques indices de paix séparée entre les occidentaux et l’Allemagne. Elles sont aussi aux aguets pour dérober les secrets du programme atomique américain. L’action des services se planétarise avec la Guerre Froide, et s’accommode des purges intensives qui renouvellent largement leurs rangs après la guerre. La chute des Cinq de Cambridge, caractérisée par la fuite à l’Est de Burgess, Maclean et Philby et l’effacement de leurs deux comparses plus discrets, signe la fin de l’âge d’or de l’espionnage soviétique. Pourtant, l’effort se poursuit à travers une multitude d’opérations, notamment celles dites « mouillées » ou « actives ». La confrontation feutrée avec l’Occident faiblit d’autant moins que, comme le rappelle Brejnev, la Détente «n’abolit en aucune manière les lois de la lutte des classes». Si les puissances anglo-saxonnes verrouillent désormais mieux leurs secrets, la France aurait été, assure l’auteur, une véritable « passoire » pour les agents russes dans les années 1960 et 1970. Prenant la mesure des retards de l’URSS, les dirigeants soviétiques mettent l’accent sur la quête du renseignement scientifique. On découvre ainsi avec surprise la création par Khrouchtchev, dans la banlieue de Moscou, d’une Silicon Valley secrète dont les travaux étaient alimentés par les fruits de l’espionnage technologique ! Iouri Andropov, administrateur policé et modernisateur efficace qui dirigea pendant quinze ans le KGB avant d’accéder au pouvoir suprême, ajoute la lutte contre les dissidents à la palette des missions de ses services. Dans la guerre de la désinformation, le coup le plus réussi du KGB serait la diffusion de la rumeur, largement reprise dans les pays d’Afrique, de la fabrication et de la propagation du virus du SIDA par un laboratoire américain.
Tout au long de cette période, Andreï Kozovoï consigne scrupuleusement l’intarissable chronique des traitres démasqués et des transfuges mutuels. Le flux des défections émanant de la maison Russie s’amplifie après 1989, les hommes de l’ombre y étant en proie au désenchantement, au doute, au discrédit et aux difficultés matérielles. La reconversion post-soviétique des « services » passe par le triptyque désidéologisation, redéploiement et amaigrissement. Un rapprochement s’opère avec l’ennemi d’hier pour traiter des dossiers d’intérêt commun. Mais les égoïsmes et les appétits de puissance de la Russie demeurent, et c’est à leur service que la dynamique poutinienne revitalise l’action du FSB. La découverte des activités d’espionnage d’un haut-responsable estonien à l’OTAN en 2008 et le récent démantèlement d’un réseau d’infiltrés aux États-Unis témoignent pleinement de la capacité des descendants post-soviétiques du grand KGB à perpétuer une culture performante de la subversion et du renseignement.
Au terme de ce parcours, le chapitre final glisse du réel à la fiction pour formuler un tonique bilan historiographique et filmographique des évolutions d’image de l’espion russe. Ce tour d’horizon prend judicieusement en compte la production russe elle-même, méconnue à l’extérieur. Fort d’une visibilité riche et inquiétante dans l’imaginaire anglo-saxon mais d’une existence plus sommaire dans la fiction française, l’agent venu de l’Est bénéficie logiquement à domicile d’une présence aussi positive qu’admirative. Très incidemment, les fidèles admirateurs du perspicace enquêteur du 221B Baker Street ne manqueront pas de déplorer le crime de lèse-Holmes commis par l’auteur (p.375) en affublant Mycroft, le redoutable frère de leur détective de prédilection, du très saugrenu prénom de Mylock ! Ce rare -et anecdotique- accroc d’érudition témoigne, en contrepoint, de la solidité de l’effort accompli par l’auteur, auquel on ne peut guère reprocher par ailleurs qu’un flottement sur les grades variables attribués au traitre américain John Walker. Rassemblant les traits de force de cette longue épopée, une conclusion d’une limpidité parfaite ordonne les lignes de force d’un siècle d’espionnage. Elle aboutit à un diagnostic d’échec stratégique, en dépit d’une collecte d’informations abondante et de résultats ponctuels remarquables. En définitive, l’espionnage russe n’eut pas de meilleur ennemi que lui-même, en raison de l’aveuglement paranoïaque qui faussa, tout au long de l’ère soviétique, le travail d’interprétation et d’analyse des éléments recueillis. Ironie de l’Histoire, la myopie idéologique du système ne lui a donc pas permis de tirer pleinement parti de ses habiles braconnages chez l’adversaire.
Le panorama brossé par Andreï Kozovoï éclaire avec beaucoup de soin les angles obscurs de la relation complexe entre la Russie et l’Occident, depuis le temps des tsars jusqu’à celui des oligarques. Bien que sa vision de la confrontation secrète au temps de la Guerre Froide soit plus sensible à la lecture atlantiste des événements qu’à leur version russe, il en résulte un ouvrage sérieux et solide de vulgarisation exigeante, qui n’aura pas de peine à devenir une source de référence.