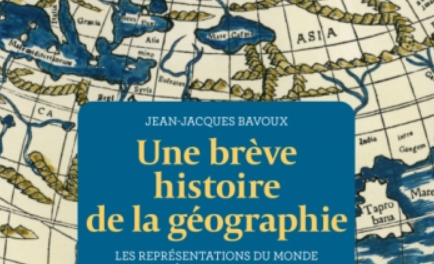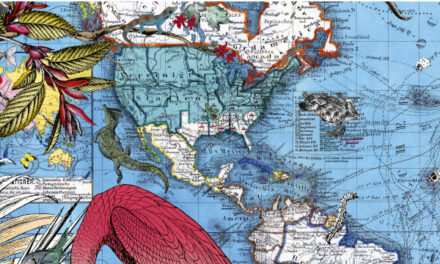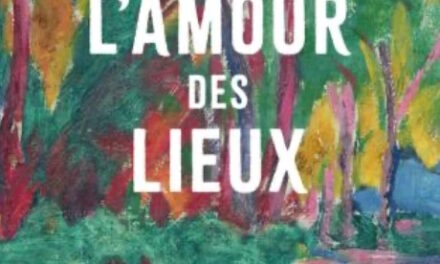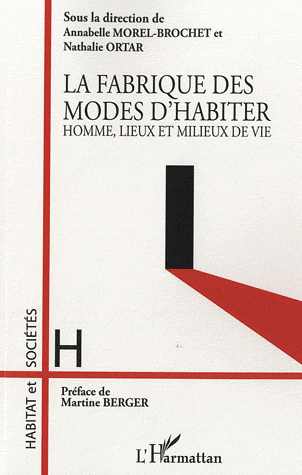
La nouvelle génération prend les rênes de l’édition ! Après la publication des actes du colloque Etre logé, se loger, habiter, sous la houlette de Lionel Rougé (thèse soutenue en 2005) et de Martine Berger en 2011, voici qu’Annabelle Morel-Brochet (thèse soutenue en 2006) et Nathalie Ortar (thèse soutenue en 1998) ont compilé les approches pluridisciplinaires empiriques et qualitatives de 14 auteurs intervenus lors des séminaires du LADYSS (2004 – 2007). Le tout est préfacé par la figure tutélaire de Martine Berger (Les périurbains de Paris. De la ville dense à la métropole éclatée ? 2004).
L’ensemble des contributions tourne autour de la thématique du mode d’habiter. Nicole Matthieu revient sur la genèse de ce concept qu’elle a élaboré au tournant des années 1970 – 1980 à mi chemin entre le concept de genre de vie des Vidaliens et celui de mode de vie, cher aux sociologues. L’intérêt pour l’habiter consiste à « interroger les rapports qu’entretiennent les individus ou groupes sociaux avec leurs lieux et milieux de vie, leur habitat au sens large. » Annabelle Morel-Brochet dresse une rétrospective épistémologique très utile des modes d’habiter. Elle montre que ce qui fait la force du mode d’habiter, c’est qu’il concerne toutes les échelles, y compris temporelles. Le mode d’habiter est « influencé par nos modes d’habiter ailleurs et antérieurs. » L’ensemble des textes présentés est organisé en trois grandes parties thématiques évoquant le rapport du corps / du cœur au lieu, celui avec l’extérieur que ce soit un jardin à soi ou une maison de vacances. Le tout constitue un ouvrage qui se picore au gré des envies et n’exigeant pas une lecture linéaire. Les articles sont soignés et davantage élaborés que des textes publiés dans des actes de colloque. La durée du séminaire explique sans doute cela.
L’habitant par cœur, l’habitant par corps
Cette approche passe par les expériences sensorielles vécues par les habitants dans le lieu qu’ils habitent. Lucile Grésillon présente ici une réflexion sur l’analyse sensorielle pour comprendre comment un individu en fonction de son rapport au lieu (« Ne pas sentir » un lieu, une personne) va s’y attacher ou pas. Elsa Ramos questionne la thématique de l’ancrage en prenant en compte le lieu d’inscription sur les listes électorales des individus.
Habiter ici, … malgré tout
Les textes réunis dans cette partie rendent compte des difficultés qu’il y a à concilier l’attachement à un lieu et emploi. Lors de la délocalisation d’une entreprise picarde à Sens, 73% des salariés ont choisi le licenciement plutôt que de conserver un emploi loin de chez soi. Le lien au territoire, à la famille, aux réseaux locaux est donc central. Le cas des femmes habitant le milieu rural (sans doute classé en espace périurbain aujourd’hui avec les nouveaux critères territoriaux de l’INSEE 2011) et y travaillant permet de voir que le panel des emplois qui s’offre à elles est très réduit et qu’elles font souvent « avec » en optant pour des tâches d’assistance maternelle. L’article de Julien Langumier, issu de sa thèse soutenue en 2006 et publiée en 2008, consiste en une enquête ethnographique auprès des habitants sinistrés de Cuxax d’Aude, village inondé en 1999. De quoi rendre plus concret une étude de cas sur les risques en seconde, grâce une réflexion sur l’importance des objets du quotidien dans la vie des habitants.
Un dehors à soi
C’est sans doute la partie la plus passionnante de l’ouvrage. Les auteurs mettent en œuvre une réflexion autour du rapport à la nature par le biais du mode d’habiter. Ainsi, Pauline Frileux montre que les habitants périurbains des lotissements pavillonnaires plébiscitent une nature domestiquée dans leur jardin. Ils désirent que le paysage qu’ils créent et qui est visible de la maison toute l’année soit le plus vert possible. C’est pourquoi les espèces végétales autochtones sont souvent négligées au profit d’arbustes persistants. Le lien avec le jardin des périurbains est plus fort que celui que les habitants urbains d’appartement peuvent entretenir avec leur rez-de-jardin, qui demeure malgré tout un espace très investi. L’appropriation des espaces publics par les populations, traitée par Anne Jarrigeon, est passionnante à lire. Les manies des habitants, mais aussi des touristes sont décryptées à partir de trois lieux : l’esplanade de Beaubourg, le parc de la Villette, le forum des Halles. La place de l’art public dans la ville permet de voir comment les usagers s’approprient l’espace.
Habiter ailleurs. Autrement ?
L’Ailleurs ici se limite à la maison de vacances et à la résidence secondaire. Christophe Granger propose une approche historique de la maison de vacances et de son appropriation à partir de l’analyse, en autres, de magazines féminins. C’est le moment de « relâcher la discipline ». « Vous avez toute l’année pour faire votre métier de maitresse de maison. » Marie-Claire, 1960. Elsa Ramos analyse le rapport entretenu par les enfants de migrants portugais avec la maison de rêve construite au pays au prix de nombreuses privations. Elle montre que s’approprier un tel lieu n’a rien d’évident, y compris dans le cas d’un retour au pays. On ne transforme pas une maison de vacances en résidence principale si facilement. Nathalie Ortar s’intéresse aux objets déposés dans les résidences secondaires et qui témoignent de la volonté pour les propriétaires de se construire une histoire familiale et de la transmettre.
Ainsi ethnologues, sociologues, géographes scrutent, par le biais de leurs enquêtes, les moindres faits et gestes des habitants pour y trouver le sens caché de leur existence. Lucile Grésillon milite pour un rapprochement entre les sciences humaines et les neurosciences. Le rapport au lieu que l’on habite est le résultat de la combinaison compliquée de facteurs sociaux, psychologiques, physiologiques. Le bonheur ne se décrète pas !
Catherine Didier-Fèvre ©Les Clionautes