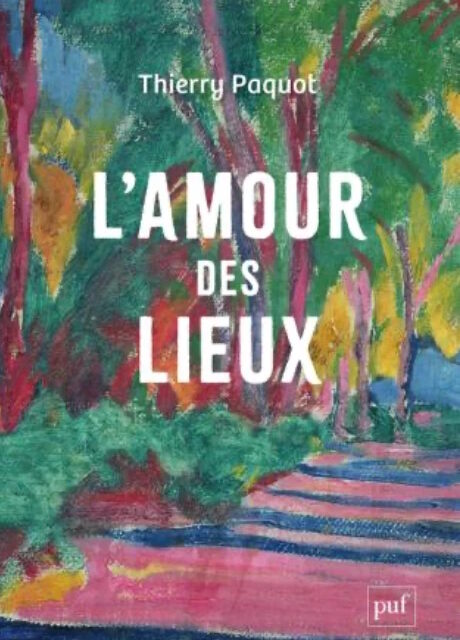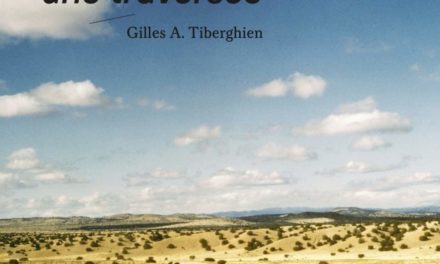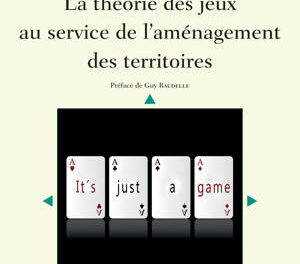Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, comme il se définit lui-même, s’intéresse depuis de nombreuses années à l’urbanisation planétaire et à ses dangers, aux utopies et à la géohistoire de la pensée écologique, à l’habiter.
Le discours (logos) sur la maison, le foyer (oikos) est une manière d’être au monde, propre à chaque être humain. Ceci fait dire à Thierry Paquot dans son prologue que tout être humain possède sa propre « écologie », à la fois situationnelle, relationnelle et sensorielle. Tout humain est localisé et inscrit dans des milieux. Tout humain communique avec ses semblables.
Tout humain apprend à appréhender son milieu, à communier avec la nature et le vivant grâce à ses cinq sens. Tout humain, pour déployer pleinement et sereinement ses trois qualités réclame un lieu ou des lieux dans lequel ou lesquels il peut s’enraciner (Simone Weil). Pour Paquot, notre relation au lieu façonne notre personnalité tout en s’inscrivant dans notre géographie affective (p.29). Notre relation au lieu peut tout aussi bien être topohilique, tophobique et/ou topocide. Ces trois néologismes constituent, dans leur forme nominale, le sous-titre de ce nouvel objet à penser que nous offre Thierry Paquot.
Les deux premiers chapitres sont consacrés aux espaces habitables et habités : la biorégion urbaine d’abord puis les autres territoires/habitats. La région est urbaine. Se référant à Thomas More, Paquot rappelle que sur l’île d’Utopia les habitants sont des paysans qui résident en ville, bénéficiant de la culture que les villes favorisent et se rendant chaque matin aux champs. S’appuyant sur les travaux de Geddes, Managhi et autres, Paquot défend les bienfaits de ce que pourrait être une biorégion urbaine, une « espérance » comme il le dit lui-même, qui peut prendre du temps à s’installer. Elle doit reposer sur une trilogie décisionnelle : le cas par cas, le sur-mesure et le avec les habitants et le vivant (p.46). À quoi pourrait ressembler une biorégion urbaine ? « À un assemblage territorial à la fois décentralisé, déconcentré et autogéré regroupant des habitations isolées, des hameaux, des villages et des villes de tailles diverses » (p.47). Ainsi, le biorégionalisme entend lutter contre la ville productiviste et miser sur la valorisation des différences propres à un lieu et à sa population, à son histoire comme à sa langue, à ses savoir-faire, ses matériaux, ses énergies, ses agricultures.
La ville productiviste a uniformisé la manière d’habiter les villes. Pour Paquot, il faut éviter de réduire l’habitation à un modèle. Citant Marcel Mauss, l’habitation correspond à un « fait social total ». Sa forme, ses matériaux, son agencement intérieur varient selon des données géographiques, climatiques, écologiques et culturelles. L’habitabilité d’un territoire (depuis sa chambre jusqu’à la biorégion) dépend de son confort (confortare=consoler). L’habitabilité devient ainsi une notion subjective qui échappe à toute normalisation.
Les trois chapitres suivants ont pour thème l’appropriation du lieu. Cette dernière implique ménagement/aménagement et accueillance. En fin lexicologue, Thierry Paquot revient sur l’étymologie du mot « aménager ». Le verbe a pour origine le verbe ancien « ménager » qui a le sens de séjourner, d’habiter. L’aménagement devient très tôt, aux États-Unis, une science, la science domestique. Cette dernière semble constituer l’affaire de femmes. Paquot sort de l’oubli Paulette Bernège (1896-1973) qui fut dans les 1920 une des toutes premières à défendre l’organisation ménagère en France. Ménager, c’est prendre soin de sa personne, de son foyer mais aussi de ceux qui sont invités. Pour les Grecs, nous rappelle Paquot, un peuple civilisé est celui qui sait accueillir son ennemi (hostis) et en faire un hôte (hospes). L’architecte Henri Gaudin affirme que l’hospitalité « n’enferme pas, elle n’abrite pas seulement, elle laisse la limite ne pas avoir de limite » (p.123).
La maison, le quartier, la ville, le monde habité (l’écoumène) ne constituent pas un crescendo d’enveloppes vides, pour Paquot, mais des médiateurs actifs et réactifs à l’existence individuelle et à la vie collective. Dans tous ces lieux, l’être humain fait la part de ce qui lui semble propre à lui-même et de ce qui peut lui être hostile. L’appropriation peut alors être pensée comme un attachement au lieu. C’est la possibilité de faire sien un espace, en le clôturant, le décorant, l’agençant, que celui-ci soit un bureau, un atelier, un appartement, une maison ou bien une chambre d’hôtel. L’appropriation est un processus et non un état, un enrichissement réciproque et non pas une simple adaptation de l’un à l’autre. S’approprier un lieu c’est « devenir autre au contact de » nous dit Paquot (p.133). Le monde n’est ainsi pas donné, il résulte. Inévitablement, cette façon de voir les choses induit la manière de penser le métier d’architecte. Quelle marge de manœuvre celui-ci laisse-t-il aux usagers ? En quoi contribue-t-il à l’appropriation habitante ? Les exemples sont nombreux de projets architecturaux « détournés » de la pensée première des créateurs par les usagers. Pour qu’une architecture facilite l’appropriation, nous dit Paquot, elle doit répondre à la règle de trois énoncée plus haut : le « cas par cas », le « sur-mesure » et le « avec les habitants et le vivant ».
Les deux derniers chapitres évoquent l’amour des lieux proprement dit. La topophilie, néologisme que l’on doit à Gaston Bachelard dans La Poétique de l’espace (1957), est la recherche de l’espace heureux. Dans le même ouvrage, Bachelard invite à mener une étude psychologique systématique des sites de notre vie, ce qu’il nomme la topo-analyse. Le géographe américain Yi-Fu Tuan publie en 1974 Topophilia. A Study of Environement Perception. Il définit la topophilie comme le « lien affectif entre des gens et le lieu dans lequel ils sont installés ».
Presqu’a contrario, la topophobie pourrait se définir comme la peur de tout désagrément spatial, bâti ou non, et la dépréciation territoriale (p.172). Paquot voit ainsi une humanité qui serait coupée en deux. D’un côté les topophiles, misant sur la coopération, l’entraide et l’harmonie, chercheraient l’habitabilité dans toute forme d’habitat, échappant à toute marchandisation, à toute médiation extérieure. De l’autre, les topophobes, rêvant d’enclaves sécurisées, de compétition et d’intérêts privés, chercheraient à dominer la nature en déployant la technique à l’extrême. « L’espace livré à l’imagination ne peut rester l’espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Il est vécu », écrivait Bachelard.
L’ouvrage de Thierry Paquot est une nouvelle fois un ouvrage engagé. Il milite pour un ménagement des lieux, une habitabilité topophile qui mettrait fin à un « topocide » quasi-programmé. Il s’élève une nouvelle fois contre les « désastres urbains » qui nuisent à la recherche « d’espaces heureux » où l’être humain s’épanouirait.