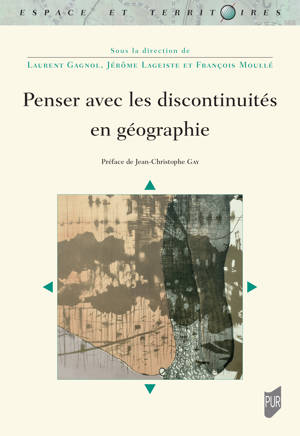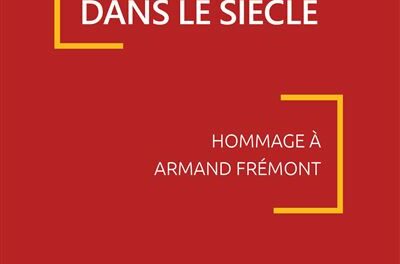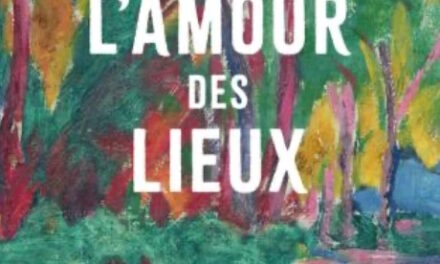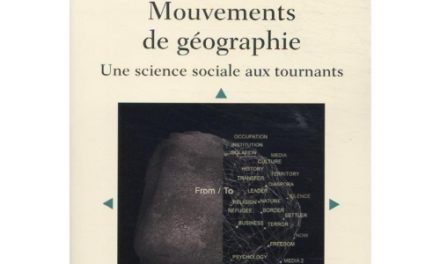Les trois coordinateurs de l’ouvrage sont tous les trois maîtres de conférences en géographie à l’université d’Artois à Arras et membres du laboratoire Discontinuités (UR 2468). Les travaux de Laurent Gagnol abordent les questions du nomadisme des enjeux frontaliers en s’inscrivant dans le champ de l’écologie politique, de la géographie culturelle et politique. Ceux de Jérôme Lageiste concernent la thématique du tourisme en général, et celle du voyage en particulier. Ils articulent les questions d’identités, de genre et de sexualité. Celles, enfin, de François Moullé interrogent les politiques publiques transfrontalières, la gouvernance aux limites et les démarches de diplomatie territoriale. Pour tous les trois la question des discontinuités s’impose. Le concept, né en 1967 avec la publication de la thèse soutenue par Roger Brunet[1], est devenu très vite un concept clé reflétant un tournant pris par la géographie.
Comme Laurent Gagnol le rappelle dans son introduction, « la définition des discontinuités passe par la caractérisation de valeurs-seuils qui produisent des effets-seuils, autrement dit d’identifier et de mesurer les changements quantitatifs qui sont nécessaires pour produire un changement d’ordre qualitatif ». Les discontinuités semblent aujourd’hui plus que jamais caractériser le monde dans lequel nous évoluons. Jean-Christophe Gay, qui a préfacé l’ouvrage et qui a consacré sa thèse sur les discontinuités spatiales en 1992[2], parle de tomogenèse pour évoquer la construction de limites, fractionnant toujours plus le monde dans lequel nous vivons. Ce dernier rappelle ainsi en la matière le travail du philosophe allemand Peter Sloterdijk[3] :
« Notre monde est composé d’un nombre infini de bulles, de cellules, de niches, d’alvéoles, d’aires, etc., s’empilant, se chevauchant, s’emboîtant, se transformant, disparaissant et se reformant. Le philosophe allemand Peter Sloterdijk (2005) parle d’activité aphrogène, d’aphro « écume » pour décrire la mise en sociétés de la Terre, qui n’a pu se faire qu’en créant à l’infini des unités spatiales de formes et de tailles diverses » (p.7).
L’ouvrage recueille quinze contributions regroupées en trois parties. Chaque partie est introduite par un texte qui met en lumière l’orientation donnée par les directeurs de l’ouvrage et les avancées épistémologiques qui sont développées. La première partie est ainsi consacrée aux jeux des acteurs, la deuxième aux représentations et la troisième aux discontinuités socio-environnementales.
L’espace géographique est le produit des relations sociales. Michel Crozier et Erhard Friedberg envisagent, en 1977[4], les sociétés comme des ensembles dynamiques, des systèmes d’acteurs entre lesquels s’exercent de nombreuses interactions. Dans cette première partie, les cinq contributions abordent les discontinuités sous différents aspects mettant en relation des acteurs très variés. Charlotte Bezamat-Mantes étudie le cas des réserves urbaines des premières nations au Canada. Romain Vinadia se propose d’analyser comment le Parti républicain mobilise la notion de discontinuité géographique comme outil politique dans le but d’asseoir sa majorité législative dans les Etats qu’ils contrôlent. Eric Leclerc, à partir de l’exemple d’Amaravati en Andhra Pradesh, montre comment la discontinuité politique peut produire un espace neuf (spatiogenèse). Enfin, Catherine Barthon et Brigitte Monfroy ont concentré leurs travaux sur les discontinuités scolaires et font le constat d’un système éducatif français de plus en plus clivé et inégalitaire socialement parlant mais également géographiquement parlant, au point où certains chercheurs dénoncent un véritable « apartheid scolaire » qui se met en place dans les établissements des quartiers défavorisés des grandes villes.
Depuis le tournant culturel et interprétatif pris par la géographie au cours des années 1980, les représentations occupent une véritable place de choix. Les représentations ne constituent jamais un double du réel, elles en sont toujours une interprétation. L’idée de cette deuxième partie est de saisir et de comprendre les représentations que l’on a et que l’on se fait des discontinuités, lesquelles motivent nos pratiques et nos usages de l’espace. Sur cette thématique, de nouveau cinq communications sont rassemblées. Etienne Toureille analyse la dimension spatiale de l’Europe à travers un corpus de cartes mentales interprétatives (539) produites par des étudiants du premier cycle universitaire en Turquie. Le travail de Toureille s’intéresse aux discontinuités telles qu’elles peuvent émerger dans la polémique sur l’européanité de la Turquie. Sylvie Considère et Fabienne Leloup interrogent les représentations d’étudiants vivant à la frontière. L’étude porte sur un échantillon de 130 étudiants belges, français et suisses qui ont entre 17 et 25 ans. Pierre-Louis Ballot consacre son travail aux continuités et discontinuités vécues dans la construction territoriale de navetteurs de longue (Paris-Lille en TGV) et moyenne distance (Chartres-Paris en TER). Chiara Kirschner s’intéresse à l’itinérance récréative de plus ou moins longue durée. Pour la chercheuse, l’itinérance peut être considérée comme une pratiquer de la discontinuité spatiale, temporelle et relationnelle. Enfin, Luc Gwiazdzinski étudie les nuits, dimension géographique longtemps oubliée de la ville. Les « Night studies » réunissent des historiens, des géographes, des urbanistes, des sociologues, des économistes, des anthropologues, des ethnologues, des philosophes, des biologistes, des politologues, des architectes et des artistes. La nuit est une discontinuité temporelle originelle mais elle s’avère également une discontinuité spatiale comme le montrent les différents conflits entre la ville qui dort et la ville et la ville qui s’amuse.
Investir la notion de discontinuité d’une fonction heuristique peut constituer une grille de lecture pour appréhender les hybridations à l’œuvre entre Nature et Culture. La notion de géosystème proposée par Georges Bertrand[5] et celle d’antroposystème par Christian Levêque et Tatiana Muxart[6] sont désormais envisagées à travers l’expression de systèmes socio-économiques (SES). Dans cette dernière partie, cinq articles ouvrent la voie à des exemples d’hybridations socio-environnementaux. Fabien Roussel étudie à la ceinture verte d’Île-de-France comme zone révélatrice des (dis)continuités socio-environnementales de la métropole parisienne. Corinne Luxembourg s’intéresse aux jardins d’agréments et aux jardins potagers comme manifestations de porosités sociales. Nicolas Verlynde propose d’explorer le lien entre perception du risque d’inondation côtière (dans la communauté urbaine de Dunkerque), sa représentation spatiale et le concept de discontinuité. Souleymane Dia analyse le rôle de la discontinuité nouakchottienne dans l’organisation territoriale des Niayes au Sénégal. Enfin, Marc Galochet interroge les discontinuités de la marge septentrionale de la forêt boréale (taïga) rattachée à la forêt-toundra.
L’ensemble des articles qui composent ce recueil propose une sorte de renouvellement de l’approche géographique des discontinuités en faisant de ces dernières un objet heuristique, une grille de lecture plutôt stimulante pour aborder les dynamiques territoriales.
[1] Roger Brunet, Les phénomènes de discontinuité en géographie, Paris, CNRS, 1967.
[2] Jean-Christophe Gay, Les Discontinuités spatiales, Paris, Economica, 1995.
[3] Peter Sloterdijk, Ecumes. Sphères, t.III, Paris, Hachette, 2005.
[4] Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Le Seuil, 1977.
[5] Georges Bertrand et Claude Bertrand, Une géographie traversière. L’environnement à travers territoires et temporalités, Paris, Arguments, 2002.
[6] Christian Levêque et Tatiana Muxart, « Antroposystème », Hypergéo, 2004 : http://doi.org/10.1007/s11284-006-0074-0