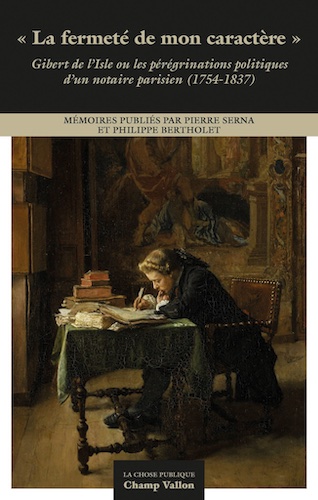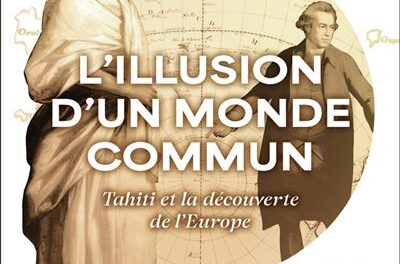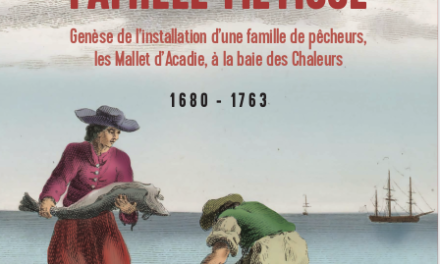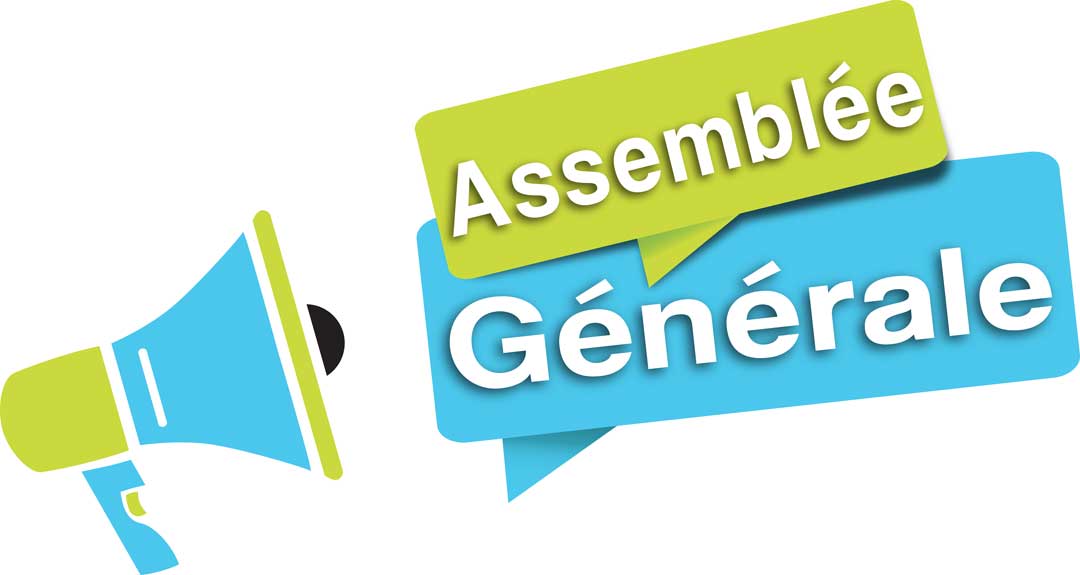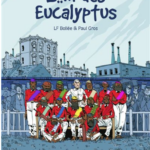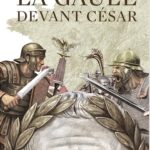Il y a parfois un partage plus profond dans un écrit autobiographique que l’itinéraire personnel de son auteur. Narrateur des péripéties de sa vie et témoin de son temps, il est aussi, pas sa psychologie et sa compréhension du monde, le véhicule plus ou moins conscient d’une mentalité, d’un milieu et d’une identité sociale. Tel est pleinement le cas des mémoires de Charles-Antoine Gibert de l’Isle. Restés inédits, longtemps oubliés dans les réserves de la Bibliothèque de l’Arsenal, ils sortent de l’anonymat de ce purgatoire un peu moins de deux siècles après leur rédaction.
L’auteur pourrait pourtant susciter spontanément plus de compassion que de passion. Car Gibert de l’Isle a, peu ou prou, les attributs d’un raté de l’histoire. Déconfite en effet sa carrière professionnelle de notaire fragile, failli et finalement fugitif. Ruinée également sa vie privée d’époux malheureux et séparé et de père endeuillé. Naufragée encore son expérience de révolutionnaire fort peu révolutionnaire, homme d’ordre en porte-à-faux avec une dynamique politico-idéologique qu’il ne comprend pas, au point de finir par être lui-même incarcéré sous la Terreur. Peu saillant, enfin, son parcours besogneux d’employé d’administration exilé et obscur, dans l’Italie conquise par l’armée française d’abord, à la sous-préfecture de Compiègne ensuite. On pourrait donc s’en tenir à n’y voir qu’une épopée de l’échec en mode mineur.
Mais son destin vaut évidemment mieux qu’un tel procès superficiel sur ses apparences. Car le plus humble des mémorialistes n’en est pas moins un ambassadeur de son époque. Il est aussi celui de son environnement familial et social. Et c’est dans ce registre que Gibert de l’Isle prend toute son épaisseur. Sa plume est trempée dans l’authenticité psychologique d’une personnalité à la fois rigide et scrupuleuse. On suit avec intérêt l’évocation sensible de ses parents, de son éducation, ses liens de sociabilité, la naissance de sa vocation notariale et l’apprentissage opiniâtre et méthodique de son métier. Il y façonne à la fois son identité sociale et la fermeté de caractère dont il se prévaut fièrement. Incarnation de la conscience de soi et de l’éthique bourgeoise forgée dans les milieux parisiens de l’Ancien Régime, il permet une immersion originale dans l’univers notarial de son temps et ses problématiques. Il parvient au faîte de ses ambitions en acquérant en 1784 une étude dépréciée cédée par un prédécesseur véreux et malveillant. L’assainissement de cette situation délicate est un défi difficile. La récession de l’activité durant la Révolution, associée à la crise générale des liquidités, contraint finalement Gibert à s’en défaire, ruiné, avant de fuir à la fois ses dettes et son échec conjugal. Le grand projet de son existence est par terre.
La survenue de la Révolution française ne trouble pas seulement ses espoirs notariaux. Elle le mêle aux affaires publiques. Il s’y implique avec une ferveur certaine comme élu de district et surtout en tant qu’officier de la garde nationale, au sein de laquelle il s’épanouit en guerrier du maintien de l’ordre. Cette expérience lui laisse un souvenir puissant et passionné dont il relate les détails avec effusion. Son activisme militaro-civique situe cet homme d’ordre et de modération dans une prudente mouvance monarchienne. Inquiété sur le plan tant politique, professionnel que personnel par la radicalisation jacobine, dénoncé, il est incarcéré comme suspect sous la Terreur. La relation des affres de son incarcération est une immersion détaillée dans le quotidien tourmenté de la prison Sainte-Pélagie.
Quelques années après cette période trépidante, sa ruine personnelle et personnelle le contraint à fuir ses créanciers en s’exilant loin de Paris. Le quotidien de l’ex-notaire dépossédé de son étude prend dès lors un caractère plus picaresque. Sa famille l’aide à prendre un lointain nouveau départ au sein des organes administratifs de l’armée d’Italie, où ses talents d’homme de bureau et de dossier le font valoir. Il y fréquente le futur maréchal Soult et quelques autres personnalités militaires. L’anecdote la plus saillante de cette période est une enquête policière pour résoudre un crime interne à l’armée dans laquelle Gibert joue -ou s’attribue- le rôle du limier. La paix et le retour en métropole qui en résulte lui font perdre son emploi. Il parvient néanmoins, grâce au jeu de ses relations, à obtenir un poste de bureau à la sous-préfecture de Compiègne. Il s’ensuit un aperçu des tâches qui lui sont assignées, où ses compétences d’ancien notaire sont précieuses. Le mélange des genres y règne entre les intérêts particuliers des sous-préfets successifs et les responsabilités administratives à gérer. Quasi sous-préfet informel, et quelquefois sous-préfet intérimaire sous ses atours de secrétaire de la sous-préfecture, il fait montre de talents multiples et précieux. La façon dont il habite ses responsabilités témoigne de sa rectitude morale personnelle, mais montre aussi combien il fait sienne la culture du service de l’État. Le grand moment de cette vie est la mise en défense de la ville lors de l’invasion des coalisés en 1814. Seul agent resté en poste, notre homme en est la cheville ouvrière à la sous-préfecture. Il retrouve, dans l’organisation de cette lutte, l’exaltation de sa période révolutionnaire d’officier dans la garde nationale parisienne. Mais la guerre tourne vite court. Il faut ensuite assurer la continuité de l’administration publique sous les exigences brutales des deux occupations prussiennes de 1814 et 1815.
Une autre ligne de force, enfin, résulte de la lucarne ouverte sur les loisirs personnels, la conduite morale et la construction sociale du narrateur. S’y dessine l’idéal bourgeois de sociabilité et le style de vie quotidienne que forgent son mode de vie et ses cercles de fréquentation. Il y confesse ses amitiés mais aussi ses détestations. Les historiens de la famille et de la pédagogie y trouveront encore l’exposé de son idéal pédagogique à travers l’éducation qu’il dispense à sa filleule, enfant de substitution au sein d’une famille recomposée informelle reconstituée à Compiègne. Et les amateurs d’anecdotes baroques s’ébaubiront (p.314) de la statue aussi cocasse qu’inattendue de « pisseuse » qui trônait bucoliquement dans le bosquet de son excellent ami M. Houlliez…
Un dernier agrément de ces mémoires tient à leur forme. Le texte courant est d’un style soutenu agréable à lire. Ce riche matériau bénéficie d’une mise en valeur exemplaire grâce à l’association de deux commentateurs éclairés. Nul doute que, sans leurs apports, le témoignage du sieur Gibert de l’Isle aurait eu moins de saveur et de profondeur. Pierre Serna, titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, gratifie le texte d’une introduction de haute volée qui confère perspective et profondeur au document. Philippe Bertholet, expert de référence du notariat parisien d’autrefois et des ressources du minutier de la capitale, enrichit le témoignage de Gibert de l’Isle d’un appareil de notes aussi savant que circonstancié, bien que pas tout à fait infaillible. Une erreur d’identification p. 278 confond de toute évidence l’énigmatique général Varlet en Italie avec un homonyme trop jeune et insuffisamment gradé. Il faut plutôt supposer un souvenir approximatif de Gibert et sans doute regarder en direction de François-Jean Werlé (1763-1811), alors adjudant-général sous les ordres de Soult, grade qui implique une responsabilité supérieure en état-major.
En définitive, ce livre de mémoires dense et prenant, instructif dans les grandes comme les petites choses, éloquent sur les grandes agitations de son époque comme sur les ressentis de la vie personnelle, mérite d’être remarqué. Exact contemporain de cette transition entre deux siècles qui fut aussi une transition entre deux mondes, le trop oublié Charles-Antoine Gibert de l’Isle est lui-même un homme en transition. Lesté de l’encombrant héritage de l’Ancien Régime qui l’a formé, il surnage aléatoirement dans un temps nouveau dont il discerne mal les lignes de force. Mais où il construit finalement sa propre modernité.