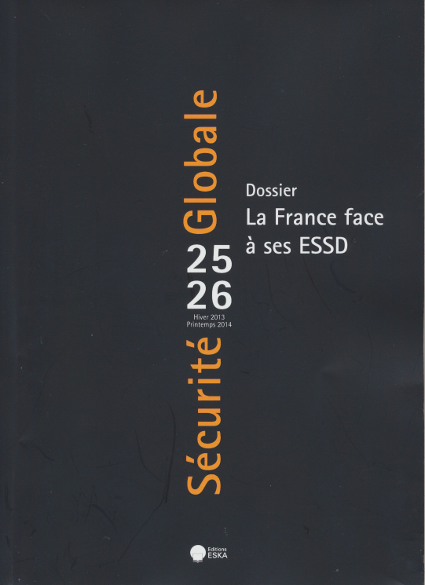
Depuis sa création par l’institut Choiseul, la revue «Sécurité globale» a fait l’objet d’une présentation sur la Cliothèque. Actuellement reprise par les éditions Eska, cette revue reste dans la continuité de sa ligne éditoriale, qui est clairement résumée dans son titre.
Ce numéro est consacré aux entreprises de services de sécurité de défense, avec l’acronyme ESSD et s’inscrit dans la continuité d’un numéro paru en 2008, « la privatisation de la guerre ».
Le rédacteur en chef, Georges – Henri Bricet des Vallons, rappelle très opportunément le caractère unique de cette revue. Les enjeux de sécurité doivent aller au-delà d’un simple traitement journalistique, par l’écume des faits divers, et relever d’une prise de conscience « citoyenne » de ses enjeux.
C’est la raison pour laquelle, au-delà d’intérêts personnels et d’étude de l’auteur de ces lignes, que la Cliothèque, dans sa rubrique « géopolitique » traite avec une certaine constance des sujets de défense. Pour l’essentiel de nos lecteurs, et aussi des adhérents de l’association des Clionautes, qui sont enseignants d’histoire et de géographie dans le second degré, le thème de l’éducation à la défense est intégré dans le programme. Il est souvent traité de façon superficielle, et au niveau des académies, malgré l’existence de certains cercles d’études de défense, par des regroupements à la composition opaque.
C’est la raison pour laquelle ces questions de sécurité et de défense sont largement traitées sur la Cliothèque, afin de donner aux professeurs en charge de la transmission de ces notions des éléments actualisés, à la pointe de la recherche dans ce domaine.
Mais la Cliothèque ne se limite pas à fournir des prescriptions aux enseignants du second degré. Bien des chercheurs, des universitaires, constituent notre lectorat. C’est évidemment largement souhaitable, d’autant plus que les questions de sécurité et de défense vont très au-delà de nos activités enseignantes, mais concernent l’ensemble de nos concitoyens.
La question des entreprises de services de sécurité de défense touche très directement au rôle et à l’évolution de l’État dans l’exercice de ses attributs de souveraineté. Le grand public a découvert l’existence de ces sociétés de sécurité privée, lors de la guerre en Irak. Leurs effectifs étaient probablement plus importants que ceux de l’armée américaine déployée sur le terrain.
Dans le cas de la France, dans ce domaine, comme dans d’autres, le sujet des ESSD est évidemment sensible. Officiellement, la France serait opposée au principe même de ces sociétés militaires privées, même si, dans le domaine maritime, et pour assurer la sécurité de la navigation au large de l’Afrique orientale, une évolution a pu être observée. Les sociétés de sécurité maritime sont désormais autorisées, dans un cadre légal. Pour autant, le retard pris par les entreprises françaises dans ce domaine a peu de chances d’être comblé. Les anglo-saxons ont pris de l’avance dans ce domaine, ce qui ne les empêche pas d’ailleurs de recruter en France une partie de leur personnel, une des conséquences indirectes de la réduction des effectifs au sein de l’armée française.
Le rédacteur en chef de la revue, Georges – Henri Bricet des Vallons, a des mots très durs sur les approximations françaises dans le domaine des ESSD, et même par l’absence cruelle d’expertise au sommet de l’État sur ces questions. L’espèce de flou artistique qui semble prévaloir en France dans ce domaine a permis à des entreprises anglo-saxonnes de s’emparer de ce marché particulièrement porteur, et que l’on pourrait considérer, de façon un peu cynique, comme un secteur d’emplois de services non délocalisables.
D’après l’auteur, le développement des ESSD, participerait d’une extension de la politique étrangère de l’État. Cela ne se traduit pas seulement par l’envoi de mercenaires dans des zones à risques, même si cela fait parti de la réalité des ESSD, mais participe clairement de la diplomatie économique. Il semblerait que l’actuel ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, est pris conscience de ses enjeux, avec la direction de l’économie des entreprises internationales, comme sous-direction du Quai d’Orsay. Les ESSD, toujours d’après l’auteur, peuvent contribuer au dynamisme de la France sur les marchés des pays à risque dans le cadre des nation building.
Les causes du retard français dans ce domaine sont multiples
Les a priori idéologiques, contre les mercenaires ou « les chiens de guerre » en font partie, de même que la sociologie politique des cadres supérieurs de l’armée française, trop souvent issus d’un «entre soi» qui se reproduit, et qui n’a pas forcément pris conscience des enjeux économiques de la sécurité et de la défense. La frilosité des banques pour l’investissement extérieur en fait partie également, de même que la taille des structures déjà existantes qui sont pour l’instant des PME qui ne peuvent jouer dans la même cour que les groupes anglo-saxons.
Pour autant, ces groupes anglo-saxons ne sont pas exempts de critiques. Les dérapages financiers, les erreurs dont certaines ont pu être tragiques, particulièrement en Irak, ont sans doute expliqué les réticences françaises. Mais ces erreurs ont permis aux entreprises anglo-saxonnes de se fédérer et de se structurer, de définir leur posture, et au final, de s’imposer sur ce marché.
Le tabou qui existe en France sur ce que l’on appelle les sociétés militaires privées, n’empêche pas le ministère de la défense d’externaliser une partie de ses activités, mais au coup par coup, et sans véritable transparence.
Dans un très long article, Eric Delbecque, qui dirige actuellement le département sécurité économique de l’institut national des hautes études de la sécurité de la justice, insiste sur le renouvellement de la réflexion sur la sécurité et notamment sur les acteurs qui l’assurent. Le choix est clair, il est d’ailleurs présenté en introduction par Alain Bauer, soit la puissance publique assume, sur une multitude de terrains, l’ensemble des missions de sécurité, de la protection statique à la défense active, soit elle met en œuvre une régulation de l’initiative privée dans ce domaine, qui lui permet de conserver l’exercice de la souveraineté.
En période de restrictions budgétaires, mais avec un budget global de la défense contraint, limité à 33,4 milliards d’euros, il est clair que l’État ne peut pas faire face a toutes les demandes dans ce domaine. La question du recours au privé se pose, et elle apparaît comme une nécessité impérieuse. De plus les clients dans ce domaine réagissent sous le coup d’une nécessité. Très concrètement, il se mettent en quête d’une entreprise de services répondant à leurs besoins. Elle pourrait être française, elle est le plus souvent d’origine anglo-saxonne.
Un modèle de collaboration entre le secteur public, c’est-à-dire l’armée française et le secteur privé des ESSD est donc à construire
Philippe Chapleau, journaliste au service politique du quotidien Ouest-France et animateur du blog « ligne de défense » relève que l’externalisation est la grande absente du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Cette posture relève selon lui d’un parti pris idéologique. Dans le même temps il relève que l’utilisation des sociétés de sécurité privée et l’externalisation en général est pratiquée quotidiennement au ministère de la défense.
Pour ce journaliste, le constat est sans appel : la crise budgétaire, les incompressibles besoins nationaux en matière de santé, d’éducation et d’infrastructures, continueront de légitimer le grignotage de l’enveloppe budgétaire attribuée à la défense. Il est difficilement envisageable pour les armées françaises de continuer à vouloir assumer toutes les missions d’opérations extérieures, sans compter le maintien de plus en plus coûteux d’une force de dissuasion avec ses deux vecteurs, aériens et sous-marins, sans poursuivre une externalisation de fait. Mais encore faut-il que ce choix soit clairement assumé, ce qui ne semble pas être le cas.
Pour ce journaliste ce sont des clichés qui perdurent qui sont à l’origine de l’absence de clarté de la France dans ce domaine. Le 12 septembre 2013 le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, s’est déclaré favorable à la reconnaissance des sociétés militaires privées dans le domaine du transport maritime, mais opposé à celles-ci dans le domaine terrestre, car cela « s’apparenterait à du mercenariat, contraire à notre tradition républicaine. »
D’après Philippe Chapleau, cette posture idéologique ignore l’histoire, et il rappelle que le mercenariat est une norme militaire, qu’il s’inscrit dans une relation triangulaire qui associe un donneur d’ordre, l’État, un entrepreneur et un exécutant. Le mercenariat se développe dans les périodes où les États sont en manque de moyens financiers, humains et matériels pour assurer leur défense et celle de leurs intérêts. Le mercenariat relève d’une activité marchande, et donc d’une délégation de service, comme il peut en exister dans d’autres secteurs économiques.
Le cliché de la déviance anglo-saxonne semble également avoir la vie dure. En 2004, en Irak, lors des combats de Falloudjah, des employés de la société militaire privée Blackwater, ont été tués. Ils assuraient les missions de protection, de déminage et de soutien au profit des forces américaines déployées en Irak. Malgré ces dérapages, le principe de réalité semble l’avoir emporté et jusqu’en 2014 semble-t-il, au fur et à mesure des opérations de retrait des forces armées des théâtres d’opérations irakien et afghan, le recours à des prestataires de services sécuritaires ou militaires n’a cessé d’augmenter.
La réponse française, toujours d’après Philippe Chapleau ne semble pas avoir été à la hauteur des enjeux.
La segmentation entre activités de protection du transport maritime et sécurité à terre semble perdurer.
La définition d’un périmètre précis entre ce qui relève de l’État et ce qui peut être confié au secteur privé, ne semble pas avoir été établi. Dans le domaine du renseignement des prestations sont déjà confiées ponctuellement à des entreprises privées. Il semble que cela était le cas au Mali et en République Centre Africaine.
L’externalisation ne doit pas simplement rechercher l’économie immédiate. Celle-ci existe pourtant elle correspond d’abord à une volonté de pallier la vétusté des équipements. L’exemple donné est celui de l’école d’application de l’aviation légère de l’armée de terre qui a fait appel à des hélicoptères plus récents que les vieilles Gazelles pour former les pilotes.
Enfin, certaines données qui sont citées dans cet article donnent à réfléchir. Le néologisme qui a été créé pour l’occasion : « civilianiser », signifie le transfert de civils de la défense vers des postes tenues par les militaires. Il s’agit en fait de « boucher les trous » laissés par les diminutions d’effectifs des armées.
Certaines affirmations contenues dans cet article paraissent sujettes à caution. Un personnel civil serait plus présent, (1600 heures annuelles, contre 1000 pour un militaire), il serait également moins cher de 40 % pour la catégorie A de la fonction publique par rapport à un officier.
On peut s’interroger avec quelques exemples tirés de la réalité du terrain. L’appel des personnels civils, dans des domaines aussi simples que la restauration, c’est-à-dire l’ordinaire en termes militaires, nuit à la flexibilité et au final à la qualité de vie des militaires en cours d’entraînement. Avec des horaires particulièrement rigides, combien de soldats de retour du champ de manœuvre se sont retrouvés face a un ordinaire aux portes closes ? Le micro-onde dans la chambrée devient alors la solution de repli !
Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE, revient sur la loi de 2003 qui concerne l’utilisation par les entreprises françaises implantées dans des zones à risques des sociétés de sécurité. Dans la pratique, la loi, toujours d’après l’auteur, interdit l’utilisation de sociétés de sécurité françaises, ce qui amène les entreprises nationales situées dans les zones à risques à faire appel à des prestataires étrangers. Dans cet article l’auteur rappelle la guerre qui se déroule à l’est de la république démocratique du Congo en montrant qu’il ne s’agit pas d’un conflit tribal entre les Hutus et les Tutsis mais d’une action menée à partir d’un pays voisin pour défendre les intérêts de compagnies minières occidentales désireuses de s’assurer la maîtrise des gisements de coltan.
Alain Juillet développe donc dans cet article un plaidoyer en faveur de la création de groupes nationaux de sécurité qui présenterait plusieurs avantages. D’une part, mais on peut s’interroger sur les chiffres, ce secteur représenterait un volume d’emplois estimé à 180 000 personnes et un chiffre d’affaires de 200 à 400 milliards de dollars. La France pour y prendre sa part. D’autre part ce secteur permettrait d’assurer la reconversion des militaires. On sait déjà la forte reconnaissance des militaires français issus des forces spéciales et des troupes aéroportées et des légionnaires par les sociétés de sécurité privée. La question que pose l’auteur est très simple, elle semble frappée au coin du bon sens : « il faudra bien un jour se poser la question de savoir pourquoi nous sommes le seul grand pays ne pas reconnaître et utiliser les capacités de militaire formé chez nous ».
Les deux autres articles, de Guillaume Fonouni Farde et de Julien Canin s’inscrivent dans la même logique. Ils développent une argumentation en faveur de la création d’un cadre législatif clair ouvrant la porte à des partenariat public-privés dans le domaine de la sécurité et de la défense. Pour diverses raisons, historiques tout d’abord, avec l’héritage de la France-Afrique et des groupes de mercenaires dans la version Bob Denard, la France fait preuve d’une certaine frilosité dans ce domaine. Le partenariat public-privé, dans le domaine de la santé, avec la construction d’un immense hôpital qui rappelle les éléphants blancs, n’a pas véritablement bonne presse. Par ailleurs, et toujours pour des raisons historiques, la culture colbertiste de l’État français constitue un obstacle au développement de ces partenariats. Pourtant, l’héritage administratif français, avec ses capacités de contrôle, pourrait constituer un atout, éviter les dérives que les entreprises anglo-saxonnes ont pu connaître. Le recrutement d’agents de sécurité dans des pays pauvres, leur utilisation, avec une formation sommaire, dans des zones à risques, la très mauvaise qualité de l’encadrement, ont été à l’origine d’incidents particulièrement graves, et de dommages collatéraux importants.
Dans le domaine de la sécurité de la défense, les postures idéologiques peuvent se révéler contre-productives dans le domaine de l’emploi et du développement économique. Dans un monde qui apparaît incertain la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens est devenue impérieuse. Toute la question est de savoir, si l’on est capable de maîtriser les évolutions indispensables, par des instruments de régulation, si l’on préfère tourner la tête de l’autre côté et laisser à d’autres la décision.
Peut-être que la réflexion qui est contenue dans ces différents articles s’inscrit dans une démarche de lobbying en faveur du développement d’entreprises de services de sécurité et de défense. Mais cela ne change rien au problème de fond, faut-il ou non développer un secteur national dans ce domaine ou assister impuissant à son développement chez nos partenaires et concurrents ?
Parmi les autres articles de ce numéro de la revue Sécurité «globale», nous noterons, pour la première fois dans l’histoire de la revue des publications en anglais. Si la langue de Shakespeare est très largement connue et pratiquée par les lecteurs de cette revue spécialisée, ce choix de l’adaptation peut poser question dans une période où la francophonie est également un atout de développement. Mais cela n’enlève rien à l’intérêt de ces deux articles, le premier consacré à la féminisation du terrorisme, tandis que le second s’interroge sur l’évolution de l’Afghanistan après 2014.
D’après l’auteur, Brij Kindaria, ce pays a toutes les chances de devenir une sorte de hub du terrorisme, même si, d’après les dernières élections, un potentiel démocratique semble exister. On peut toutefois s’interroger sur les possibilités de voir se développer un état de droit dans un pays qui produit plus de 90 % de l’héroïne consommée dans le monde.













