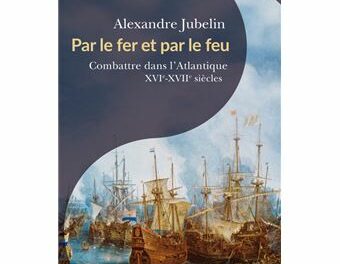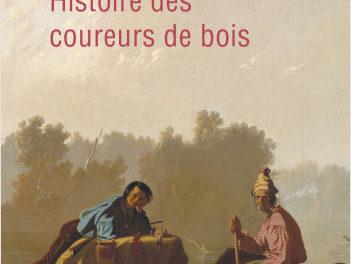Grand moderniste, Denis Richet ( 1927-1989) est surtout connu en dehors des milieux universitaires pour avoir publié avec François Furet, en 1965, une « Révolution française » qui en renouvela l’historiographie et provoqua de grands débats. Sans forcer le trait, on pourrait dire que de même que François Furet cherchait à « penser la Révolution française », de même Denis Richet chercha à penser la France moderne (terme qu’il préférait à Ancien Régime ), à en analyser les principaux ressorts institutionnels et sociaux. Publié en 1973, l’ouvrage porte la marque des débats de son époque entre historiens des institutions et historiens marxistes. Toutefois, comme le souligne Françoise Hidesheimer dans sa préface, l’ouvrage dépasse et domine les débats ( historiographiques ) pour constituer une formidable leçon d’histoire. En effet, Denis Richet montre comment les institutions de la monarchie absolue servent de cadre à la société et la modèlent profondément.
Certains groupes sociaux ( la grande noblesse, les officiers royaux, les serviteurs de l’Etat) en sont les grands bénéficiaires et parfois les acteurs. D’autres, en particulier le « peuple de humbles » ,les paysans écrasés d’impôts en sont les victimes, parfois révoltés. L’auteur ne néglige pas non plus la dimension religieuse de l’époque, ni les critiques et les révoltes contre l’absolutisme.
L’ouvrage comporte trois parties : les fondements du système, la pratique du système, la crise du système. Il peut être utile pour les candidats aux concours, mais aussi dans le cadre d’une préparation des chapitres du nouveau programme de Seconde consacrés à l’absolutisme et à sa remise ne cause à l’époque des Lumières.
Les fondements du système
A partir du XIIe siècle, la législation royale s’affirme. Le roi établit de règles impliquant durée et stabilité. Le pouvoir de faire des lois devient l’attribut essentiel de la souveraineté monarchique. Ce pouvoir se renforce à partir du XVe siècle. Les officiers royaux, les juristes comme Jean Bodin donnent un cadre et une justification à la souveraineté royale. Le roi conserve ses attributs traditionnels : la défense du royaume, le suzerain des suzerain, le pouvoir dérivé de l’ imperium romain, le roi très chrétien et thaumaturge, le roi populaire symbolisé par la figure de l’« Hercule gaulois ou du descendant des Troyens » au XVIe siècle. Mais il apparaît de plus en plus comme la source de la loi, celui qui détient seul et sans partage la souveraineté et se trouve délié des lois ( c’est le sens du mot « absolu »).
Cependant, le roi respecte ses propres lois. Surtout, les lois fondamentales du royaume (règles de succession dynastiques ,et inaliénabilité du domaine royal) limitent la toute puissance du roi, mais ne peuvent être considérées comme l’ébauche d’un Constitution. L’affirmation du pouvoir royal traduit une sécularisation et une nationalisation de l’Etat. Formellement, l’expression de la volonté royale peut prendre plusieurs formes : ordonnances qui ont un caractère général comme l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui crée ,entre autres,un état -civil. A partir de 1661, les ordonnances mises en œuvre par Colbert cherchent à codifier un domaine particulier : le commerce, l’ordonnance coloniale ou code noir de 1685. Au XVIIIe siècle, les ordonnances cherchent à la fois à codifier et à moderniser. C’est le cas des ordonnances de Turgot sur la liberté du commerce des grains ou des textes de 1780 et 1788 qui suppriment la « question », la torture. A côté des ordonnances, on trouve les édits qui portent sur des domaines plus particuliers comme l’édit de1787 qui accorde un état-civil aux protestants. A ces textes s’ajoutaient les lettres closes ou lettres de cachet qui contenaient des instructions diplomatiques ou secrètes, ou concernaient une personne (les lettres de cachet relatives aux arrestations arbitraires n’en constituaient qu’un petite partie) et surtout les arrêts du Conseil (800 000 actes entre Henri IV et Lois XVI) qui n’avaient pas besoin du sceau royal ou de l’enregistrement par les Parlements, qui donnaient des instructions ou tranchaient des recours juridiques. Une ordonnance ne pouvait être appliquée qu’après avoir été enregistrée au parlement. En cas de désaccord, le parlement pouvait présenter au roi des remontrances. Si le roi souhaitait malgré tout faire enregistrer l’ordonnance, il recourait aux lettres de jussion , puis au lit de justice. Il ne s’agissait en aucun cas de partager le pouvoir législatif. En 1766, lors de la séance dite de la flagellation, Louis XV rappelait encore aux parlementaires qu’il détenait seul le pouvoir législatif.
La pratique du système
Le trait dominant fut l’accroissement de l’autorité royale et de l’efficacité de l’Etat. Cette évolution fut loin d’être linéaire et l’on distingue des périodes de crise (les guerres de Religion, les régences) et des périodes de renforcement de l’autorité étatique (le ministériat de Richelieu, le règne de Louis XIV). Aux yeux de Denis Richet, le « grand tournant » eut lieu sous le ministériat de Richelieu en 1630. Jusqu’alors la monarchie avait le choix entre une politique de paix avec les Habsbourg (c’était le choix du parti dévot) qui n’aurait pas accru la pression fiscale et une politique guerrière qui supposait l’écrasement fiscal des paysans. C’est cette politique qui fut choisie : elle aggrava la pression fiscale qui passa de de 6 à 13% et accrut le contrôle administratif et fiscal qui pesait sur la population, notamment par l’augmentation du nombre d’agents royaux. Cette politique profitait à tous ceux qui vivaient des prélèvements fiscaux et de la rente foncière, octroyée par la monarchie, soit à la noblesse de cour qui bénéficiait de domaines et de pensions soit aux serviteurs de l’Etat, les robins. Comme on le sait, cette ascension sociale n’était pas une ascension individuelle (même si l’action de certaines grandes figures comme le chancelier Séguier ne doit pas être négligée), mais une ascension de familles, de lignage, comme le montre l’ascension sociale de Colbert ou du chancelier Séguier. Parmi les robins, on distinguait les officiers et les commissaires. Les officiers achetaient leurs charges et pouvaient la vendre ou la transmettre à leurs descendants (c’est l’ édit de 1604 ou « Paulette »). Les officiers étaient soit des officiers de justice (les parlementaires) soit des officiers de finance (les trésoriers généraux des finances). Les offices étaient eux-mêmes plus ou moins importants. Les officiers étaient de solides soutiens de la monarchie. A côté des officiers, se trouvaient les commissaires, nommés et révoqués par le roi pour accomplir une tâche particulière, les plus connus étant les intendants qui remplacèrent les officiers de finances, mais dont il ne faut pas surestimer le pouvoir. On opposait autrefois officiers et commissaires. Aux yeux de Denis Richet, cette opposition n’est pas réellement fondée, officiers et commissaires étant tous deux issus des milieux juridiques des robins.
Au cœur du système se trouvaient ceux qui participaient aux conseils d’administration et de gouvernement du royaume. Sous le règne de Louis XIV, le chancelier, le contrôleur général des finances, charge créée pour Colbert en 1665, et les quatre secrétaires d’Etat (Affaires extérieures, Guerre, Marine et Maison du Roi) jouaient un rôle essentiel. En théorie, le Conseil du Roi présidé par le souverain, était unique mais la complexité des tâches conduisit à le diviser en plusieurs ensembles : Conseil d’en-haut, Conseil des Dépêches, Conseil royal des finances etc… A ces conseils, s’ajoutaient des comités de ministres, sans doute inspirés de l’exemple anglais qui siégeaient en dehors de la présence du roi. L’administration royale donna naissance à un personnel spécialisé et stable, les conseillers d’Etat et les maîtres de requêtes. Les décisions royales étaient transmises dans les provinces par de nombreuses « courroies de transmission ». La monarchie eut tendance à superposer plusieurs instituions : prévôts, baillis, parlementaires, intendants.
Dans un monde fondé sur le privilège des corps, des communautés participaient à la puissance publique. Il s’agissait des Etats généraux, de l’assemblée du Clergé, des corps représentant une ville. Participants et gouvernants ne constituaient cependant qu’une minorité et la monarchie dut faire face à des révoltes telles que les révoltes antifiscales (Croquants du Sud-Ouest en 1636 -1637, ou les Nus- Pieds de Basse-Normandie en 1639-1642). Ce « grand refus des humbles », se traduisit également par des rituels d’inversion sociale (carnavals, sorcellerie) dont le mouvement sans-culotte fut un prolongement. Dans les villes les vagabonds chassés des campagnes par les mauvaises récoltes trouvaient un refuge dans les « cours des miracles » où ils côtoyaient des bandes organisées de brigands. La dernière cour des miracles fut fermée par Louis XIV en 1656 lors du « grand renfermement des pauvres » dans les hôpitaux généraux non sans provoquer des révoltes.
La crise du système
L’Etat monarchique ne fut pas à l’abri des critiques et des révoltes et cette critique peut paraître intrinsèque au système. Au XVIe siècle, les Protestants, tout en affirmant leur fidélité au roi, refusèrent le paiement de la dîme. Après le massacre de la Saint-Barthélémy, des juristes protestants développèrent des réflexions sur le contrat qui devait unir le roi et son peuple et évoquèrent le tyrannicide. Toutefois, ce furent surtout quelques pamphlétaires ligueurs qui se montrèrent les plus radicaux et justifièrent le tyrannicide au nom de la défense du catholicisme. Au XVIIe siècle Denis Richet ne voit dans la Fronde qu’une « maladie infantile » du système. A ses yeux, la contestation demeura modérée et peu structurée et visa surtout Mazarin, sans remettre en cause le pouvoir royal. La situation changea à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Les critiques s’inscrivent dans un vaste courant scientifique philosophique et politique qui concernait à la fois la science (passage du monde clos à l’univers infini et mathématisable). Descartes avait refusé d’examiner à la lumière de la raison les questions religieuses et politiques (les Cartésiens furent persécutés pendant le règne de Louis XIV), mais ses successeurs soumirent les questions politiques à la critique de la raison. De même, le jansénisme de Pascal comportait des éléments de critique du pouvoir monarchique. Il en allait de même avec des philosophes comme Spinoza, Locke ou Pierre Bayle qui dénonçaient le despotisme et valorisaient des régimes politiques fondés sur le contrat. En France, la contestation nobiliaire de l’absolutisme passa par un retour à l’histoire de France, en particulier par un intérêt pour la conquête franque, perçue comme un moment de l’égalité entre nobles. « De l’esprit des lois » (1748) joua un rôle décisif. Sa typologie des gouvernements élaborée par Montesquieu (république, monarchie, despotisme), sa critique du despotisme, son plaidoyer en faveur de tout ce qui peut limiter et modérer le pouvoir jouèrent un rôle important et jetèrent les bases du libéralisme. L’« Esprit des lois » ouvrit la voie à une assimilation de la monarchie au despotisme et à un plaidoyer en faveur du contrôle du pouvoir royal par les élites propriétaires. C’était le cœur du libéralisme des Lumières. L’opposition des Parlementaires qui souhaitaient contrôler les lois et les impôts et considéraient qu’ils représentaient le peuple face à la toute-puissance de l’absolutisme en est un bon exemple. Tout en réaffirmant les principes de l’absolutisme ou en tentant de réduire le pouvoir du Parlement (réforme de Maupéou en 1771), le régime était sur la défensive face au aspirations libérales. Les tentatives de réforme de Calonne et surtout de Loménie de Brienne en 1787-1788 n’aboutirent pas. Denis Richet considère que le ministère de Loménie de Brienne « fut sans doute le plus grand ministère du XVIIIe siècle ». En juin1787, il créait une pyramide d’assemblées provinciales qui maintenaient la structure des ordres, mais accordait le doublement au Tiers Etat, en confiant à ces assemblées la répartition et la perception des impôts. Le roi aurait perdu ainsi l’une des ses prérogatives. De plus, les assemblées provinciales auraient pu servir de base à la formation d’une Assemblée nationale.
Malheureusement le projet échoua du fait de l’opposition, dans le domaine militaire, de la noblesse provinciale qui pouvait accéder plus difficilement que la noblesse de cour au grade de colonel. Les Parlements apparaissaient comme ceux qui pouvaient limiter le pouvoir absolu. C’est aussi le moment où naît une opposition entre le « parti aristocrate », libéral, favorable à l’abandon des privilèges fiscaux de la noblesse et à la liberté de la presse, mais attaché également aux prérogatives de la noblesse et du clergé ,et le « parti national »hostile aux privilèges. Comme l’écrivait Mirabeau : « les privilèges sont utiles contre les rois, mais détestables contre les nations ». Ces prises de position n’étaient pas égalitaires. Elles concernaient la participation à la vie publique des propriétaires : fallait -il réserver cet accès à la noblesse ou l’étendre à tous les propriétaires ? En mai 1789, quand s’ouvrent les Etats généraux, la victoire contre l’absolutisme était plus qu’à moitié remportée. Mais cette victoire s’accompagnait du réveil d’autres forces longtemps exclues : les paysans, le peuple des villes. En fin de compte, la crise de l’absolutisme fit des vaincus (les élites administratives qui prirent leur revanche sous l’ Empire et la monarchie censitaire, et la noblesse provinciale qui aurait pu bénéficier des réformes de Loménie de Brienne), et des vainqueurs, les élites nobles et roturières des villes qui ne supportaient plus d’être cantonnées dans la passivité politique. Elle marqua l’émergence dans la vie politique d’une partie du peuple qu’il s’agisse des sans-culotte, des paysans pauvres du Sud-Ouest ou des Chouans.