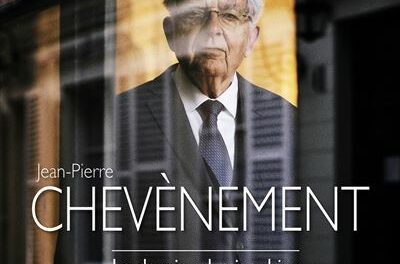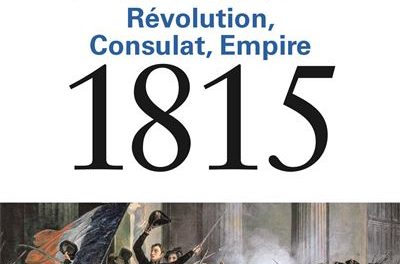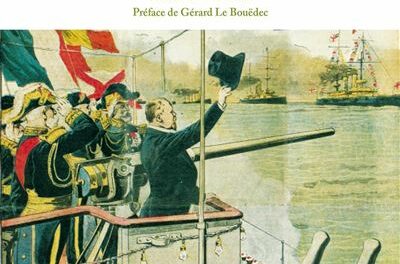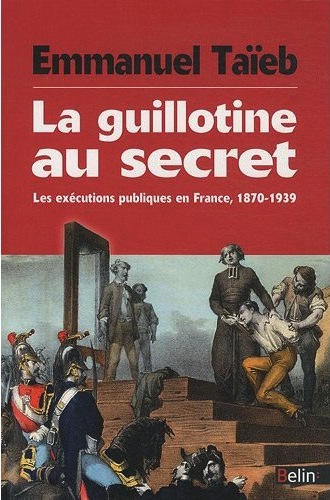
Un double patronage fécond
Quant au second, il propose une vision du retrait de la violence publique comme expression d’un abaissement du seuil de tolérance à la violence dans la société française. Emmanuel Taïeb en fournit une illustration pertinente en montrant comment, sans que se structurent les mêmes courants et enjeux que dans le cadre de la suppression de la peine de mort, la suppression de leur publicité en est une étape essentielle ; cela ne la supprime évidemment pas car les enjeux sont différents sur le rapport à la peine elle-même. Au passage Emmanuel Taïeb tient des propose éclairants sur le concept de « brutalisation » en mettant en regard les travaux de Georges Mosse et Norbert Elias avec ceux d’Antoine Prost et Nicolas Mariot sur les ruptures et continuité entre violence civile et violence de guerre [p. 82-86].
Deux sociologies très fécondes donc dans l’élaboration théorique, mais plus difficile à mettre en œuvre sur un plan pratique tant elles appellent une grande maîtrise des cadres intellectuels des pratiques. Emmanuel Taïeb parvient sur son objet plutôt restreint mais hautement symbolique et significatif à proposer une analyse dense et convaincante, s’appuyant sur une analyse fine des configurations des exécutions. Il établit un pont entre les deux approches, montrant dans cette configuration historique que les deux impulsions sont complémentaires : du haut vers le bas car l’État n’a plus besoin d’afficher sa violence, du bas vers le haut car la population ne souhaite plus être spectatrice de cette violence.
Emmanuel Taïeb opère à cette réconciliation en développant la dimension historique du processus par lequel se fait la « réduction rituelle » de la mise en scène de l’exécution [p. 23].
Une solide analyse historique
Emmanuel Taïeb est allé chercher dans les archives l’histoire du dispositif exécutionnaire. Il rend compte des exécutions bien sûr mais également de tout le rituel qu’elles occasionnent. Cela donne des analyses très fines de la place de l’exécution dans l’espace public, dans le choix du lieu d’exécution notamment [chapitre 3]. On peut ainsi retenir que le lieu de l’exécution choisi par la municipalité sous contrôle du procureur change – très souvent – car le lieu n’est pas, et ne doit pas devenir un « lieu de mémoire » [p. 100]. Emmanuel Taïeb retrace le « parcours » de la guillotine « portative » à Lyon et à Paris surtout, mais également dans près d’une centaine de ville, remarquant que tendanciellement l’espace de l’exécution se rapproche de l’espace de la prison, abandonne progressivement le lieu du crime (tout en restant dans la ville du crime) mais surtout ne correspond pas spécifiquement à un lieu investi par le pouvoir politique, un lieu périphérique dans l’espace urbain. Il faut de plus utiliser un lieu ouvert ayant une visibilité que l’on va chercher à contrôler, places de marché et places de foire sont privilégiées qui peuvent facilement rendues à leur trivialité. L’« arraisonnement pénitentiaire » semble finalement convenir car elle donne aux édiles une solution au problème de l’emplacement de l’exécution, de sa sécurisation et de la diminution de la publicité de l’exécution.
L’exécution comme spectacle
L’exécution fait l’objet de toute une littérature journalistique « à un sou » dont le premier objectif est l’imposition du journalisme comme mode de publicisation des exécutions contre l’obligation légale depublicisation qui est faite aux pouvoirs publics. La discrétion croissante de l’État contraste avec celle de la presse qui au contraire décrit l’ensemble du dispositif qui voit la justice prendre possession d’une partie de l’espace public pour y installer le dispositif d’exécution, depuis l’arrivée du bourreau jusqu’au démontage de la guillotine et de ceux qui l’actionnent. Car l’évènement de l’exécution elle-même, dans tout son cérémonial (et sa lenteur) s’accompagne d’une mise en conformité de l’espace qui le sort de sa « normalité » pour essayer de l’y replonger ensuite. Le récit journalistique par son intensité tend à anéantir cet effort.
Dès l’affaire Troppmann, le « moment Troppmann » (1870), sont codifiées des pratiques qui vont durablement s’installer. D’abord dans la description de l’horreur du crime : Troppmann assassina la famille Kinck avec laquelle il entretenait une relation intime, presque filiale, devenant l’image même du « monstre, capable de tuer de sang-froid sans regret ni repentir » [p. 53] L’individu devient lui-même une référence pour la définition du criminel, produisant une mémoire spécifique et durable dont l’exécution participe. Troppmann va ainsi « fixer » des pratiques journalistiques et des représentations sur le criminel, sur la masse et son comportement (critique de la « foire », du « folklore » qui entoure l’exécution, avec vente de souvenirs dans un cadre festif), potentiellement incontrôlable. La présence du public devient problématique car elle correspond pas à la logique d’édification des foules attendue par les élites – l’interprétation des applaudissements populaires est à ce titre emblématique et problématique [p. 57], tant ils rompent avec le recueillement de circonstance.
Car le spectacle de l’exécution est un moment de réflexion sur la peine en même temps qu’un moment où le public éprouve son courage devant le châtiment, dans une dimension martiale [p. 86]. L’exécution est une épreuve pour le condamné qui doit s’en montrer digne – d’autant plus si le condamné a été soldat –, et pour le spectateur qui doit faire face à l’exécution comme une expérience prouvant la valeur personnelle du spectateur, notamment dans les classes supérieures [p. 87 et 205 sq.], voire en faisant preuve d’une forme de honte vis-à-vis du condamné, non par empathie mais pour marquer la désapprobation face à l’exécution. La fragilité du condamné est jugée négativement, comme dans le cas de Sante Casério, assassin du Président de la République Sadi Carnot, dont la lâcheté devant la guillotine redouble la lâcheté du geste [p. 89 sq.].
Dans leur dispositif, les journaux vont ensuite reconduire l’exécution en la scindant entre article descriptif et article interprétatif [p. 42] ; ils remettent ainsi en scène le spectacle de la mort en même temps qu’ils prolongent le débat autour de la publicité qui très tôt dans la période étudiée se trouve mise en débat (1884). Mais ce récit s’épuise à la fin du XIXe siècle à force de se répéter, de s’enfermer dans le carcan de la pratique exécutionnaire qu’il décrit. Les crimes et les procédures prennent le pas sur l’exécution et cette dernière se trouve progressivement reléguée dans les pages intérieures des journées, pour des articles de moins en moins longs. On réfléchit alors à des subterfuges pour que la publicité ne passe plus par la monstration ou la description de l’exécution, mais par le recours à des témoignages officiels qui permettraient d’en écarter le peuple, la publicité étant ainsi donnée à voir « à distance » [p. 169]. Au delà des problèmes juridiques que cette possibilité soulève, elle signale une transformation fondamentale qui est celle de la médiatisation : il n’est plus nécessaire d’être spectateur, les médias de masse en assurent la fonction, « on ne va plus à l’exécution car le désir d’être spectateur s’étiole, et on veut que l’exécution vienne à soi » [p. 257].
L’exécution en débats
C’est sur la forme de l’exécution, la publicité elle-même que porte l’enjeu. En effet, la presse va se faire le relais du refus de la publicisation légale, car elle apparaît comme un spectacle malsain, scandaleux, indigne d’un peuple civilisé.
Le développement de la photographie est un élément supplémentaire du problème. Selon Albert Camus, ce sont les photographies de l’exécution de Weidmann en 1939 qui auraient porté un coup fatal à la publicité des exécutions [p. 63], mais Emmanuel Taïeb discute cette hypothèse en rappelant que pour les journaux il s’agit surtout d’écarter les pouvoirs publics de la publicité pour s’en assurer le monopole, et la radio critiquera la presse dans les mêmes termes que celle-ci avait employé contre l’État. Les journalistes défendent ainsi l’une des caractéristiques de leur profession en cours de construction : l’objectivité. Il prétendent jeter un œil dépassionné sur les faits, donc un récit maîtrisé de l’exécution qui se déroulerait au sein de la prison, soustraite au regard de la foule.
Cette volonté de retrait se heurte toutefois à une demande de maintien de la publicité du châtiment comme symbole de la lutte du régime contre le crime [chapitre 2]. Le rétentionnisme (maintien de la peine de mort) et sa publicité témoignent alors d’un conservatisme sur la place du châtiment corporel lui-même. Emmanuel Taïeb rappelle ainsi que dans une société où la peine de mort est la punition suprême, les autres châtiments peuvent sembler plus doux, donc plus acceptables [p. 69]. Le débat sur la publicité de l’exécution est donc la référence d’un débat beaucoup plus vaste sur le statut du châtiment. En 1908, le débat sur cette publicité se double de celui sur le rétablissement des « supplétifs à la peine capitale » comme par exemple le fouet qui aurait un effet dissuasif plus radical sur les criminels. Il convient alors de le codifier comme le Dr. Lejeune qui estime qu’il « ne faut pas provoquer de blessures graves, il ne faut pas frapper au visage, ni sur l’estomac ou l’abdomen, ni sur les membres, sauf sur « les muscles des mollets ou le gras des cuisses ». » [p. 72]. Ce débat qui se prolonge jusqu’à la Première Guerre mondiale rend bien compte d’un certain conservatisme pour lequel l’insensibilité à la souffrance du châtiment renvoie également à l’indifférence vis-à-vis de celui qui par sa marginalité se met en situation d’être châtié, et le mérite « pour son bien ». A travers le débat sur le châtiment, c’est le régime républicain lui-même qui devient la cible des attaques de ceux qui le trouve trop faible, par exemple lorsque Soleilland, violeur et tueur d’une enfant de 11 ans, est gracié en 1907. Ce moment d’émotion est habilement exploité pour figer le débat sur la peine de mort en mettant en scène l’opinion publique, car tous les camps politique font alors de la peine de mort le pilier d’un régime qui a besoin de montrer sa détermination.
Les débats sont également un miroir tendu à l’opinion. Ainsi à trois reprises le Sénat se prononce contre la publicité des exécutions (en 1884, 1885 et 1898) à la suite de pétitions. Mais à chaque fois la Chambre des députés s’y oppose, et c’est un décret-loi qui met un terme à la publicité en 1939, car la Chambre semble redouter que l’abandon de la publicité, et donc de l’exemplarité, ne soit l’antichambre de la suppression de la peine de mort elle-même (par exemple en 1894). Cela en dépit des troubles qui se manifestent et sont clairement signalés comme « scandales » problématiques dans la presse. Emmanuel Taïeb propose un tableau chronologique détaillé de l’alternance des propositions de suppression de la publicité et d’abolition qui montre comment les deux fonctionnent en alternance, en « relais », mais surtout montre que la question est un débat récurrent, voire continu sous la Troisième République. La publicité apparaît comme le maillon faible du débat, le coin qui peut être le plus facilement enfoncé car elle plus réprouvée que la peine de mort elle-même qui suscite des réactions bien plus ambivalentes.
Ces débats ne vont pas contre l’hypothèse d’une civilisation des mœurs mais montrent que le glissement progressif vers la dépublicisation connaît de fortes résistances car le problème n’est pas celui de la violence exercée, mais celui de la violence montrée. C’est la « théâtrocratie » politique qui est en fait en débat, et l’exécution n’est qu’un aspect de la différenciation qu’opère le XIXe siècle entre le propre qui peut être spectacle et le sale qui doit être dérobé au regard.