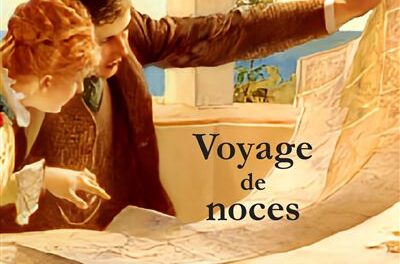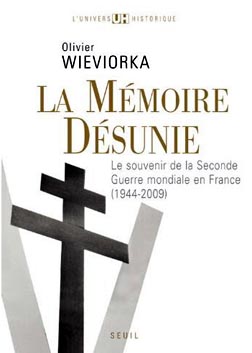
Les Français vécurent de 1940 à 1944 des situations très diverses : séjour dans un camp de prisonniers, rationnement, bombardements, travail forcé, résistance civile, combats dans les maquis déportation, etc. Cette diversité contraria l’émergence d’une mémoire commune. « Aucun discours, aucun lieu, aucun symbole ne peut, à lui seul, rendre compte de la pluralité des épreuves traversées par 40 millions de contemporains ». Chaque groupe tenta d’acquérir puis de préserver des droits mais aussi d’obtenir la reconnaissance symbolique de la nation. « La mémoire de la Seconde Guerre mondiale apparaît, hier comme aujourd’hui, comme une mémoire fragmentée, conflictuelle et politisée qui sépare plutôt qu’elle ne rassemble ». L’Etat fut un acteur majeur pour fixer les contours du souvenir, mais il ne fut pas le seul : associations, collectivités locales, historiens, journalistes, artistes y contribuèrent aussi.
Universitaire spécialisé dans l’histoire de la Résistance, Olivier Wieviorka propose avec cet ouvrage « une histoire politique de la mémoire française des années sombres ». Son objet est clairement identifié dans l’avant-propos : l’étude des politiques publiques menées depuis la Libération à propos de la mémoire des années d’occupation. L’histoire sociale ou culturelle de cette mémoire n’est donc pas l’objet direct du livre, même si elle est évoquée à de nombreuses reprises. Il adopte un plan chronologique que nous suivrons dans ce compte rendu.
Suturer les plaies et restaurer la confiance d’une nation divisée (1944-1946)
De Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République française présenta la Seconde Guerre mondiale comme une « Guerre de Trente ans », commencée en 1914 et terminée en 1945. Cette vision présentait un triple intérêt : elle désidéologisait le conflit, elle jetait un pont entre les combattants de 1940 et les Poilus de la Grande Guerre, elle permettait d’assimiler la France à une nation victorieuse. Le rôle des Alliés s’en trouvait minoré et l’Etat français nié. La Résistance pouvait être célébrée par des Français censés y avoir participé massivement.
La politique mémorielle du général de Gaulle exalte la mémoire combattante, exclut les civils, occulte les prisonniers, oublie les déportés juifs. Elle vise à rassembler, à suturer les plaies. De Gaulle impose ses symboles (la croix de Lorraine), son calendrier (le 18 juin), ses lieux (le Mont Valérien).
Cohérente, cette politique est combattue par le Parti communiste qui doit faire oublier la « ligne sinueuse » qui fut la sienne de 1939 à 1941 : celle d’un parti à la fois compromis puis héroïque. Le PCF construisit sa politique mémorielle autour de quatre axes : l’hommage aux martyrs communistes, l’enracinement de la résistance communiste dans les épisodes révolutionnaires des siècles passés, la négation des réalités compromettantes, la minoration du rôle joué par de Gaulle et pas les Alliés.
Les mémoires gaulliste et communiste se rejoignent sur un point : les Français furent une communauté héroïque. Les films tournés dans l’immédiat après-guerre ne démentent pas cette version, sans doute les Français ne souhaitaient-ils pas entendre des vérités déplaisantes.
Irénisme et tension – L’œuvre de la IVe République (1946 – 1958)
« La IVe République procède à un vaste effort législatif en créant ou complétant les statuts destinés à ouvrir aux victimes un droit à reconnaissance et un droit à réparation » : statut des « déportés et internés de la Résistance », statut des « internés et déportés politiques ». Une loi de 1949 précise la qualité de résistant et les moyens définis pour la faire reconnaître. La Résistance est principalement considérée sous l’angle militaire ; la résistance civile se trouve exclue de la reconnaissance publique de même que la spécificité du génocide juif.
Des associations se constituent : Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et déportés (FNPGD, 1945), l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR, 1952), plutôt communisante, que deux autres formations entendent concurrencer : l’Association nationale des combattants volontaires de la Résistance (ANCVR, 1953) et la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance (CNCVR, 1953). Leur multiplicité reflète leur division et les rend moins efficaces. Chez les déportés se constituent la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP, 1946) proche du PCF, la Fédération nationale des internés résistants (FNDIR, 1945), proche de la 3e Force et l’Association des déportées et internées de la Résistance (ADIR, 1945) qui regroupe les résistantes victimes de la répression.
Une loi de 1951 fixa le statut des travailleurs requis en Allemagne. Elle les fit bénéficier des dispositions appliquées aux déportés et internés politiques. Les associations de déportés s’opposèrent à l’utilisation du terme de déportés pour qualifier les requis. La Cour d’appel de Paris en 1978 puis la Cour de cassation en 1979 (et encore en 1992) interdirent que les requis se qualifient de déportés.
Le retour de la droite au pouvoir se traduisit par le vote des lois d’amnistie de 1951 et de 1953 qui vidèrent les prisons. La guerre froide amena des reclassements, rendant inopérant le clivage résistants /collaborateurs : désormais l’opposition communistes/non communistes structure en partie le débat politique, amenant certains résistants à se rapprocher d’anciens vichystes.
Le PCF évince de ses rangs des résistants historiques (Charles Tillon, Auguste Lecoeur, Georges Guingouin) coupables de « pouvoir mobiliser à leur profit une autre légitimité que l’action internationaliste délivrée par Moscou » et continue de se battre « sur le terrain du droit afin de faire admettre que le combat résistant avait débuté dès 1940 et non en juin 1941 ».
Les associations et parfois les communes, bien plus rarement l’Etat prennent en charge la politique de la mémoire en ouvrant les premiers musées, en apposant des plaques et des stèles, en érigeant les premiers monuments. Le premier monument dédié à la déportation, construit à Auxerre dans le département de l’Yonne, résulte d’une initiative locale en 1946 par le président de l’Association départementale des déportés et internés politiques de l’Yonne ; Vincent Auriol, chef de l’Etat préside le 3 avril 1949 à l’inauguration de ce groupe sculpté. Les plaques et stèles honorant les combattants de 1940 sont rares ; les soldats de la France libre sont mieux lotis mais ce sont les résistants morts au combat dans les maquis, déportés, fusillés ou massacrés qui sont les plus honorés. La déportation raciale demeure oubliée ; Buchenwald est alors le symbole de l’univers concentrationnaire.
La République gaullienne, un âge d’or (1958 – 1969) ?
Le pouvoir gaulliste se donne les moyens de mener une politique mémorielle et commémorative cohérente. Il lance une série de constructions : musée du débarquement de Provence au mont Faron, musée de l’Ordre de la Libération, mémorial du Struthof, mémorial de la Déportation sur l’île de la Cité. La singularité de la Shoah n’est toujours pas distinguée.
La conception traditionnelle de la Résistance réduite à un phénomène militaire et rassemblant l’ensemble des Français est réaffirmée ; de surcroît le pouvoir tend à assimiler la Résistance au gaullisme, c’est l’ambition qui anime la panthéonisation de Jean Moulin en 1964. cette politique n’est pas contestée par la mémoire savante : les ouvrages publiés dans la collection « Esprit de la Résistance » aux PUF sous la direction d’Henri Michel « se montrent peu critiques à l’égard des mythologies », la Seconde Guerre mondiale entre dans les programmes scolaires mais les ouvrages « pérennisent une approche convenue ». Seuls les communistes tentent d’imposer leur version de la Résistance en continuant d’affirmer qu’elle a commencé en 1940 et en minorant le rôle du général de Gaulle.
Par ailleurs le pouvoir gaulliste promeut une politique de réconciliation avec l’Allemagne, libère les derniers responsables de la solution finale en France (Oberg et Knochen sont libérés en 1962), multiplie les jumelages franco-allemands, obtient l’indemnisation des victimes du national-socialisme et fait adopter par le Parlement en 1964 l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité en 1964.
Le temps des bourrasques (1969-1981)
« La présidence de Georges Pompidou, puis le septennat de Valéry Giscard d’Estaing marquent une évolution de la politique mémorielle mise en œuvre par les pouvoirs publics. Loin de fixer un consensus, le souvenir des années sombres suscite conflits, polémiques et controverses ». Le pouvoir semble soucieux de faire oublier le souvenir de cette époque ; la société civile intervient et réclame que la vérité soit enfin dite sur Vichy et que la Shoah (on n’utilise pas encore le terme) ne soit plus rejetée aux confins de la conscience nationale.
Pompidou « conduit une politique schizophrène. En refusant de faire la lumière sur l’épisode vichyste (le pouvoir refuse aux chercheurs l’accès aux archives et interdit la diffusion télévisée du « Chagrin et la Pitié »), il poursuit au fond sur la lancée de son prédécesseur ; cependant, alors que Charles de Gaulle compensait le voile jeté sur l’Etat français par une exaltation de la Résistance, Georges Pompidou ne célèbre en rien les mérites de cette dernière, bien au contraire. L’opinion publique ne pouvait que s’étonner de ce déséquilibre, qui conduit in fine à désavouer la Résistance et à donner, à tort ou à raison, le sentiment que le pouvoir ménage les mânes de l’Etat français ». La grâce accordée à Paul Touvier (1972) suscite un émoi considérable. Alors que les thèses de Robert Aron présentant Vichy comme un « bouclier » face aux exigences allemandes régnaient encore largement, la publication par Robert Paxton en 1973 de « La France de Vichy » eut un impact d’autant plus grand que l’ouvrage fut chroniqué dans les grands journaux et nourrit une controverse dont les médias se firent l’écho. Il était prouvé désormais que la collaboration avait été demandée par les autorités françaises soucieuses de négocier une place dans l’Europe nazie et d’entreprendre la révolution nationale.
« Valéry Giscard d’Estaing mena, de fait, une politique mémorielle qui, par ses a priori, conforta les interrogations plus qu’elle ne les dissipa ». En décidant en 1975 de ne plus fêter officiellement le 8 Mai, il déclencha la colère du monde combattant mais il oeuvra en faveur des historiens en simplifiant, par la loi du 3 janvier 1979, l’accès aux archives. Les années 1970 furent celles du réveil de la mémoire juive (Serge Klarsfeld publia en 1978 le « Mémorial de la déportation des Juifs de France ») et de l’émergence publique du négationnisme (les déclarations de Louis Darquier à l’Express sont aussi de 1978). La figure du déporté juif tendit alors à dominer le souvenir de la déportation, Auschwitz succéda à Buchenwald pour incarner la réalité concentrationnaire.
Les ambivalences de l’ère Mitterrand (1981-1995)
Durant le double septennat de François Mitterrand, le souvenir se focalise sur l’Etat français et sur la Shoah qui acquièrent une place centrale. Les programmes scolaires insistent désormais sur l’étude de la France sous l’Occupation et sur l’histoire du génocide des juifs et la recherche se focalise sur ces deux thèmes. Les derniers criminels français ou allemands sont traqués et jugés (Barbie en 1987, Touvier en 1994, Papon en 1997). Le pouvoir encourage la création de musées et de mémoriaux ; plus de 110 musées sont construits entre 1980 et 1999 (Caen en 1987, Izieu en 1994, Le Vercors en 1994, Oradour en 1999). La déportation raciale s’inscrit désormais dans la mémoire publique. Le 17 juillet 1994, le monument commémoratif de la rafle du Vel’ d’Hiv est inauguré et nombre d’inscriptions commémoratives sont corrigées.
Tous ces éléments auraient dû contribuer à l’apaisement de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais tel ne fut pas le cas pour diverses raisons. En publiant « Une jeunesse française » (1994), Pierre Péan révéla le passé vichyste de François Mitterrand ainsi que son évolution vers la Résistance. En lui-même cet itinéraire qui fait de Mitterrand ce que Jean-Pierre Azéma appelle un vichysto-résistant, n’est pas original et les révélations ne sont d’ailleurs pas nouvelles. Mais elles n’étaient pas crues : « elles ne furent admises que quand l’opinion publique se montra disposée à les croire ».
François Mitterrand fut plus heureux dans sa politique mémorielle internationale. Il infléchit significativement les commémorations du Débarquement et en fixa le cadre qui aujourd’hui encore prévaut. La Résistance, malgré les musées qui lui furent consacrés se trouva placée sur la défensive par les polémiques organisées autour de l’action et de la personne de Jean Moulin et par des productions historiques qui en donnèrent une image plus complexe : « Les historiens opposaient aux simplismes de la mémoire des réalités plus complexes qui dérangeaient les pieux ordonnancements de la Libération (…) en explorant la zone grise à laquelle beaucoup de Français avaient appartenue ».
Une mémoire apaisée ? De Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy (de 1995 à nos jours)
« Sitôt élu, Jacques Chirac s’employa à lever l’hypothèque vichyste. Le 16 juillet 1995, le Président prononça les mots que beaucoup attendaient, en rappelant l’aide qu’avait apportée Vichy dans la déportation des juifs de France ». Ce discours ruinait la thèse gaulliste en affirmant que l’Etat français, dans une certaine mesure, incarnait la France. « En condamnant Maurice Papon à dix années de réclusion criminelle (2 avril 1998), la Cour d’assises de Gironde offrit un épilogue à cette guerre franco-française (…) Ni l’opinion, ni les pouvoirs publics ne considèrent plus à présent que Vichy ait joué le rôle de bouclier ».
La mission Mattéoli rendit en 2000 ses conclusions sur la nécessaire indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait de la législation antisémite de Vichy et recommanda la création d’une Fondation pour la mémoire de la Shoah qui fut installée en 2001 ; le mémorial de la Shoah fut inauguré en janvier 2005. Un décret de juillet 2000 indemnisa les orphelins de la Shoah. L’accent porté sur la Shoah suscita l’irritation des associations de résistants et de déportés non raciaux, ouvrant la « concurrence des victimes ». Les polémiques sur la Résistance redoublèrent et Lionel Jospin autorisa un large accès aux archives en 1997. En 2006 Jacques Chirac apura un dernier contentieux mémoriel en augmentant fortement les pensions des anciens combattants indigènes, à la suite de l’émotion suscitée par le film « Indigènes » de Rachid Bouchareb.
Nicolas Sarkozy s’employa d’abord à restaurer le prestige de la Résistance : il se rendit à plusieurs reprises sur le plateau des Glières, imposa la lecture de la lettre du jeune Guy Môquet aux lycéens et, dans un autre domaine, suggéra de confier à chaque élève de CM2 la mémoire d’un enfant juif déporté. Des raisons diverses expliquent cette politique, les unes idéologiques (la Résistance comme modèle de courage, de vitalité, d’ouverture politique), les autres politiques et politiciennes (moderniser l’idéologie de la droite, plonger la gauche dans l’embarras). Il dut assez vite reculer devant l’ampleur des polémiques.
L’ouvrage d’Olivier Wieviorka propose une claire synthèse de nombreux travaux historiques partiels inaccessibles au non spécialiste. Il ne remplace pas la lecture de l’ouvrage fondamental d’Henry Rousso, « Le syndrome de Vichy » mais il la complète et il sera très utile aux collègues soucieux d’approfondir ou de rajeunir leurs cours sur le chapitre d’histoire consacré dans le programme des classes de Terminales L et ES aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale.