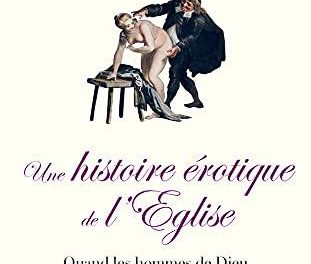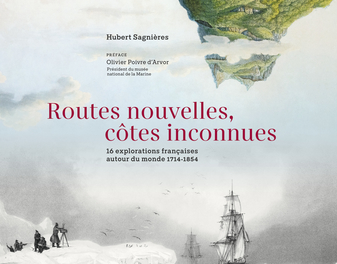Puissamment enraciné face au maître-autel dans la chapelle de la Sorbonne, hélas difficilement accessible au public, l’impérieux sarcophage du cardinal de Richelieu, sculpté par François Girardon, se mesure depuis quatre siècles à la puissance divine.
Cette somptueuse incarnation de l’art funéraire baroque pourrait laisser croire que l’épanouissement artistique du Grand Siècle, en se conjuguant à la dévotion spectaculaire nourrie par la Contre-Réforme, a fertilisé l’éclosion d’une multitude de monuments funéraires. Fausse évidence : en effet, les arbres spectaculaires de quelques tombes prestigieuses ne cachent qu’une assez maigre forêt. Loin de constituer une norme mortuaire ou une mode d’intercession de rigueur pour l’au-delà, ces tombeaux ostentatoires, en rupture avec le format originel de l’épitaphe, s’avèrent en fait des objets rares, et pas uniquement pour des raisons de coût. Élitistes à tous points de vue, ils témoignent d’une puissance symbolique et artistique, religieuse et sociale, dont Claire Mazel propose de redécouvrir la riche pluralité estompée, à travers une synthèse qui parle autant à l’Histoire de l’Art qu’à l’histoire sociale et l’histoire des représentations. Le parcours pourrait être austère : il est en fait passionnant. Célébrant les noces flamboyantes de l’art avec la piété, de la puissance avec la vanité, et de la mort avec la mémoire, l’art funéraire du Grand Siècle s’aventure en effet bien au-delà d’une simple anthropologie de la mort.
S’appuyant sur un corpus de 121 monuments funéraires bâtis du règne de Louis XIII à celui de Louis XIV, cette thèse soutenue en 2003 organise son propos de façon habilement régressive, en remontant de l’aval vers l’amont. Le regard porté sur cet art funéraire et les évolutions de sa perception d’hier à aujourd’hui en sont la première étape. La seconde envisage la grammaire des représentations funéraires et leur place dans l’économie du salut. La troisième se réfère aux enjeux politiques des monuments, en croisant pouvoir des images et images du pouvoir. Enfin le livre se clôt sur une évocation particulièrement stimulante de la place des artistes, et de la part de dépendance et d’autonomie créative qui caractérise leurs relations avec leurs commanditaires.
Du vandalisme à la muséification
Inversant donc la chronologie, Claire Mazel entame son propos par un tableau de l’évolution de la perception des oeuvres funéraires du Grand Siècle. Regards et attitudes évoluent sensiblement -et parfois répétitivement- de l’Ancien Régime à aujourd’hui, non sans perte significative de sens car, observe l’auteur, « la réception est une sorte de réduction sémantique« . De fait, le regard sur les monuments change notablement d’une période à l’autre. Dès l’Ancien Régime, précocement imprégné du goût du tourisme funéraire, l’approche des oeuvres prend un tour édifiant, critique ou pédagogique. Après 1789, la dimension idéologico-politique de ces signes visuels de l’ordre social aboli prend le dessus. Elle les mue en enjeu forcément révolutionnaire, à travers les problématiques du vandalisme et de la conservation (dont Claire Mazel souligne avec beaucoup de clarté et de pertinence les logiques en fait plus complémentaires qu’antagonistes), mais aussi contre-révolutionnaire, par la complainte de la déploration historique et de la profanation religieuse. Leur valeur politique persiste sous l’oeil des monarchies restaurées, pour lesquelles réhabilitation monumentale rime avec récupération. Un ultime glissement de la sensibilité à l’âge des républiques permet à la dimension artistique de prendre le dessus sur la fonction symbolique, même si un message démonstratif d’essence nationale demeure présent en filigrane à travers les jeux contemporains de l’esthétisation, de la patrimonialisation et de la muséification.
Le discours des formes
Confusion et évolution des réceptions reflètent aussi la pluralité des intentions originelles. Les parures de marbre et de cuivre sont autant d’éloges funèbres sculptés. En proposant un décryptage détaillé du répertoire iconographique employé, l’auteur dévoile combien la mise en scène funéraire relève du « geste de piété ou d’orgueil« . Elle s’applique à des objets d’autant plus exceptionnels qu’ils sont rares. Pour la plupart posthumes, parfois de plusieurs décennies, et d’exécution lente (huit ans en moyenne), les sarcophages sculptés du Grand Siècle ne s’inscrivent pas dans la logique des rites funéraires prescrits par l’Église mais dans le cadre d’expressions mémorielles ponctuelles et d’origine privée. Installés dans un cadre religieux (presque toujours des lieux de culte conventuels ou paroissiaux) et associant vertus profanes et attributs sacrés dans une grammaire symbolique de commémoration, d’édification et de remémoration, ils formulent une synthèse monumentale du sermon et du panégyrique, réunissant invocation au souvenir et à la prière, préparation à la mort et consolidation dynastique. Sur le plan spirituel, leur fonction propitiatoire relève en somme de l’économie du sacré impulsée par la Contre-Réforme. En parallèle, sur le plan dynastique, faire mémoire des mérites du défunt est un moyen d’étayer le renom de sa lignée.
Service de l’état et et logiques dynastiques
De fait, les inhumations de prestige concernent essentiellement des hommes, reléguant les femmes à la portion congrue (un quart des cas) et fréquemment dans une posture matrimoniale subalterne. Parmi un florilège de personnalités généralement illustres défilent souverains (Louis XIII, Louis XIV, mais aussi sarcophages rétrospectifs de Clovis et Henri III, et tombeau du déchu Jacques II Stuart), ministres (Richelieu, Mazarin, Colbert, Louvois), princes du sang (Condé, Conti, la duchesse d’Angoulême) et artistes officiels (Le Nôtre, Lulli), sans négliger l’étrange triple tombeau (corps, coeur… et bras) du cardinal de Bérulle, support matériel de la canonisation potentielle de ce grand réformateur du clergé. Alors que les Bourbons délaissent la tradition des effigies royales (hormis la réhabilitation du priant de Louis XI à Cléry, vandalisé par les Huguenots), certains ordres religieux reprennent à leur compte le culte de la memoria royale dont ils tirent les dividendes en termes de rayonnement. Les uns réhabilitent les sépultures des souverains mérovingiens, les autres (essentiellement les Jésuites) capitalisent la faveur affective résultant de la captation des coeurs royaux, tandis que Notre Dame devient le réceptacle des entrailles Bourboniennes. Ce glissement reflète la montée en puissance du ressort théologique de la légitimité monarchique. A un rang inférieur, l’aspiration au faste funéraire correspond à des logiques de distinction sociale et de « consommation de prestige » dont Claire Mazel souligne l’analogie avec les analyses de Pierre Bourdieu et Norbert Élias. Cette forme de monumentalisation réunit princes soucieux de tenir leur rang et grands commis de l’état anxieux de consacrer leur ascension sociale. Toutefois, le profil des défunts évolue au cours de la période. La magnificence funéraire reflète d’abord l’orgueil des grands. Puis le règne de Louis XIV se caractérise par une inflation des dépenses d’ostentation funéraire, associée à un resserrement des commandes sur la “noblesse d’état” des grands serviteurs de la royauté, ministres, maréchaux et gouverneurs, auxquels se joignent les artistes qui chantent et enchantent la geste du Roi-Soleil. En cela, l’art funéraire témoigne indéniablement du renouvellement et de la redéfinition des élites. Image de l’être social et représentation de dignité, son lustre constitue une preuve d’honneur destinée à perpétuer et promouvoir la lignée, dans une logique qui fait écho au modèle antique du patriciat romain. Plus rarement, il peut également témoigner d’une pratique monumentale conjuratoire face au déclin social (cas emblématique des de Thou). Néanmoins, le pouvoir des images n’est pas illimité. Régulé par la norme harmonieuse des convenances, il peut s’anéantir lui même par la rhétorique de l’excès : les pratiques de la famille de Rostaing en constituent le parfait exemple.
Les mutations du processus de création funéraire
La dépense artistique est un investissement narcissique confronté à un autre ego : celui du créateur. La production funéraire est le fruit de leur interaction. Au fil du Grand Siècle, elle n’échappe pas au phénomène de transition bien connu qui mène des artisans aux artistes, à ceci près qu’il résulte ici tout autant d’une mutation dans la conception de la tâche à accomplir que d’une promotion sociologique des acteurs. De fait, les premiers constructeur s’apparentent essentiellement à des entrepreneurs funéraires, des maîtres d’oeuvre dont l’action est plus architecturale (conception d’un ensemble funéraire) qu’esthétique, même si la plupart mettent aussi ponctuellement la main au burin. Ils cèdent la place, au milieu du XVIIe siècle, à une génération de sculpteur reconnus, dont Jacques Sarazin et François Anguier sont les chefs de file. Ceux-ci subjuguent leurs commanditaires par la vitalité d’une inspiration et d’une ambition artistiques fondées sur le voyage en Italie et la référence au modèle de Michel Ange. “Artistes totaux” assumant intégralement le suivi de l’oeuvre, ils se caractérisent par une exigence de perfection et de splendeur funéraire qui prend en compte le regard du visiteur. Après eux, l’apogée du règne Louis Quatorzien coïncide avec une division du travail inédite, articulée sur un mode ternaire. Inspirateurs prestigieux, le génial Charles Le Brun et son épigone Hardouin-Mansart fournissent projets d’ensemble et esquisses préparatoires. Les sculpteurs, parmi lesquels brillent Coysevox et Girardonqui revendique pourtant hautement son autonomie artistique, et est du reste le concepteur principal du monument de Richelieu., sont désormais cantonnés dans les tâches d’exécution artistique, où leur excellence leur assure d’ailleurs une reconnaissance et une rémunération croissantes. Tous ces talents s’expriment sous la supervision vigilante de la clientèle, animée d’un souci grandissant des normes de convenance et des canons du goût, qu’uniformisent l’absolutisme royal et le triomphe de la dévotion. Dans cette ultime configuration, ce sont bel et bien les commanditaires qui prennent en main la direction artistique des oeuvres produites, à travers un processus de coproduction désormais façonné selon les codes d’un art d’État officieux. Aboutissement en forme d’impasse : dès le tournant des années 1690, la monumentalité funéraire passe de mode, supplantée par l’art plus modeste et moins onéreux du buste et du portrait en médaillon.
Un volume plurimédia
Innovation assurément appelée à prospérer, l’éditeur a joint un CD-Rom au livre. Les usagers des TICE ne pourront qu’être sensibles à l’intérêt d’une telle complémentarité, d’autant que le contenu de ce CD apporte une indéniable plus-value à l’ouvrage. Matière première de la thèse de Claire Mazel, le corpus des 121 monuments sur lequel s’appuie le propos y est en effet présenté de façon exhaustive et soignée. Greffés sur une interface d’accès agréable, plusieurs modes d’entrée sont disponibles : index des artistes (sculpteurs, peintres et architectes), des églises où les monuments avaient été érigés, de leurs lieux de conservation actuels, listes des monuments restaurés, de ceux écartés du corpus, et enfin une table alphabétique des personnalités monumentalisées. 110 fiches détaillées de présentation (certaines concernant des monuments associés) récapitulent les éléments factuels rassemblés par Claire Mazel : biographie du défunt, emplacement originel du monument, sa description formelle, texte de l’inscription qui l’accompagne (regrettons cependant, dans l’état de l’érudition contemporaine, que les épitaphes rédigées en latin n’aient pas été traduites), date de commande, genèse et l’histoire de l’oeuvre, annexes diverses (devis et contrats notariés de construction, interprétations allégoriques, évocations contemporaines). Enfin, gravures et reproductions figurées anciennes et, pour les oeuvres subsistantes, clichés de l’auteur, illustrent les notices afférentes. Valorisant l’érudition scientifique par l’innovation technique, cette synergie constructive entre livre et multimédia mérite d’être saluée.