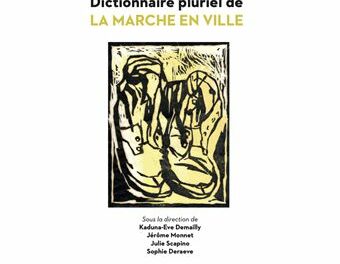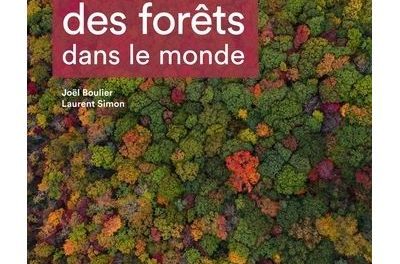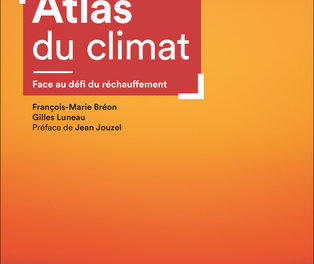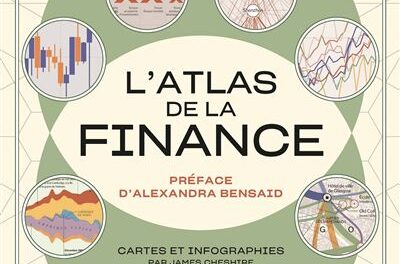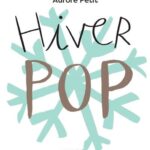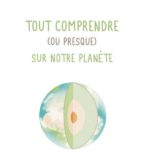Ce volume de la collection GéoTraverses réunit 21 experts pour penser les gares comme des objets-frontières transdisciplinaires où peuvent s’articuler des perspectives naturalistes, architecturales et politiques. Symboles et héritages d’un passé prestigieux, les gares et leurs quartiers sont désormais l’objet de stratégies d’adaptation aux changements globaux. L’ouvrage explore les procédés techniques variés engagés dans cette perspective et montre comment ces procédés associent la régénération ferroviaire au développement territorial.
Nacima Baron est professeure à l’université Gustave-Eiffel, membre senior de l’Institut universitaire de France et du Laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Ses travaux portent sur la manière dont les politiques des déplacements urbains se saisissent des transitions urbaines, énergétiques, environnementales et performent la mise en mouvement de l’urbanisme. Nils Le Bot est diplômé d’École d’art, architecte et maître de conférences à l’ENSA Paris-Val de Seine. Il a soutenu une thèse de géographie urbaine. Pauline Detavernier est architecte, docteure en architecture et maîtresse de conférences à l’ENSA Paris-Val de Seine. Sa thèse portait sur la conception des cheminements piétons en gare, et plus largement sur la pratique de la marche dans les lieux de mobilité.
Très clairement l’approche voulue par les auteurs est une approche pluridisciplinaire. On y trouve en premier lieu des géographes qui ont fait des gares des « lieux-réseaux ». La gare occupe toujours une situation géographique particulière. Elle n’est jamais exactement au centre d’une ville. La gare est toujours hautement accessible et en même temps d’un accès parfois malaisé. Les sociologues en font des lieux-mouvements, mettant en avant le flux, l’usager et les ambiances. Les ingénieurs ont construit deux « cultures » autour des gares : celle des techniques fondées sur l’architecture ; celle de l’exploitation. Analysée dans ses dimensions fonctionnelle et morphologique, l’intégration urbaine ou l’intégration ferroviaire des gares n’est pourtant pas acquise. Elle relève davantage d’un processus de négociation, sans cesse renouvelé. L’ouvrage interroge le devenir des gares face aux chocs environnementaux et contrechocs épistémiques. Les opérateurs et gestionnaires de gare promettent de construire des stratégies de résilience. Ils se convertissent de grands consommateurs d’électricité en futurs producteurs.
L’ouvrage est divisé en quatre parties. La première traite des écologies et des réseaux, la deuxième des métabolismes et des circularités, la troisième sur les ambiances et les paysages et en fin la dernière sur le design et les reconnexions possibles. La première partie explore les interactions entre les gares et la biosphère. Elle intègre la question de la perception sociale et culturelle des marqueurs d’artificialité ou de naturalité des gares. À travers des contributions consacrées au réemploi des pierres de taille ou à la revalorisation des roches excavées lors du creusement de gares souterraines, la deuxième partie souligne l’intérêt renouvelé de l’ingénierie pour une utilisation plus sobre des ressources naturelles. La troisième partie envisage l’environnement des gares depuis des travaux sur revégétalisation, l’insertion paysagère et la mise en avant des qualités sensorielles des gares. On trouvera, par exemple, une réflexion sur les paysages sonores des gares et leurs effets en matière d’inclusion ou de discrimination sociale. La quatrième partie n’oublie pas que l’humain, singulier et collectif, se tient au centre de la nouvelle nature des gares : l’usager affairé et mécontent, et aussi le sans-abri constamment rejeté de la gare. Tous les témoignages réunis dans cette dernière partie montrent qu’une écologie des gares pourrait faire bouger les lignes davantage que les technologies.