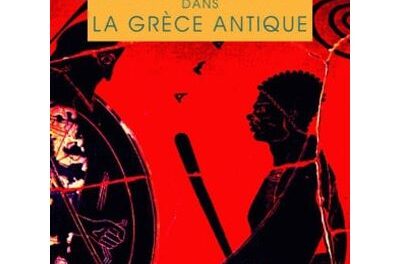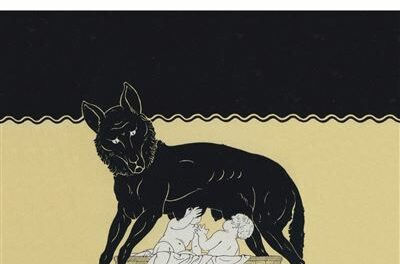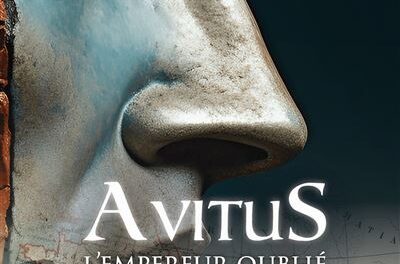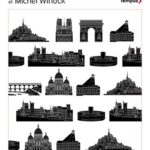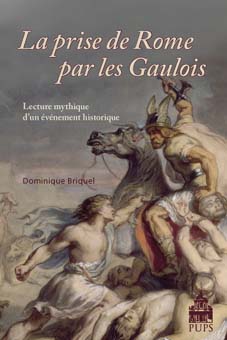
Comme l’indique le sous-titre, l’ouvrage ne revendique aucune perspective historique, mais se veut une analyse dans une perspective comparatiste des récits faits par les auteurs antiques – essentiellement Tite-Live et Plutarque – d’un épisode qui traumatisa durablement les Romains.
De ces événements, nous ne pouvons que supposer le déroulement réel : profitant de leur supériorité militaire, qui en faisait aussi des mercenaires recherchés, les Gaulois ont vraisemblablement mené un raid pour obtenir une rançon, dont la tradition fixe le montant à mille livres d’argent ; malgré les enjolivements postérieurs, il paraît probable que les Romains aient bien payé cette somme, peut-être pour éviter que la Ville soit brûlée, puisque les fouilles archéologiques n’ont révélé aucune trace de l’incendie que les auteurs antiques se sont plus à évoquer.
S’il est impossible de reconstituer les événements historiques, les légendes qui s’y sont ajoutées par la suite offrent en revanche une matière riche et abondante dont on peut rappeler les éléments principaux : après la difficile victoire (la guerre avait duré 10 ans) sur la cité étrusque de Véies, les Romains exilent le général vainqueur Camille, qui s’était rendu odieux à la plèbe. C’est alors, en 390 avant notre ère selon la chronologie livienne, que les Gaulois attaquent la cité étrusque de Chiusi. Les ambassadeurs envoyés par Rome, trois frères de la famille des Fabii, prennent part au combat et tuent un chef gaulois, au mépris des règles du droit ; furieux, les assaillants tournent leur attaque contre Rome, qui refuse leurs demandes de réparation pourtant justifiée et élit même les coupables tribuns militaires.
Vae victis
Mis en déroute lors de la bataille sur les bords de l’Allia, un affluent du Tibre, les Romains se divisent, d’autant qu’une partie des vaincus, que l’on croyait morts, se sont réfugiés à Véies : dans une scène fameuse entre toutes, les anciens attendent les envahisseurs dans leurs demeures et en grand apparat ; un temps frappés de stupeur, les Gaulois finissent néanmoins par les massacrer. Les jeunes en âge de porter des armes se réfugient sur le Capitole et mènent une résistance acharnée, assistés en cela par les célèbres oies du Capitole, qui les préviennent d’une tentative d’assaut nocturne. Les autres habitants fuient la ville. Après divers épisodes, les Romains désespérés acceptent de payer une rançon de mille livres d’or ; c’est à ce moment que le chef Brennus, auquel les Romains reprochaient que ses hommes utilisaient des poids truqués, aurait ajouté son épée dans le plateau de la balance et déclaré « Malheur aux vaincus ». Arrive alors Camille, à la tête d’une troupe de soldats romains ; ayant obtenu les pouvoirs de dictateur et donc seule autorité légitime, il refuse le paiement de la somme puis bat les Gaulois. Ainsi Rome est-elle in extremis délivrée du péril et de la honte de la rançon.
C’est donc sur ce récit, dont plusieurs versions existent, que portent les analyses de D. Briquel. Son objectif est de montrer qu’il a été élaboré, dans des circonstances que rien ou presque ne nous permet de préciser, à partir du modèle fourni par le schéma indo-européen de la « grande bataille eschatologique » entre les forces du bien et du mal, que l’on retrouve aussi bien dans le Mahabaratha que dans les textes sur la guerre de Troie, ou ceux de Snorri Sturluson sur la mythologie scandinave.
Une guerre entre romains
L’examen méticuleux des divers épisodes de cette guerre permet à l’auteur de montrer qu’elle a également été pensée comme un contrepoint à la guerre contre Porsenna (509 av. J.-C.), qui permit à Rome de se débarrasser des rois, et comme l’aboutissement d’une « grande année », notion étrusque désignant des cycles historiques de durées variables qui marquaient les grands moments de la vie d’une cité. La division de la cité entre les représentants des trois fonctions, traduite dans le récit par les destinations diverses des composantes du peuple, est finalement surmontée et l’unité retrouvée grâce au nouveau Romulus qu’est Camille.
Il est impossible de revenir dans le cadre de ce compte rendu sur le détail de ces analyses, dont quelques-unes me paraissent donner trop d’importance à l’élément mythique au détriment des événements réels (ou vraisemblables, dans la perspective des auteurs antiques), comme celles qui portent sur le rôle du fleuve dans ces récits. De manière plus générale, on ne peut s’empêcher de se dire que la démonstration pourrait mieux s’inscrire dans un gros article scientifique, ou que les presque 400 pages bien tassées de cette démonstration auraient pu permettre une réflexion plus générale, par exemple sur la manière dont des défaites ont pu être transformées de manière semblable à Rome ou ailleurs, par recours aux schémas mythiques indo-européens ou à d’autres structures intellectuelles. Telle n’est pas du tout la perspective de l’auteur, qui s’en tient aux seuls récits concernant les événements de 390 et à ceux qui les éclairent. Pour cette raison, l’ouvrage, au demeurant bien écrit et très lisible, peut être conseillé aux seuls inconditionnels de la mythologie comparée et des légendes romaines.