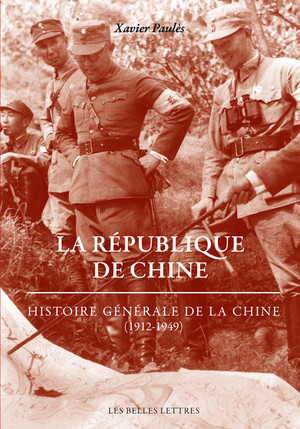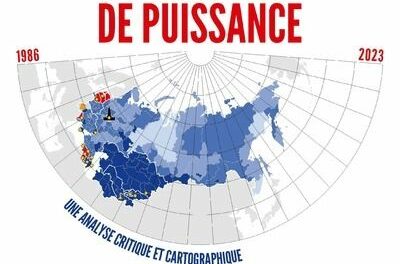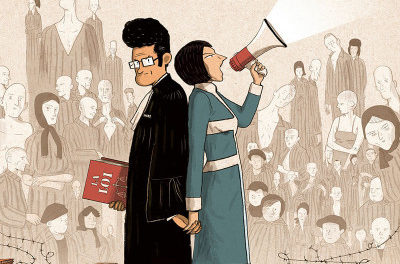Xavier Paulès est maître de conférence à l’EHESS et rattaché au Centre d’étude sur la Chine moderne et contemporaine, qu’il a dirigé de 2015 à 2018. Il est notamment l’auteur de La Chine des guerres de l’opium à nos jours (CNRS Editons;2013).
Cette histoire de La République de Chine (1912-1949) est un des volumes de l’Histoire générale de la Chine, publiée aux Belles Lettres , qui ambitionne d’être, à terme, en 10 tomes, la plus vaste synthèse en français de l’histoire de la Chine.
L’ouvrage de Xavier Paulès aborde la période républicaine de 1912 à 1949. Dès l’introduction l’auteur réfute les interprétation trop téléologiques qui font de cette période un interrègne entre l’Empire et l’avènement de la République populaire de Chine (RPC). Il rappelle que ce n’est qu’à partir de 1944 que le Parti Communiste chinois (PCC) prend le dessus sur le Guomindang (parti nationaliste), dans une conjonction de facteurs assez chanceuse. De même, l’auteur rejette la grille de lecture qui consiste à mettre en avant le concept de modernisation, phénomène qu’il inscrit dans un arc chronologique beaucoup plus large que celui de la période 1912-1944. Pour Xavier Paulès, la République n’est pas « un interrègne chaotique », isolé du reste de l’histoire chinoise. Il voit au contraire une constante dans cette période, la recherche d’un maintien de la puissance chinoise, à travers la voie républicaine ou celle de la révolution.
Comme les autres volumes de la collection, ce livre est composé de deux parties : la première, divisée en 5 chapitres, propose un déroulé évènementiel de la période selon un découpage chronologique assez classique. La seconde, aborde en 4 chapitres des thématiques larges : l’économie, la construction de l’État , la société et la vie intellectuelle.
Le premier chapitre est consacré à la « révolution de 1911 ». L’auteur démontre que la fin de l’empire et la chute de la dynastie Qing sont en partie provoqués par un ensemble de mesures qualifiées de « révolutionnaires » (p. 25), les Nouvelles Politiques (refonte du droit, création de nouvelles forces armées, suppression du systèmes des examens impériaux). Conjuguées aux réformes institutionnelles qui prévoient, en plusieurs étapes, une monarchie parlementaire, elles ébranlent l’assise du pouvoir impérial. X. Paulès montre comment la révolution (qui fait plusieurs milliers de morts, bilan non négligeable, sans être pour autant un bain de sang) se caractérise d’abord par sa multipolarité, avec différents foyers révolutionnaires dans tout le pays, politiquement divisés. Sun Yat-Sen, président du gouvernement provisoire, proclame la République à Nankin le 1er janvier 1912. Il démissionne une fois l’abdication de la dynastie proclamée et laisse le pouvoir à Yuan Shikai. Les fondations d’un ordre républicain sont posées avec la Constitution provisoire de mars 1912. La ligue Jurée de Sun-Yat-Sen se transforme en parti politique, le Guomindang et remporte les élections. C’est pourtant Yuan Shikai qui, avec habileté, confisque peu à peu la révolution à son profit et impose son pouvoir. Mais dans le contexte de la Première guerre mondiale, les 21 demandes des Japonais en mai 1915 constituent pour lui un véritable camouflet. Sa volonté de rétablir l’Empire, en décembre 1915, provoque une révolte contre ses ambitions monarchistes. Sa mort (naturelle) en juin 1916 laisse le pays politiquement très divisé. La révolution de 1911 démontre que dorénavant la légitimité repose sur l’assentiment de la population. La personnalité de Yuan Shikai incarne aussi une dynamique de recentralisation.
Le chapitre 2 aborde la période des « Cliques et seigneurs de guerres » , traditionnellement considérées comme des années perdues pour la Chine. Cette décennie est marquée par le délitement du pouvoir central et la mainmise des seigneurs de guerre sur le pays. Le récit de cette période insiste habituellement sur la montée en puissance du Guomindang, réorganisé sur le modèle bolchévique. Ce récit a l’avantage de simplifier la grille de lecture d’une période très complexe sur le plan évènementiel, mais, trop téléologique, il néglige le fait que le Guomindang ne représente pas grand-chose jusqu’au milieu des années 20. L’auteur brosse au contraire un tableau extrêmement précis des luttes et rivalités entre les cliques et les seigneurs de guerre pour le contrôle du gouvernement. Il remet au passage en cause certains préjugés négatifs sur cette période, comme l’idée d’un appauvrissement de la Chine, montrant par exemple que « la circulation des hommes et des marchandises reste libre ». Il démontre que les seigneurs de la guerre (Junfa) étaient très attachés à l’indépendance nationale ou que les évènements du 4 mai 1919 sont aussi l’expression d’une forme de conscience nationale.
Le mouvement du 4 mai 1919 éclate pour protester contre le transfert au Japon des droits et avantages dont l’Allemagne jouissait avant 1914 dans le Shandong. Ce mouvement marque l’entrée de larges couches urbaines sur la scène politique au nom d’idéaux nationalistes. Sous la férule de Sun-Yat-Sen, le Guomindang connaît ensuite un essor, en se calquant après 1924 sur l’organisation du parti bolchévique russe. La mort de Sun Yat-Sen en mars 1925 rebat les cartes du jeu politique. Chiang Kai-shek profite du mouvement du 30 mai 1925 (répression sanglante d’une manifestation anti-impérialiste à Shanghai par la police britannique) pour présenter le Guomindang comme le porte-drapeau de la lutte contre l’impérialisme. Le Guomindang, parti de sa base du Guandong, peut alors lancer en 1927 l’expédition du Nord. A l’issue d’une série d’opérations militaires contre les principaux seigneurs de la guerre, il installe un gouvernement national à Nankin. A cette occasion, le leader nationaliste décide de mettre brutalement fin au Front uni avec le PCC. L’auteur présente dans le détail les trois phases de cette expédition du Nord, succès militaire et politique de première importance pour le Guomindang, qui masque cependant des faiblesses (unité politique de façade, implantation locale véritable limitée à trois provinces..).
Le chapitre trois traite de la décennie de Nankin (1928-1937). Le choix de Nankin comme capitale procède d’une volonté assumée du Guomindang de « déchoir ostensiblement Pékin de son rang de capitale ». Le parti nationaliste s‘impose comme l’acteur politique principal cette décennie, mais doit cependant faire face au péril des seigneurs de la guerre jusqu’aux années 1931-1932. Le début de la décennie de Nankin est marqué par l’affirmation du leadership de Chiang Kai-shek , qui doit toujours composer avec de nombreux rivaux. Les années 1932-35 sont celles de la stabilisation, avec d’importantes réalisations. Le Guomindang mène une diplomatie active qui permet à la Chine de récupérer certaines possessions aux mains des Européens depuis le XIXè siècle ( Hankou, Xiamen,Tianjin…) . Les diplomates chinois obtiennent de la communauté internationale qu’elle reconnaisse le caractère indiscutable de l’appartenance de la Mandchourie à la Chine. Sur le plan économique, le gouvernement de Nankin obtient l’autonomie douanière. Les rentrées fiscales doublent, la dette publique est consolidée. Les systèmes bancaires et monétaires sont réorganisés ; en 1935, une monnaie fiduciaire est créée, le fabi. Le gouvernement procède au développement des infrastructures, notamment ferroviaires.
Cette importante œuvre gouvernementale contribue à renforcer durablement la centralisation et la puissance chinoise. Mais, la menace Japonaise qui guette en permanence la Chine, se concrétise en 1931. Le conflit et l’invasion japonaise débouchent sur la création d’un État fantoche en Mandchourie, contrôlé par les Nippons : le Mandchoukouo.
L‘influence et le poids des seigneurs de la guerre diminuent, et le PCC est de plus en plus marginalisé. Après la rupture du Front uni en 1927, le PCC rentre dans la clandestinité. Le Guomindang tente de l’écraser. Il est tout près d’y arriver : la Longue marche, de 1934-35 est un désastre militaire pour Mao et ses troupes. Celles-ci comptaient 100000 hommes en 1934 dans leur base du Jiangxi, les communistes ne sont plus que 10000 en 1935. C ‘est le déclenchement de la guerre avec le Japon en 1937 qui sauve le PCC de l’anéantissement auquel il était promis.
La guerre contre le Japon fait l’objet du 4ème chapitre. La première phase, de 1937 à 1939 correspond à une guerre de mouvement, marquée par des victoires japonaises et par la prise et le massacre de la population de la capitale, Nankin, le 13 décembre 1937 (entre 50000 et 300000 victimes selon les études). Le Guomindang doit accepter un second Front uni afin d’obtenir l’aide de l’URSS. Il faut près de 10 mois à l’armée japonaise pour conquérir la région du moyen fleuve Bleu . Dès 1939, l’idée que la guerre sera longue s’installe. Elle prend alors la forme d’une guerre de position, de 1940 à 1944, marquée par les bombardements japonais sur les principales villes chinoises, notamment Chongqing, devenue capitale de la Chine libre. L’entrée en guerre des États-Unis en 1941 change la donne de la guerre. Pour autant, l’Etat-Guomindang, connaît déjà depuis 1940 une forme de délitement (très forte inflation, grave famine du Henan en 42-43 avec 2 millions de morts). Il doit faire face à la montée en puissance du PCC de Mao, qui réussit à imposer au parti sa « pensée », et arrive peu à peu à montrer au aux occidentaux que le visage de la Chine n’est pas seulement celui de Chiang Kai-shek. 900000 km² de la Chine et 180 millions de Chinois sont occupés par les Japonais.
En 1944 ces derniers lancent l’offensive Ichigo, qui est un franc succès et conduit les forces du Guomindang au bord du précipice. Quelques mois plus tard, grâce à la victoire de son allié américain dans le Pacifique, la Chine se trouve dans le camp des vainqueurs. Le bilan est terrible : plus de deux millions de militaires sont morts, on compte plus de 10 millions de victimes civiles ( beaucoup d’historiens avancent des chiffres bien plus élevés en tenant compte des famines et épidémies ; le gouvernement chinois avance aujourd’hui le chiffre de 35 millions de morts ). Le bilan matériel et industriel de la guerre est tout aussi lourd.
Le vrai vainqueur de la guerre est le PCC, qui contrôle dorénavant une zone de 900000 km² et de 100 millions d’habitants, et qui compte plus d’un million d’hommes. Il s’est appuyé sur une stratégie pertinente et a bénéficié de circonstances très favorables. En 1972 Mao pouvait ainsi déclarer, non sans cynisme, au Premier ministre japonais Tanaka Kakuei, que le PCC devait être reconnaissant envers le Japon pour son agression, car sans elle « il ne serait jamais parvenu au pouvoir » (p. 164) !
Le dernier chapitre chronologique, le cinquième, est consacré à la guerre civile de 1945 à 1949. L’auteur rappelle que cette période est habituellement présentée comme « la chronique d’une mort annoncée », celle de l’hégémonie du Guomindang sur la Chine continentale . Xavier Paulès insiste cependant sur le fait que cette défaite n’avait rien d’une fatalité, et qu’elle semblait même improbable au lendemain de la capitulation du Japon. La donne politique est tout d’abord très favorable au Guomindang. Elle s’accompagne d’un véritable rebond économique dans les années d’après-guerre. Si le Guomindang peut compter sur le soutien américain, Staline ne fait pas montre de sentiments très chaleureux à l’égard du PCC et de Mao. Le parti de Chiang Kai-shek relance pourtant la partie qui semblait bloquée, par une série d’erreurs politiques et économiques. Les premières opérations militaires qui commencent en 1946 sont dans un premier temps favorables au Guomindang. Mais le PCC peut compter sur une arme redoutable, la maîtrise du renseignement, qui lui donne l’avantage considérable de lire le jeu de son adversaire. C’est également au niveau du commandement suprême que la guerre s’est jouée, Chiang Kai-shek s’avère un piètre stratège, quand la chaîne de commandement de l’Armée rouge fonctionne parfaitement. Le rapport de force tourne rapidement à l’avantage de cette dernière et les batailles de 1948 sont des désastres pour les nationalistes. Ceux-ci perdent tout espoir et mettent en œuvre le repli sur Taïwan, repli très certainement anticipé et parfaitement exécuté. La République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949 à Pékin.
La défaite du Guomindang ne peut s’expliquer uniquement par des facteurs militaires. Si la question de la corruption du parti a souvent été avancée, les causes de la sclérose du parti nationaliste sont plutôt à chercher dans l’absence presque totale de renouvellement de son personnel politique. De même, celui-ci n’a pas su accomplir sa mue démocratique, Chiang Kai-shek ayant surtout cherché à affirmer son pouvoir personnel.
Les quatre derniers chapitres de l’ouvrage, thématiques, offrent au lecteur un tableau extrêmement précis de la Chine républicaine, et permettent à Xavier Paulès de revenir sur certains préjugés. L’érudition de l’auteur et l’ampleur des champs abordés ne permettent pas d’en livrer un résumé complet. On peut toutefois revenir sur quelques aspects et exemples marquants.
Le tableau de bord de l’économie chinoise (chapitre 6) souligne l’inventivité d’un capitalisme à la chinoise, qui bénéficie d’un cadeau bien involontaire de part de l’Europe. La Première guerre mondiale ouvre en effet de formidables opportunités économiques à la Chine, par exemple dans le domaine des exportations de tungstène, métal très demandé par les économies occidentales. Pour autant, dans les années 20, la Chine ne contribue seulement qu’à 1 % du commerce mondial. Le système financier chinois reste très fragile, en raison du manque de capitaux. L’agriculture demeure le socle ancestral de l’économie. Plus que la production, ce sont les surfaces cultivées qui augmentent. Les régions spécialisent leurs productions, des cultures commerciales sont développées. L’agriculture bénéficie de l’essor considérable du secteur des transports. L’extraction minière est en pleine croissance (charbon). Le secteur secondaire connaît un fort dynamisme, dans l’industrie légère et dans celle des biens de consommation. Le capitalisme chinois est fondamentalement familial, il souffre toutefois d’un manque d’investissement.
Le secteur des services est souvent oublié par l’historiographie traditionnelle, il atteint pourtant 25 % du PIB chinois au début des années 30. Les transports connaissent un essor considérable sous la République, et pas seulement dans le rail. Les services « traditionnels » ( colporteurs, vendeurs ambulants, barbiers, coiffeurs, diseurs de bonnes aventures) restent cependant très importants dans la société chinoise.
La guerre de 1937-1945 et la guerre civile accélèrent certaines évolutions économiques, comme l’implication de plus en plus forte de l’État, bien avant le tournant de 1949.
Dans le domaine de la construction de l’État (chapitre 7), l’historiographie reconnaît aujourd’hui que le bilan s’apparente, sous la République, à un demi-succès. Le nationalisme progresse dans d’importantes couches de la population, mais le phénomène le plus significatif est l’invention et la diffusion d’une nouvelle culture politique post-impériale. La rupture la plus forte, conséquence de 1911, est l’instauration d’une nouvelle forme de légitimité fondée non plus sur le mandat céleste mais sur l’assentiment du peuple ( rôles des élections, de l’oralité…). Certaines de ces réformes sont d’ailleurs dans la continuité des Nouvelles Politiques de la dynastie Qing ( c’est le cas des élections ou de l’adoption du calendrier grégorien).
L’auteur consacre aussi dans ce chapitre de belles pages au Guomindang comme parti-Etat et à la figure tutélaire de Sun Yat-sen. L’une des tendances de fond de fond de la période est, sous la houlette du parti nationaliste, l’extension du périmètre de l’État, dans de très nombreux domaines (secteur productif, art martiaux, médecine, enseignement supérieur…), y compris celui de la planification économique.
L’avant dernier chapitre (le huitième) met en lumière les transformations de la société, du fait d’un renouvellement considérable de l’histoire sociale. Grâce aux historiens des années 80, les paysans et les ouvriers ne sont plus seulement dépeints comme les acteurs de la geste révolutionnaire. Les études portent dorénavant sur toutes les catégories sociales. L’auteur passe en revue les données démographiques le Chine républicaines et insiste sur la question des migrations. Il présente les différents groupes sociaux, leur niveau de vie, les pratiques culturelles (loisirs), avec par exemple le développement du sport, du cinéma…Shanghai apparaît alors comme la ville par excellence où émergent de nouveaux modes de vie, d’inspiration occidentale (par exemple, l’adoption massive de la cigarette).
Enfin, le dernier chapitre, aborde les transformations culturelles. La République implique en effet une refondation intellectuelle radicale. La circulation des idées s’appuie notamment sur le développement de l’enseignement primaire et secondaire, sur un enseignement supérieur qui progresse rapidement, et sur l’essor des médias. Les bibliothèque, l’édition et surtout la presse, se développent fortement, tout comme le cinéma.
Le mouvement du 4 mai 1919 est porteur d’une « nouvelle culture » ( xin wenhua yundong) . Il est confronté à la crise occidentale de la culture chinoise. Toute une génération d’intellectuels, porteurs d’une double culture, classique et occidentale, entreprennent une critique systématique des fondements de la culture chinoise. Elle passe notamment par un processus de modernisation de la langue avec la promotion de la langue vulgaire, le baihua.
Cette refondation intellectuelle se traduit aussi par des formes de renouveaux religieux, avec, entre autres, une grande vitalité du christianisme, pris comme « modèle » par les autres religions pour son organisation, sa structure, son dogme…
La Chine continue à exercer une influence dans le domaine culturel et intellectuel, à l’extérieur de ses frontières. Le prestige de sa culture classique reste intact, notamment en Indochine ou en Corée. Elle se fait aussi le passeur de savoirs d’origine occidentale, tout en conservant une influence forte pour la littérature populaire.
Dans le domaine culturel et intellectuel, les années républicaines sont une période d’influence et d’effervescence. La rupture qui intervient donc en 1949 est ici très nette.
En conclusion, l’auteur réaffirme que 1949 est bien plus la défaite du Guomindang que la victoire du PCC. Il montre aussi que dans de nombreux domaines, le PCC a été le continuateur du Guomindang, les deux partis partageant un but identique : la restauration de la puissance chinoise.
Il termine l’ouvrage en revenant sur le choix des bornes chronologiques de la période républicaine (1912-1949), pour mieux souligner que la rupture abyssale a lieu pendant la décennie 1901-1911 avec les Nouvelles Politiques. Le découpage chronologique de la période républicaine garde tout sa cohérence sur le plan politique : « elle est le temps d’un possible pour une démocratie parlementaire à l’occidentale ».
Le livre de Xavier Paulès, s‘appuie une documentation considérable, faisant la part belle à l’historiographie et aux recherches les plus récentes, et sur l’érudition sans faille de son auteur. Il deviendra très certainement l’ouvrage de référence en langue française sur la République de Chine. L’enseignant de lycée le lira évidemment avec profit ( l’actuel programme de Terminale, avant les « allègements », traitait d’ailleurs de la Chine depuis 1912). Il s’agit là d’une très belle synthèse, qui se lit avec plaisir. En introduction, Xavier Paulès, confesse avoir travaillé à son écriture avec comme le modèle le livre de George Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval. Souhaitons le même succès à son ouvrage.