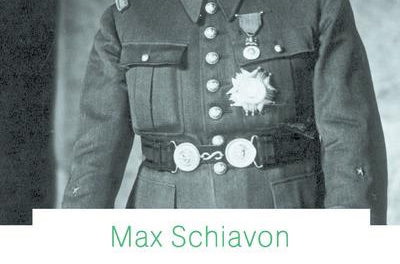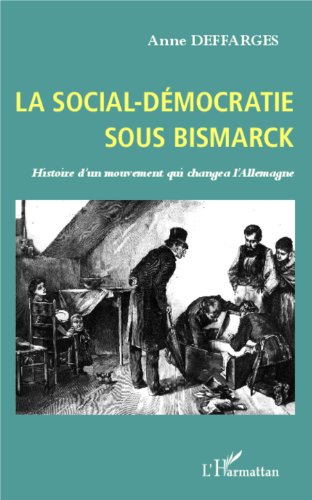
De la naissance à l’interdiction
Dans le premier chapitre (« Avoir les associations culturelles comme berceau »), Anne Deffarges revient sur la naissance des partis ouvriers dans les années 1860 (ADAV en 1863 et SDAP en 1869) à partir d’associations culturelles ouvrières d’obédience bourgeoise (la bourgeoisie libérale, instruite par l’exemple français, voulait éduquer les ouvriers en leur enseignant des rudiments de culture, en prônant aussi le travail et l’épargne, pour diffuser l’idée que les différences de classes s’amenuiseraient ainsi) et leur fusion en 1875, au congrès de Gotha. Les socialistes, fermes sur leurs convictions internationalistes même au moment où se constitua leur nation, refusèrent en 1870 de soutenir l’effort de guerre allemand et clamèrent leur solidarité envers la Troisième République. Ils s’opposèrent également à l’annexion de l’Alsace-Lorraine, ce qui leur valut l’hostilité des milieux dirigeants et des autorités, qui les considéraient comme des traîtres à la patrie.
Le deuxième chapitre (« La social-démocratie devient l’ennemi à abattre ») présente, à l’aide de nombreux exemples concrets, les multiples persécutions (interdictions, arrestations, procès, prison ou exil des dirigeants, propagande des milieux dirigeants dénonçant les sociaux-démocrates comme des traîtres à la patrie, etc.) auxquelles fut soumise la social-démocratie sous le régime des des lois antisocialistes (1878-1890) de Bismarck, qui la privèrent d’existence légale. L’auteure décrit aussi les stratégies de survie des socialistes dans la clandestinité (presse clandestine aux très nombreux titres, imprimée en Suisse et dans l’Empire et diffusée sous le manteau ; réunions secrètes dans des auberges, sous de faux prétextes, et même en pleine nature ; développement d’associations culturelles et sportives et finalement quadrillage du territoire du Reich par de nombreux réseaux incontournables, essentiellement urbains) mais aussi dans des syndicats et des mutuelles, organismes légaux mais très surveillés, et par l’élection à tous les niveaux (Bismarck n’avait pu obtenir l’interdiction des candidatures individuelles), le Reichstag en particulier devenant pour la social-démocratie une tribune politique (au même titre que les procès des dirigeants). Anne Deffarges rappelle enfin que cette persécution, variable dans le temps et inégalement appliquée selon les espaces (particulièrement dure en Prusse et en Saxe), se poursuivit après l’abolition des lois antisocialistes, qui furent au final un échec. Loin de faire disparaître la social-démocratie, au contraire elles attirèrent l’attention sur ses idées et suscitèrent finalement la sympathie des démocrates de tous bords, et surtout ne réussirent pas à empêcher la formidable progression électorale du SPD, qui devint à la fin du XIXe siècle le premier parti d’Allemagne.
« Wissen ist Macht, Macht ist Wissen »
Le troisième chapitre (« Un moyen de contourner les lois répressives : les associations culturelles ») étudie l’action et les positions culturelles de la social-démocratie. Anne Deffarges rappelle que l’interdiction de la social-démocratie par Bismarck de 1878 à 1890 a contraint le parti à se développer sous la forme d’associations culturelles et sportives (qui n’affichaient pas ouvertement leurs liens avec la social-démocratie) de diverses natures : théâtres, bibliothèques et clubs de lecture, associations sportives, chorales, clubs de loisirs, écoles du soir et universités populaires, clubs féministes, etc., sans oublier les banquets et fêtes locales, soit plus de 120 000 membres en 1887 et un réseau souple et décentralisé dans tout le Reich, complété par les imprimeries et les maisons d’édition du SPD, ses auberges ouvrières, brasseries et restaurants où s’organisaient des conférences et où on pouvait lire la presse du parti (par exemple Der Sozialdemokrat pour l’actualité politique et la revue théorique Die Neue Zeit pour la culture dans tous ses aspects et la théorie politique) . Le SPD prétendait structurer la vie des ouvriers « du berceau jusqu’au cercueil ». Certaines associations étaient de simples couvertures pour des activités purement politiques, d’autres avaient pour unique but de répandre la culture dans le monde ouvrier. Ce mouvement, héritage de l’Aufklärung, avait commencé bien avant l’interdiction, bon nombre de militants (dont l’auteure expose plusieurs parcours) étant venus au socialisme par la culture, dans des associations culturelles ouvrières ou sociétés d’éducation de la bourgeoisie libérale et par la fréquentation des bibliothèques de prêt. Quel était l’objectif des socialistes avec cette éducation populaire ? Pour Anne Deffarges, les dirigeants du SPD « considéraient que l’heure n’était pas à la révolution ouvrière, que c’était à la bourgeoisie de succéder vraiment à la noblesse pour mettre en place la République (…). La situation n’étant pas mûre pour que la classe ouvrière soit candidate au pouvoir, le rôle essentiel du parti socialiste, dans ces conditions, était de s’implanter dans les masses, de les cultiver dans tous les domaines de connaissances, de les sortir du quotidien, de leur donner le goût de l’organisation, de la collectivité, de leur apporter la conscience de leur situation sociale, quitte à ce qu’ensuite, une partie d’entre elles puisse s’intéresser aux idées politiques, se former à la théorie socialiste, et que certains travailleurs adhèrent au parti ou deviennent membres actifs. La culture était un préalable, mais le recrutement n’était pas le but premier, plutôt un sous-produit espéré. » (p. 155). Pour Anne Deffarges, il ne s’agissait pas d’une « contre-culture », l’ambition des socialistes étant de démocratiser la culture classique (de Shakespeare à Goethe, de Mozart à Beethoven, de Humboldt à Marx ou Darwin) et le savoir, de faire accéder les ouvriers aux connaissances universelles (sans vulgariser mais en promouvant l’étude), pas de faire du prosélytisme ni de forger une nouvelle culture ouvrière. Si « contre-culture » il y eut, ce fut celle développée après le départ de Bismarck par le pouvoir, qui chercha à développer à son tour des associations culturelles bourgeoises et religieuses porteuses d’une culture instrumentalisée suivant des valeurs conservatrices, pour concurrencer l’essor prodigieux des associations social-démocrates après la levée des lois antisocialistes. Il ne faut cependant pas, selon Anne Deffarges et contrairement à de nombreux auteurs, voir dans la social-démocratie de la fin du XIXe siècle un mouvement essentiellement culturel, « tant les deux aspects, culture et politique, étaient intégrés et intimement liés – comme les deux faces d’une même médaille. » (p. 162-163). La culture n’était pas le but ultime, qui restait l’émancipation par la conquête collective du pouvoir (et non par la culture), suivant la formule de Wilhelm Liebknecht, qui en 1872 retournait la formule de la bourgeoisie contre le féodalisme, « Wissen ist Macht, Bildung macht frei » (« Le savoir c’est le pouvoir, la culture rend libre »), en « Wissen ist Macht, Macht ist Wissen » (« C’est le pouvoir qui donne le savoir »).
Naturalisme et socialisme
Le dernier chapitre (« Entre art et politique, la voie étroite ») aborde la question de la résistance du SPD, de ses intellectuels organiques et de ses principales revues aux intellectuels tenants ou proches du naturalisme. En 1890, le SPD, champion des droits démocratiques devenu un Etat dans l’Etat et un parti de masse qui ne s’adressait plus seulement aux prolétaires mais aussi à certaines couches petites-bourgeoises et diverses professions intellectuelles (médecins, scientifiques avocats, journalistes, écrivains et membres de l’avant-garde culturelle), attirait beaucoup, particulièrement des intellectuels de la bourgeoisie cultivée. Les uns se rapprochaient par sympathie pour l’endurance du SPD (par exemple Theodor Fontane, Henrik Ibsen), certains se retrouvaient au SPD par malentendu ou défaut d’un autre parti qui représente mieux leurs aspirations, d’autres enfin adhéraient politiquement au socialisme (comme l’universitaire Eugen Dühring, la cible de l’Anti-Dühring de F. Engels, ou l’historien et critique littéraire Franz Mehring, jadis farouchement antisocialiste). Pour certains contestataires, les seules possibilités de carrière politique ou journalistique se trouvaient au SPD et ils entendaient y atteindre des postes de responsabilité et y défendre leurs propres idées, au grand dam des « vrais » socialistes. Le conflit éclata particulièrement avec les jeunes artistes avant-gardistes, proches du courant naturaliste et socialisants, de Friedrichshagen (près de Berlin). Ces jeunes intellectuels, extérieurs au monde ouvrier dont ils parlaient dans leurs œuvres, parfois actifs culturellement et politiquement dans le mouvement ouvrier, étaient convaincus que la « question sociale » était déterminante et devait être centrale dans la littérature. Ils s’étaient rapprochés du SPD, particulièrement, en son sein, de la fraction Les Jeunes (die Jungen), mêlant naturalisme, idées socialistes et libertaires, très présente à Friedrichshagen, et dont Bruno Wille était un des porte-parole. Wille était par ailleurs dirigeant de la Freie Volksbühne ( le Théâtre Populaire, né en 1890 de la volonté d’apporter la culture au peuple et de lier littérature moderne et besoins des masses), un des fondateurs de l’association avant-gardiste Durch ! et très influent chez les jeunes écrivains. Le débat entre socialistes « naturalistes » et socialistes « orthodoxes » eut lieu dans la presse social-démocrate, dans les théâtres berlinois de la Freie Volksbühne et lors des congrès du parti entre 1890 et 1896. Anne Deffarges explique que les principaux dirigeants du SPD refusaient l’assimilation du naturalisme au socialisme, estimant que le regard des naturalistes sur le monde ouvrier était extérieur et même sordide et méprisant, les montrant plus au bistrot qu’au travail, et que les naturalistes. Ils considéraient aussi que le rôle du parti n’était pas de promouvoir une littérature moderne prolétarienne « au rabais » (aussi par son utilisation de l’argot ou du dialecte et non de la belle langue) mais le meilleur de la littérature. Ils refusaient de choisir (il n’y avait pas de théorie marxiste de la littérature) et de mettre l’art au service d’une cause, en réalité, mais firent tout pour promouvoir la littérature classique des « grands » auteurs. Les naturalistes, qui s’étaient rapprochés de la social-démocratie au temps des lois antisocialistes, en furent exclus (les Jeunes) ou s’en éloignèrent à partir de 1891. Le débat se termina en 1897 quand Mehring prit la direction de la Freie Volksbühne à Berlin et oriente le répertoire vers le classicisme. S’il y eut par ailleurs, entre 1860 et 1914, environ 600 auteurs socio-démocrates facilement identifiables, « le SPD ne théorisait pas les possibilités d’un tel art, ne lui accordait pas de vertu particulière, il n’estimait pas que ces écrivains formaient un courant littéraire particulier ou qu’ils allaient rénover ni surtout révolutionner la littérature » (p. 218).
Quelques remarques pour conclure
L’ouvrage très riche d’Anne Deffarges s’arrête au début des années 1890, avant la querelle du révisionnisme. On y apprendra beaucoup sur la naissance de la social-démocratie allemande et sa traversée des années Bismarck, et on pourra y puiser de nombreux exemples pour nourrir le cours de Terminale sur ce sujet. Les citations, presque systématiquement données aussi en allemand, seront aussi sans nul doute très utiles aux collègues de DNL Allemand. J’ai néanmoins quelques remarques de simple lecteur, qui n’enlèvent rien à l’intérêt de l’étude. Anne Deffarges a utilisé des sources de première main, les mémoires des principaux dirigeants de la social-démocratie et des articles de la presse socialiste de l’époque, ainsi qu’une abondante bibliographie française et surtout allemande mais peu d’ouvrages issus du monde anglo-saxon, qui a pourtant beaucoup travaillé sur le sujet. L’approche générale du livre est particulièrement centrée sur la question culturelle et sur le rejet de l’idée d’une « contre-culture » socialiste : c’est une thèse originale mais j’aurais aimé avoir d’une part avoir plus de précisions (il y en a) sur le débat historiographique sur cette question et sur la question de la social-démocratie mouvement essentiellement culturel, et dans ce cadre savoir à partir d’exemples très concrets ce qu’on faisait dans ces associations culturelles. Anne Deffarges avance que l’ambition n’était pas de faire du prosélytisme socialiste, et que le caractère politique venait du cadre, des membres et de certaines pratiques ou enseignements dans ces associations. Sur ces derniers points j’aurais aimé en savoir plus, et savoir si l’essor important de ces associations après 1890 changea ou non leurs contenus et les pratiques politiques. Enfin, dans le dernier chapitre sur les relations entre naturalisme et socialisme, il me semble que, si le rejet du naturalisme est clairement montré, la grille de lecture culturelle ne suffit pas à expliquer l’exclusion de la fraction des Jeunes au congrès d’Erfurt en 1891. Alors que, comme le montre bien Anne Deffarges, le SPD devenait un parti de masse au-delà du seul monde ouvrier, ce groupe constituait une opposition de gauche intellectuelle reprochant à la direction l’organisation trop rigide du parti, un trop grand conformisme étouffant tout volontarisme, un trop grand légalisme et un trop grand attachement au parlementarisme et au réformisme « petit-bourgeois ». Ils fondèrent par la suite l’Association des socialistes indépendants, puis soit revinrent vers le SPD soit surtout évoluèrent vers l’anarchisme. En parallèle commençait à émerger un courant réformiste qui fut incarné peu après par Eduard Bernstein. Il aurait sans doute été utile de prolonger l’étude jusqu’à la crise réformiste, tant le débat sur le naturalisme et la littérature prolétarienne semblait déjà en partie l’annoncer.