
La Stasi s’affiche régulièrement au menu des polémiques politiciennes allemandes : ainsi récemment , dans le Land de Brandebourg, des députés locaux du parti Die Linke ont été dénoncés comme anciens « collaborateurs officieux » (IM, Inofizielle Mitarbeiter) de la police politique de la RDA. La Stasi se révèle ainsi un bel exemple de « mémoire chaude » .
Le livre que l’historien Emmanuel Droit consacre à la Stasi tombe donc à point nommé pour qui souhaiterait cerner cette institution qui, selon la mémoire commune, paraît incarner le mieux l’ex-Allemagne de l’est. Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rennes-II et chercheur associé au Centre Marc-Bloch de Berlin, Emmanuel Droit est un spécialiste confirmé de la socio-histoire de la RDA à laquelle il a consacré des publications notables .
La Stasi est d’abord une abréviation qui désigne le Ministère pour la Sécurité de l’Etat (Ministerium für Staatssicherheit), autrement dit la police politique de la République Démocratique Allemande. Elle est issue du « commissariat 5 », un embryon de police politique créé en 1946 par le SMAD, l’Administration militaire soviétique en Allemagne. Un véritable appareil de sécurité est-allemand autonome finit par voir le jour avec la création en février 1950 du Ministère pour la Sécurité de l’Etat, dirigé jusqu’en 1953 par Wilhelm Zaisser. Au début, la Stasi, dont le modèle était la Tcheka, avait pour mission d’éliminer toute forme d’opposition politique. Elle était « le bouclier et le glaive du parti », le SED (Sozialistischer Einheitspartei Deutschlands, Parti socialiste unifié d’Allemagne). D’aucuns la considèrent comme le plus vaste appareil de sécurité de tous les temps, employant en 1989 quelque 91000 officiers et 190000 IM (collaborateurs officieux), sur une population alors estimée à 17 millions d’habitants.
L’intention d’Emmanuel Droit n’était pas de consacrer une somme à la Stasi mais bien d’insister sur un aspect sans doute méconnu de ses missions. Le sous-titre de l’ouvrage « Surveiller pour éduquer » résume bien le fait selon lequel elle a fini par se comporter essentiellement comme « une instance éducative de surveillance politique et de disciplinarisation de la société » (p. 13). C’est donc le rapport de la Stasi à l’école de la RDA et, globalement, à l’éducation de l’homme socialiste, que l’auteur entend interroger.
Jusqu’au début des années 1960, le champ scolaire n’était pas une priorité de l’action de la Stasi. Elle était amenée à y intervenir uniquement quand elle était sollicitée par le parti, les instances éducatives ou la police. Au début des années 1950 les établissements secondaires étaient perçus par le parti comme des ‘repères de réactionnaires et de bourgeois’; ils furent donc l’objet d’une politisation à outrance et d’une surveillance accrue et ciblée pour laquelle la Stasi fut mobilisée. Le parti devait (ré)éduquer une jeunesse qui avait connu le nazisme et qui était, pour le moins, marquée par une violence tant verbale que physique qui pouvait, à l’occasion, s’exprimer contre l’occupant (soviétique) et le régime (communiste). Quand le parti le jugeait nécessaire, la Stasi était affectée à la répression des conduites jugées « oppositionnelles »; dans ce cas, les sanctions infligées étaient très lourdes, souvent disproportionnées aux actes commis.
L’école lors des émeutes de 1953
L’analyse du mouvement insurrectionnel du 17 juin 1953 constitue un morceau de choix du livre, qui permet de prendre la mesure de la protestation au sein de l’école et d’évaluer l’efficacité de la Stasi dans l’anticipation des événements et la répression des actes commis. A Berlin-Est, globalement, les établissements secondaires se sont tenus à l’écart des mouvements de protestation, contrairement aux écoles primaires de certains arrondissements. Dans les établissements où régnait une ambiance « chaotique, anarchique, voire révolutionnaire » (p. 79), on relève des cas significatifs d’inscriptions antisoviétiques au tableau (« Iwan go home! »), de portraits de personnalités décrochés des murs, voire jetés, de banderoles déchirées, de violences physiques à l’encontre de membres des organisations de jeunesse (notamment de la FDJ -Freie Deutsche Jugend-, la Jeunesse libre allemande). Ces actes signifient, au total, « un mélange de rejet de l’autorité adulte et de la construction du socialisme à l’école. » (p. 89) Cet événement fut aussi et surtout, selon l’auteur, « l’histoire d’une absence » (p. 67), celle de la Stasi, qui se montra totalement impuissante face à l’ampleur du mouvement, son inaction reflétant le désarroi qui s’était alors emparé du SED. Une fois l’ordre rétabli, les sanctions furent très limitées, le SED, fragilisé, ayant préféré apaiser les tensions plutôt que de les raviver. Le discours officiel véhiculé par la suite dans les manuels scolaires de la RDA établit que le 17 juin fut « l’oeuvre de provocateurs instrumentalisés par l’Occident, une tentative de putsch que la population est-allemande [avait rejetée] en bloc. » (p. 98) Il n’en demeure pas moins que cette révolte traumatisa tellement les dirigeants du parti et de la Stasi que son chef, Erich Mielke, demanda à ses collaborateurs, à la fin du mois d’août 1989, si ‘une insurrection semblable au 17 juin 1953 était imminente’ (p. 68)…
Lorsque, à compter de 1957, Erich Mielke devint le nouvel homme fort de la Stasi, la fonction de cette dernière commença à se transformer : à la répression succéda la prévention sous la forme d’ « actions éducatives » (p. 99). L’objectif était alors de faire de la police politique un acteur éducatif au sein de la société est-allemande, afin de contribuer à l’autodiscipline des nouvelles générations, des générations d’autant plus malléables aux yeux du régime qu’elles n’avaient pas été affectées par l’idéologie nazie. Le nombre des agents et des informateurs de la Stasi augmenta dès lors notablement.
Police, acteur éducatif
La jeunesse était crainte du régime, à tel point qu’elle devint l’une des principales figures de l’ « ennemi intérieur » qu’il s’agissait non de liquider, mais plutôt de contrôler voire de « rééduquer », tant l’objectif de forger « l’homme socialiste nouveau » était encore d’actualité au cours des années 1960. Parallèlement, l’école est-allemande fut alors marquée par une certaine « militarisation » (p. 163) visant à cristalliser chez les enfants et les adolescents un sentiment national est-allemand, le point d’orgue de cette entreprise, à laquelle la Stasi fut associée, étant l’institution en 1978 d’un enseignement militaire obligatoire dans les Ecoles supérieures polytechniques (correspondant en France au cycle primaire et au collège).
Une véritable « dictature éducative » (p. 110) a donc été mise en place durant l’ère Mielke (1957-1989) à laquelle la Stasi a activement collaboré : l’échec de ce projet éducatif est toutefois patent, comme le révèle, entre autres, l’analyse du scandale qui secoua, en 1988, le lycée Carl von Ossietzky de Berlin-Est (qui accueillait les enfants de l’élite socialiste est-allemande) dont le « Forum d’expressions libres » mis en place par le chef d’établissement donna lieu à de nombreuses provocations contre le régime qui furent, selon l’auteur, comme « un avant-goût de l’effondrement final » (p. 172) de la RDA.
En dernière analyse, Emmanuel Droit nous donne donc ici une claire perception de ce que fut réellement la Stasi : « un colosse aux pieds d’argile » (p. 207). Son projet (consistant à saisir les évolutions de l’idéologie et de la pratique de la Stasi dans le champ scolaire) et sa démarche (« socio-historique centrée sur la remise en cause du caractère monolithique des institutions de domination et l’étude détaillée des interactions entre le pouvoir politique et la société » -p. 20) s’appuient sur une riche documentation, largement produite par la « révolution archivistique » des années postérieures à la Chute du Mur. L’auteur, outre son excellente connaissance de l’historiographie allemande et anglo-saxonne, tire très avantageusement profit de l’examen de nombreux dossiers de surveillance mais aussi des mémoires de fin d’études, jusqu’alors assez négligés par la recherche, produits par les élèves-officiers de la faculté de droit (Juristische Hochshule) de la Stasi.
Le colosse aux pieds d’argile
Les nombreuses études de cas qui, de ce fait, jalonnent le travail de l’auteur donnent beaucoup de relief au livre et constituent un vivier intéressant pour les collègues qui auraient à nourrir par exemple un cours de lycée sur l’histoire des démocraties populaires.
Cet ouvrage qui montre, à rebours de l’école « totalitariste », que la Stasi ne fut ni un « Etat dans l’Etat », mais au contraire un instrument « au service de l’Etat » (p. 17) ni « une institution efficace et moderne qui aurait étouffé la société est-allemande par la violence policière » (p. 21), vaut aussi pour sa perspective comparatiste : ainsi les remarques concernant la notion d’ « ennemi » sont d’autant plus pertinentes qu’elles mobilisent des travaux d’historiens travaillant sur d’autres Etats de l’ex-Bloc soviétique. Contrairement à la Hongrie par exemple, qui ajuste constamment cette notion d’ennemi, en fonction des circonstances (pp. 36-37), au point de la rendre de plus en plus étroite, la RDA n’a cessé de l’étendre très rapidement, si bien qu’au cours des années 1960 la définition de l’ennemi prit un tour de plus en plus vague, au point qu’on est passé « d’une définition reposant sur ce qu’il fait (espionner, transmettre des informations, etc.) à une définition en fonction de ce qu’il est (par exemple un individu ‘décadent’ qui porte jeans et cheveux longs et qui écoute de la musique pop) ou de ce qu’il peut devenir. » (p. 107)
Nous avons donc là, au total, un livre fécond, rigoureux et bien écrit.

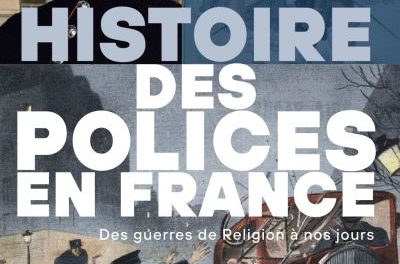

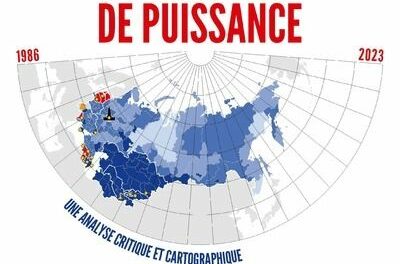
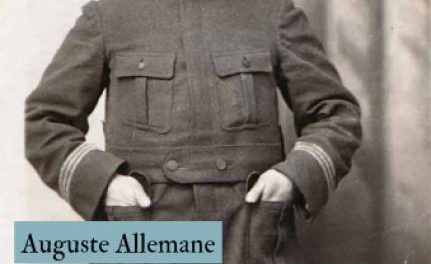









Trackbacks / Pingbacks