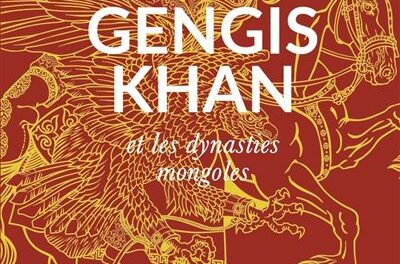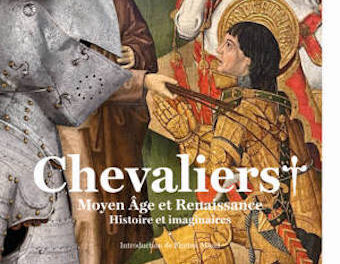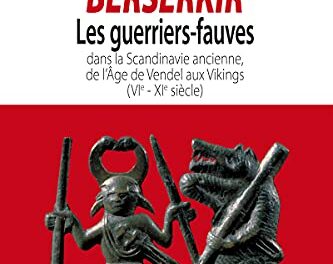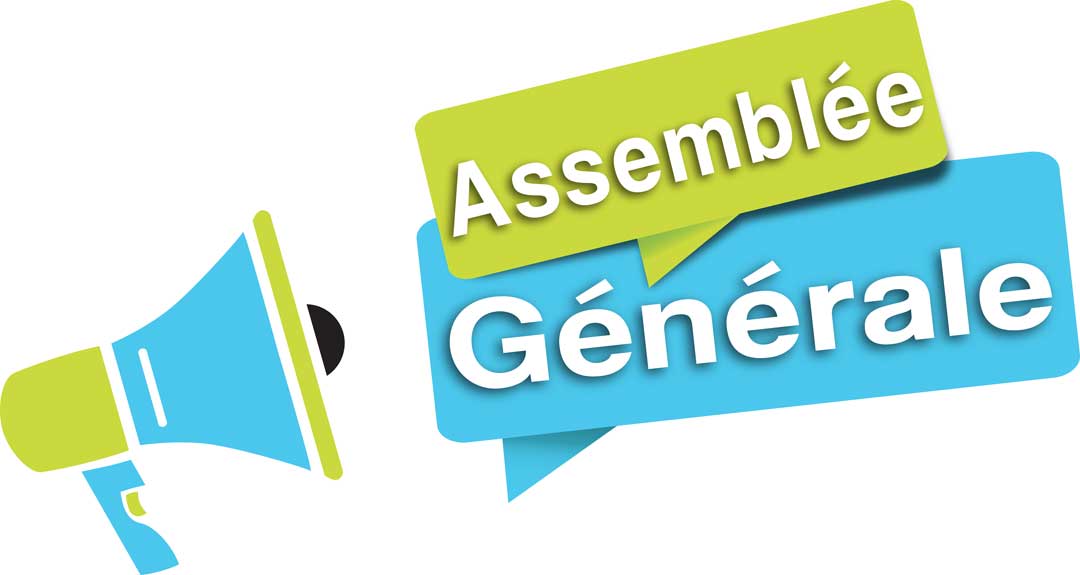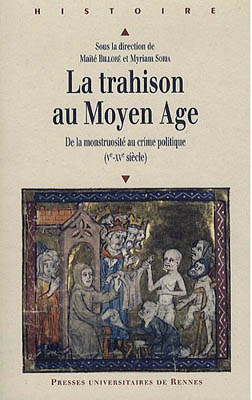
Maïté Billoré et Myriam Soria, dirs, La Trahison au Moyen Âge, de la monstruosité au crime politique (Ve-XVe siècle), Presses universitaires de Rennes, 397 pages, 2010, 22 euros
De Ganelon provoquant la mort de Roland dans la légende à Jean sans Terre décrit par Walter Scott dans Ivanhoé, le traître est un personnage étroitement associé au Moyen Âge et les alliances ne semblent passées que pour être trahies. Mais peut-on aller plus loin et cerner cette notion de trahison de manière plus fine, en analysant ses évolutions au cours de la période ? Tel est le pari de cet ouvrage collectif, issu d’un colloque sur le sujet. Si le genre implique souvent une grande hétérogénéité, cet écueil est ici assez bien évité, d’autant que le thème se prête au récit.
L’ombre de l’Antiquité et le crime de lèse-majesté
La trahison est étroitement associée à la notion de lèse-majesté, d’origine romaine. La fidélité au roi tient en effet une place particulière dans la pensée médiévale : autant il est possible de retirer sa fidélité à un seigneur, par le processus de diffidatio, autant cette rupture est problématique envers le roi, car on quitte alors la sphère privée pour le domaine public et même religieux, en raison du sacre. Pour comprendre cette notion, il est nécessaire de remonter au droit romain.
À Rome, la trahison recouvrait deux concepts juridiques, la proditio, qui consistait à livrer des terres ou citoyens romains à l’ennemi, et la lèse-majesté, qui, à l’origine ne concernait que les atteintes à la personne des magistrats puis de l’empereur, mais s’étendit durant l’Antiquité tardive aux actions ou intentions lésant l’empereur de manière très indirecte. Le traître, selon une constitution d’Honorius et d’Arcadius de 397, était exécuté, et les biens familiaux étaient confisqués. Plusieurs contributions soulignent que le crimen maiestatis était bel et bien connu durant le Haut Moyen Âge car plusieurs codes de loi rédigés par les barbares reprennent des dispositions romaines, comme le « Bréviaire d’Alaric », rédigé par les Wisigoths en 506, ou la Lex Romana Burgundionum chez les Burgondes, en les transformant et en les adaptant à la société de leur temps.
À partir du XIIe siècle, la redécouverte du droit romain au travers du code de Justinien conduit à une reprise de ce concept romain de lèse-majesté dans son acception originelle et à un approfondissement : l’autorité royale est de mieux en mieux définie, l’État s’affirme dans ses institutions et ses pratiques symboliques. S’en prendre à elles est alors perçu comme une trahison. C’est dans l’espace dominé par les Plantagenêts que la réflexion est la plus poussée : elle aboutit en 1352 à la compilation d’un Statute of Treason prévoyant les sanctions pour les différents cas de haute-trahison, le tout sous une forte influence antique.
Trahison – subversion
La trahison ne concerne cependant pas uniquement le roi, bien au contraire : elle concerne également des aspects quotidiens, trahison matrimoniale, ou trahison des serments par lequel on s’engageait à rembourser des dettes. D’où aussi la difficulté que peuvent avoir les auteurs à caractériser ces actions : les termes utilisés sont en effet très divers.
La trahison est perçue comme scandaleuse parce qu’elle remet en cause l’ordre du monde et sa hiérarchie naturelle. En conséquence, le traître est dépeint sous les couleurs les plus noires possibles, pour exorciser ce danger, et des rituels infamants viennent souligner l’énormité de son crime et lui ôter ainsi sa réputation (fama), comme la subversio armorum, c’est à dire l’exposition des armoiries du traître, inversées, pour rappeler qu’il a renversé l’ordre du monde.
Une contribution de Martin Aurell et Catalina Girbea en fournit un exemple des plus éloquents, par l’analyse de la figure arthurienne de Mordred. Ce dernier est accusé d’avoir enlevé la femme d’Arthur, Guenièvre, et d’avoir ainsi déclenché une guerre contre son seigneur légitime. Cette trahison est avec le temps rendue encore plus grave dans les textes successifs, puisque Mordred devient le neveu maternel d’Arthur ; or le neveu au Moyen Âge doit fidélité à son oncle qui l’élève souvent. Arthur, absent, lui aurait confié la garde de sa femme et de son royaume, d’après le très imaginatif Geoffrey de Monmonth († 1155). Du reste, Geoffrey est le premier à donner le nom de Mordred à ce personnage, puisque dans la tradition telle qu’on peut la reconstituer à partir d’autres textes, Mordred était au contraire un guerrier loyal à Arthur. Au début du XIIIe siècle, un nouvel échelon est franchi, puisque Mordred est présenté dans les romans arthuriens français comme le fils qu’aurait eu Arthur de sa sœur Anne.
Salir l’adversaire
Ce faisant, Mordred devient un nouveau Judas Iscariote, dont la Légende Dorée raconte qu’il tue son père et épouse sa mère puis, ayant découvert son crime, rejoint le Christ. Les auteurs soulignent que « cette diabolisation progressive de Mordred (…) pourrait être le résultat de la diabolisation de l’acte de trahison dans l’imaginaire » (p. 145). Elle est aussi le reflet de la situation politique puisque les incestes et parricides sont une caractéristique (réelle ou imaginaire) des Plantagenêt, que les auteurs français stigmatisent ainsi à travers cette figure du traître absolu.
Car la trahison est aussi un prétexte pour salir des adversaires et le cas échéant s’en débarrasser. Pierre de la Broce, favori de Philippe III « le Hardi », est ainsi exécuté le 30 juin 1278 à Montfaucon, pour des motifs qui demeurent plus clairs. Il avait tenté de compromettre la reine Marie de Brabant, deuxième femme de Philippe III, mais il fut peut-être aussi rendu responsable de la défaite des troupes françaises lors d’une expédition en Espagne en 1276 : on l’aurait accusé d’avoir trahi son roi. D’autres contributions viennent montrer à quel point la notion de trahison est relative, comme dans le cas de l’évêque de Reims Egidius (jugé pour trahison en 590 alors qu’il était en réalité resté fidèle à son maître alors que les circonstances changeaient), ou dans celui du cardinal Bessarion, qui en 1439 négocia pour l’Empire byzantin la réunification des Églises au concile de Florence. Le pape, bien plus riche, était en position de force et les Byzantins durent accepter de reconnaître sa supériorité, mais les habitants de Constantinople rejetèrent cet accord et boycottèrent ceux qu’ils considéraient comme des traîtres. Bessarion fut fait cardinal à Rome et, tout en conservant des traditions grecques, comme le port de la barbe, s’intégra à Rome au point qu’il fut un temps considéré comme un possible futur pape.