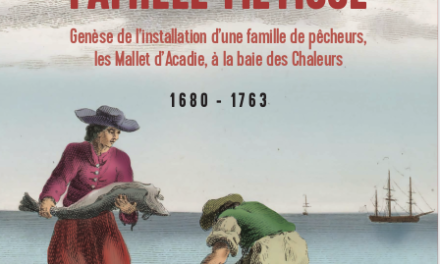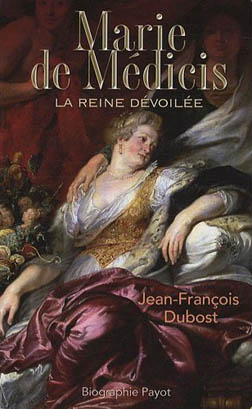
1040 pages, c’était peut être beaucoup pour une biographie ? Au terme de cette lecture, la réponse est non. Pas de longueur, rien d’inutile, un grand élan démonstratif qui parcourt cette synthèse remarquable, une volonté de globaliser tout en resituant le contexte, les réseaux, les familles, les rapports entre Florence, la France et l’Europe moyenne.
Jean-François Dubost, professeur d’histoire moderne à l’Université de Paris 12-Val de Marne est un excellent connaisseur des XVI et XVIIe siècles qu’il a abordés par une étude originale sur la mobilité, l’accueil, l’insertion ou l’assimilation des étrangers et plus précisément des italiens dans la France des Valois et des premiers Bourbons. Cet angle d’approche a atteint le pouvoir de l’Etat lorsque deux expositions ont porté leur regard sur Marie de Médicis tant à Paris qu’à Blois: Marie de Médicis et le palais du Luxembourg en 1991, et Marie de Médicis : Le gouvernement par les arts en 2004. L’A. rappelle alors combien l’historiographie présentait cette reine et régente de façon négative : jalouse, soumise aux excès, massive et plantureuse, médiocre et incapable politiquement, soumise aux jésuites, hispanophile. Une femme qui n’aurait pas dû avoir sa place en politique ! L’analyse méthodique des biographies et des histoires de France précédentes est un modèle de rigueur et précision. Signalons que l’argumentaire de la troisième et belle exposition Un temps de l’exubérance : Les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d’Autriche (2002), parlait également d’un renouveau qui ne commençait qu’après une régence difficile.
Une florentine devenue reine de France
Pour modifier cette réputation, pour dévoiler la reine, il fallait tout reprendre au début. C’est ce qu’entreprend J-F. Dubost en partant dans la Florence de Médicis, dans cette famille de parvenus du XIVe siècle qui se hisse à la tête d’un duché, puis parmi les puissances grâce à des mariages et prestigieuses alliances dans toutes les familles ducales, princières, papales et impériales du XVIe siècle. L’Europe constitue l’impressionnant réseau familial des Médicis. Marie, descendante des Césars par sa mère, est le produit d’un mélange caractéristique de cette aristocratie européenne (duc d’Albe, Jagellon, arrière-arrière petite-fille de Maximilien 1er d’Autriche), associée à la plus grande banque européenne tenue par une famille de robins, à cette différence prêt qu’à Florence, les affaires ne sont pas incompatibles avec la noblesse.
L’auteur montre que la Toscane contrôle parfaitement les enjeux internationaux, que par ces noces françaises, elle entend obtenir un avantage diplomatique pour repousser l’Espagne par ce rapprochement avec la France auquel le grand duc Ferdinand travaille depuis 1587, un avantage économique en faisant bénéficier ses manufactures de Livourne de l’essor des économies atlantiques et du marché français dans un contexte méditerranéen moins porteur. La France entend en tirer des avantages importants, militaires par la consolidation de la frontière (Saluces), diplomatiques pour reprendre pied en Italie face à l’Empereur, religieux car l’orthodoxie sans faille de la reine conduira à un rapprochement avec le pape, économiques et financiers, bien sûr. Elle ne sait pas encore combien les références culturelles qui ne sont encore que des modèles italiens, vont se transformer en culture politique française. Cette mise en perspective européenne ouvre le débat sur les conceptions politiques de ce début XVIe siècle et l’enrichit considérablement face à la position de la France qui sort des guerres de religion.
Contrairement aux reines contemporaines, Marie de Médicis ne s’est mariée qu’à 25 ans. Dans ce duché riche, industriel, médiateur des princes italiens, mécène des plus grands artistes, Marie a donc acquis une connaissance du pouvoir et des hommes. Elle a vécu l’affirmation des dynasties princières à la tête d’un Etat, la culture de l’occasion des princes utilisant les rapports de force, puis la légitimation du prince par la figure du prince mécène, par l’apparat et le cérémonial qui met à distance la figure du prince. Elle sait s’appuyer sur une parentèle princière large et dans le contexte de la Contre-Réforme. Elle a vu le transfert de la sacralité vers le pouvoir politique. Elle a vécu la curialisation des élites aristocratiques et arrive en France avec un bagage culturel et politique important.
Le mariage de Marie avec Henri IV est donc bien la rencontre de deux cultures politiques. La première partie de l’ouvrage renouvelle considérablement l’image de Marie de Médicis en la centrant sur l’histoire européenne.
Le septennat d’une reine
La deuxième partie montre une reine de France pendant quarante-deux ans qui n’a pas toujours été au pouvoir, en insistant sur les étapes et l’affirmation du pouvoir de Marie en France. Femme de roi des années 1600, rapidement reine-mère, reine sacrée car associée au pouvoir avant l’assassinat, reine régnante car régente de 1610 à 1617, reine-mère qui tente de reprendre le pouvoir puis reine exclue du pouvoir (vers 1630) puis du royaume (1631-1642). La constante est l’utilisation de la politique de mécénat et de prestige, associée avec l’usage des images et des réseaux d’influence qu’elle a su constituer. Là encore, cette analyse est originale. Retenons quelques idées de cette très riche démonstration : après les premières déconvenues du mariage, Marie (comme plus tard Marie-Antoinette) doit modifier son positionnement et ses habitudes toscanes immédiatement considérées comme des maladresses dont l’historiographie xénophobe et misogyne du XIXe siècle ne voudra se départir. Pourtant Marie travaille à la fabrication d’une image de reine grâce au mécénat et aux soutiens qu’elle recherche au-delà de la cour, dans la noblesse seconde et dans de nombreuses provinces françaises malgré un train financier difficile à tenir. L’analyse de l’usage des vêtements à partir des représentations royales qui parcourt le livre est très éclairante : il s’agit d’afficher d’abord la francisation des usages vestimentaires, puis ses prétentions politiques à travers l’usage du manteau royal fleurdelisé pour en arriver à une dimension iconique de la reine et de la reine mère.
A partir du moment où elle est devenu mère du dauphin, elle reçoit l’assentiment de Henri IV qui de son vivant, l’associe au pouvoir, la fait participer à deux séances de Conseil par semaine à partir de 1604, ce qui souligne la complémentarité admise entre le roi et la reine. Sur ce point, l’analyse qui aboutit au sacre de la reine le 13 mai 1610 ouvre des perspectives politiques inédites en France, mais aussitôt annihilées par l’assassinat du roi. Les propos de l’A. sont illustrés par des réflexions constructives sur la régence d’absence et la régence de minorité (p 275).
Dès lors la régente bénéficie d’une faible marge de manœuvre comme femme, étrangère face à une possible reprise de la guerre civile, religieuse, entre Grands et protestants. Et cette régente imprévue, est une réelle période de prospérité. Les apports de l’A. sont considérables en ce qui concerne les interprétations de la politique de cette période : Marie maintient la paix intérieure, ambition d’Henri IV. Elle et son gouvernement sont intraitables face aux intérêts pontificaux, face aux Jésuites. Elle maintient les intérêts des protestants pour qui « la régence est un âge d’or ». Elle n’a pas entraîné la chute de Sully, plutôt victime de ses rivaux politiques. La régence voit l’aboutissement de réformes administratives importantes qui contribuent à la progression de l’autorité royale en province, la bonne santé de l’économie. Et surtout elle a mené une diplomatie de la paix qui ne sera remise en cause qu’à partir du moment où Louis XIII opte pour un repli en politique étrangère et un harcèlement des protestants.
Les fêtes des mariages espagnols, les aménagements des palais portent la touche de Marie dans le style décoratif, dans l’aménagement intérieur qui montrent bien que les temps de l’exubérance doivent beaucoup à Marie de Médicis. L’époque de la régence s’affirmerait alors comme celle des libertés baroques, d’une relative tolérance à l’égard des mœurs, des penseurs protestants libertins et même sceptiques, des productions littéraires qui aurait peut être même infléchi les certitudes intellectuelles de la reine entre 1610 et 1614.
Le 2 octobre 1614, Marie peut s’appuyer sur son œuvre pour transmettre le territoire, le pouvoir et l’héritage lors du lit de justice au roi majeur. Mais Monsieur le Prince entre en jeu et attaque le consensus politique en prétextant l’ambition du favori étranger Concini, de façon à masquer celle des Grands face aux fondements encore frais de la monarchie absolue. L’A. prend le contre-pied de la vulgate en ce qui concerne l’influence des Concini montrant que cette image est une construction des Grands puisqu’elle devient le mot d’ordre de leur opposition, mais aussi une construction survalorisée de l’historiographie nationaliste qui ne doit rien à la réalité du fonctionnement du pouvoir. La fronde des aristocrates soutenant Condé entraîne la reine dans le premier conflit civil dont elle est responsable et dans une politique résolue d’affirmation de l’autorité royale, deux points qui constituent un tournant dans sa politique. La très catholique Marie doit également faire face aux catholiques politiques, afin de protéger la monarchie nouvelle des Bourbons qui cherche certes à renforcer sa légitimité sur le plan religieux, tout en construisant le pouvoir gallican face à la réception du concile de Trente et le retour des jésuites. L’enjeu est l’éducation du roi et les choix de ses précepteurs. La bataille de l’opinion commence tandis que la volonté du jeune roi s’affirme.
Comment reprendre le pouvoir ?
En 1617, la situation change, la reine mère exclue du pouvoir est prête à se mettre à la tête de la révolte des Grands en activant dès 1619 des réseaux nouveaux à la suite des « épurations », en récusant l’image dans laquelle la propagande de son fils veut l’enfermer, en imposant sa présence à la cour, pour retrouver l’accès au roi tout en prenant la tête d’un coalition contre Luynes. Elle utilise pour cela Richelieu qui apparaît alors en 1624 comme le ministre de Marie plus que celui du roi. Louis XIII finalement réconcilié avec la reine, lui permet de retrouver une grande partie de son pouvoir de conseil et de son influence diplomatique au moment des mariages (Chrétienne de France, Anne d’Autriche).
L’A. montre l’évolution spirituelle et morale de la reine, le détachement et l’évolution personnelle du roi face au pouvoir, le déroulement du temps accroissant les divergences de vues qui mènent à la rupture de novembre 1630 qu’il analyse en termes sociaux, culturels et non politiques. Ce serait la victoire du « serviteur » sur la reine, la revanche du clan Bourbon-Condé contre les Guises.
Entre la marginalisation politique, l’exil et la mort, la reine justifie ses actions au nom de l’unité politique, d’un mode de gouvernement familial, d’un ordre divin reposant sur le mariage selon une tradition politique impériale. En cela, elle est soutenue par Gaston qui calcule son intérêt d’héritier du trône et joue sur les factions aristocratiques. Pourtant, elle va perdre le contrôle de l’imagerie politique, ses réseaux sont démantelés, ses serviteurs écartés devenant même des criminels de lèse-majesté, des exilés de l’intérieur, son départ à Moulins est négocié contre le maintien de ses pensions. L’épuration permet la redistribution des charges administratives, épiscopales, provinciales et encourage les incertains à rejoindre Richelieu désormais source d’emplois et de ressources. En 1632, alors que s’imposent les théories absolutistes de la souveraineté, il importe de convaincre l’opinion de la justesse de la conduite du roi et de son principal ministre face à la reine-mère désormais en fuite aux Pays Bas. La politique de l’information va contribuer à en faire une mauvaise reine et un mauvais sujet ne se soumettant pas à la volonté de son roi. C’est du cabinet de la plume de Richelieu que naît le discrédit du pouvoir féminin, c’est du cardinal désormais devenu le serviteur de l’Etat que part l’idée de contrôler l’intervention politique des reines.
Exilée, Marie entend alors utiliser sa parenté pour constituer une force d’opposition européenne. Cette dizaine d’années qui lui restent à vivre est souvent peu étudiée. Elle est d’abord reçue en triomphe aux Pays Bas espagnols, par le principal ennemi de son fils aîné et néanmoins le père de la reine actuelle, Anne d’Autriche. Elle entend susciter une prise d’arme nobiliaire, réinvestissant le mythe des condottiere de sa jeunesse. Montmorency s’y prête jusqu’à l’échec. L’Espagne finance un second projet de soulèvement mais Marie doit progressivement se rendre à l’évidence : elle a perdu sa puissance sur l’échiquier européen tandis qu’elle entend continuer à affirmer son image de reine malgré ses difficultés financières. L’auteur analyse ensuite le quotidien d’une reine surveillée jusque dans sa Maison, infiltrée d’agents de Richelieu qui la rendent suspecte et bientôt indésirable aux dirigeants même qui l’accueillent. La stratégie de Richelieu va jusqu’à un chantage financier obligeant la reine à se rendre dans son pays natal au prix du rétablissement de ses pensions. C’est par une démarche que la propagande affiche comme volontaire, qu’elle s’apprête à rentrer vers son pays natal, proclamant ainsi sa « traîtrise » à la France. Ce faisant, Richelieu modifie son statut juridique en lui faisant perdre sa nationalité par l’exclusion politique du sol français. Mais elle attend l’arme au poing à Cologne, le succès de la conjuration de Cinq mars. Elle ne se relèvera pas de la course contre la mort qu’elle engage avec Louis XIII et Richelieu puisqu’elle meurt début juillet 1642 (p 853).
Ce qui est passionnant dans ce livre, c’est le dépoussiérage des figures politiques, l’ébranlement des statues de commandeur comme celles d’Henri IV, Concini, Richelieu… qu’avaient dressées plusieurs siècles d’historiens. En adoptant le point de vue de la reine, il fait apparaître sa pratique politique qui ne conduisait par forcément à l’absolutisme comme destin de la France, les choix et les mutations successives de celle qui tenait le pouvoir.
Il donne une cohérence à la personnalité de la reine, de ce fait, il enrichit l’époque et fait reculer vers le début du XVIIe siècle la mise en place d’un pouvoir royal absolu mais pas encore abouti. Il affirme la quête permanente de la légitimité, point commun de la reine Médicis et de son époux Bourbon. En dernier lieu, il propose comme explication aux contradictions non surmontées de Marie de Médicis, l’imprégnation de sa culture de la Renaissance, dominée par le raisonnement analogique qui empêche la reine de trouver des solutions pragmatiques aux conflits qu’elle rencontre.
Cet ouvrage de lecture aisée, d’une belle écriture est très utile pour les étudiants en histoire moderne auxquels il donnera également des analyses rigoureuses et érudites sur le système politique, administratif royal ou provincial, sur les réformes économiques, comme des repères précis sur la situation politique, diplomatique ou religieuse puisqu’il fait la synthèse de nombreuses études sur ces sujets. Il analyse brillamment de nombreuses œuvres d’art, ouvrages littéraires ou libelles au regard de l’histoire culturelle. Ce livre intègre avec force les travaux sur les genres, sur les reines, sur les femmes dans la vie politique remettant en cause l’emprise masculine sur la société et la politique. Il fait l’apologie d’une souveraineté féminine que Marie de Médicis a voulu rendre possible et que l’auteur rend visible dans l’analyse du palais du Luxembourg et de la galerie des Rubens. Ce livre bouscule la thèse de la reine étrangère, ce « cadre interprétatif postule l’excellence des valeurs nationales opposées aux apports étrangers jugés néfastes, dualisme manichéen qui plonge ses racines loin dans le temps » (p 306). En ce sens, il est donc inclus dans une lecture contemporaine des interrogations de notre société. Un gros livre qui est un très grand livre.