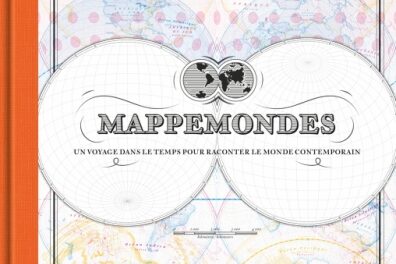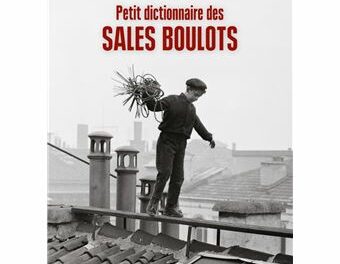Dominique Lelièvre : un érudit tourangeau spécialiste de la Chine
Né en 1947, Ingénieur ESE (Supélec) et diplômé d’une licence de sociologie à l’université de Tours dans les années 1980, Dominique Lelièvre (71 ans), retraité EDF depuis une dizaine d’années, est passionné depuis longtemps par les civilisations orientales, en particulier, par la Chine. Il a notamment publié un ouvrage réputé sous le titre Le dragon de lumière. Les grandes expéditions des Ming au début du XVe siècle. (France-Empire, 1996) et un autre sur les Voyageurs chinois à la découverte du monde. De l’Antiquité au XIXe siècle. (Éditions Olizane, Genève, 2004), en sus d’un document sur La grande époque de Wudi. Une Chine en évolution IIe – Ie av. J-C. (Éditions You-Feng, Paris, 2001), le seul ouvrage documenté sur le sujet.
De plus, il a également publié (à titre d’auteur) Mer et Révolution. Le Portugal pionnier fin XIVe – début XVe siècle. (DL Éditions, 1998) et aux éditions Carnot L’empire américain en échec. Sous l’éclairage de la Chine impériale. (Éditions Carnot, 2004). Ainsi donc, avec La transmission du savoir profane d’Alexandrie à la Chine jusqu’au XIXe siècle, Dominique Lelièvre revient non seulement à la publication, après 14 ans d’absence, mais aussi à son domaine de prédilection qu’est la Chine au miroir de l’Occident.
Comme l’indique Dominique Lelièvre, « cet ouvrage n’est guère un essai à proprement parler, (…), mais plutôt une synthèse. Par son étendue historique et son éventail géographique, il offre un panorama inédit ». De plus, il ne s’agit que de savoir profane et écrit. Il est donc exclu de l’ouvrage la transmission des savoirs artistiques, techniques, religieux et idéologiques, quand on peut les distinguer des savoirs profanes. La transmission orale tout comme celle des images ne sont pas traitées, également. Quant à la transmission des techniques, elle a déjà fait l’objet de nombreuses publications.
Composé de cinq parties et de treize chapitres, le livre déroule les principaux moments de la transmission du savoir profane, de l’antiquité au XIXe siècle. En outre, ce livre comporte des remerciements et citation (p. 5), des transcriptions et conventions (p. 6), une introduction (pp. 7-9), une première partie (pp. 11-56), une deuxième partie (pp. 57-98), une troisième partie (pp. 99-146), une quatrième partie (pp. 147-194) et, enfin, une cinquième et ultime partie (pp. 195-260), une conclusion générale (pp. 261-264) ainsi que tous les attributs de l’ouvrage scientifique : repères chronologiques (pp. 265-266), bibliographie (pp. 267-272), puis, enfin, une table des matières (p. 273).
Transmission dans l’Antiquité et traductions en arabe
La première partie s’intitulant « Transmission dans 1’Antiquité et traductions en arabe » (pp. 11-56), de 45 pages, comporte trois chapitres ayant respectivement 13, 17 et 11 pages : chapitre I (Un savoir antique partagé : Antiquité, Rome, Alexandrie, Syriaques : pp. 13-26), chapitre II (Le début des traductions en arabe : pp. 27-44), chapitre III (Suite et fin des traductions en arabe : pp. 45-56).
Dans le chapitre I (pp. 13-26), Dominique Lelièvre fait un rappel succinct sur la transmission antique du savoir de l’Orient et donne également un bref aperçu du savoir « grec » transmis par les Romains au Haut Moyen Age occidental (VIe – Xe siècle) sans oublier de souligner le rôle crucial d’Alexandrie comme celui des Syriaques. Le chapitre II (pp. 27-44) ainsi que le chapitre III (pp. 45-56) sont consacrés au grand mouvement des traductions en arabe commencé sous les Abbassides, dès la moitié du VIIIe siècle.
Traductions latines aux XIe, XIIe et XIIIe siècles
La deuxième partie appelée « Traductions latines aux XIe, XIIe et XIIIe siècles » (pp. 57-98), de 41 pages, est composée de deux chapitres seulement comportant respectivement 11 et 25 pages : chapitre IV (Les premières traductions en Espagne et en Sicile : pp. 61-72) ; chapitre V (Traductions sous Alphonse X et traductions gréco-latines : pp. 73-98).
Dans les chapitres IV (pp. 61-72) et V (pp. 73-98), outre l’Espagne arabo-musulmane, Dominique Lelièvre rappelle que, au centre occidental de la Méditerranée, la Sicile (convoitée successivement par les Carthaginois, Grecs, Romains, Vandales, Ostrogoths et Byzantins) est un lieu historique d’échanges culturels qui explique le syncrétisme où culture arabe et latine se mêlent. Ces zones de contact seront, avec l’Italie, les véritables centres de transmission des savoirs « grec » et « arabe » vers le monde latin. L’Espagne et la Catalogne ont été le centre de la traduction de l’arabe en latin mais aussi en castillan et en catalan, ainsi qu’en hébreu, dans le Midi. L’Italie, pionnière de la transmission du grec en latin, y voit aussi, dans le Sud, des traductions à partir de l’arabe. Cependant, en Espagne, le XIIe siècle, avec ses traducteurs étrangers, se différencie de la seconde moitié du XIIIe siècle, où les traductions sont placées sous la tutelle active du roi Alphonse X, dit « le Sage ».
Transmission « jésuite » en Chine (XVIIe et XVIIIe siècles)
La troisième partie intitulée « Transmission « jésuite » en Chine (XVIIe et XVIIIe siècles) » (pp. 99-146), de 47 pages, comporte à nouveau deux chapitres ayant respectivement 19 et 23 pages : chapitre VI (Début de la transmission par les jésuites en Chine : pp. 103-122), chapitre VII (Transmission par les jésuites en Chine, suite et fin : pp. 123-146).
Dans le chapitre VI (pp. 103-122) et VII (pp. 123-146), Dominique Lelièvre se consacre à la transmission réalisée par les jésuites en Chine aux XVIIe et XVIIIe siècles ; ces derniers jugèrent avantageux pour leur mission d’évangélisation de dévoiler les savoirs profanes « européens » aux Chinois dans le but de les convertir plus sûrement, leur savoir profane servant de support à leur prosélytisme. Avant cela, il y eu l’étonnante aventure de moines chinois, comme Xuanzang (602-664), à travers l’Asie centrale dans leur pèlerinage aux sources du bouddhisme, à travers les hautes montagnes d’Asie, les déserts, les régions infestées de brigands, aventure qui déboucha sur des traductions essentiellement religieuses, mais aussi profanes. L’Inde et l’Asie centrale marquèrent alors la Chine de leur empreinte spécifique et y diffusèrent, en plus, une partie du savoir « arabe », lui-même marqué par les savoirs antiques.
Transmission au Japon au XIXe siècle
La quatrième partie intitulée « Transmission au Japon au XIXe siècle » (pp. 147-194), de 47 pages, comporte trois chapitres ayant respectivement 17, 13, et 13 pages : chapitre VIII (Première phase : la période rangaku : pp. 149-166), chapitre IX (La transmission sous l’ère Meiji : pp. 167-180), chapitre X (La transmission au Japon, suite et fin : pp. 181-194).
Dans les chapitres VIII (pp. 149-166), IX (pp. 167-180) et X (pp. 181-194), Dominique Lelièvre montre la dernière grande vague de transmission intellectuelle avant l’ère électronique (Internet) qui se situe en Extrême-Orient, notamment en Chine et au Japon, durant le XIXe siècle, époque où ces deux pays vont devoir réagir aux harcèlements menaçants des Occidentaux. Le Japon, qui ne partage avec la Chine qu’une part de sa culture, après l’avoir naturalisée – confucianisme, bouddhisme et écriture partiellement – est le premier à relever le défi. Plus facile à mobiliser, le Japon comprendra, durant l’ère Meiji (1868-1912), toute l’importance cruciale qu’il y a à ne pas négliger les apports intellectuels et organisationnels de l’Occident, en sus des aspects technologiques. C’est pour partie l’intérêt de cette transmission au Japon, exceptionnelle par son ampleur et ses incidences, transmission qui s’opéra en deux étapes : une première via le néerlandais jusqu’aux environs de 1860-62, puis une seconde, plus intense, générale et efficace, via les langues européennes, l’anglais principalement, au terme de laquelle l’archipel nippon se trouva profondément changé et propulsé, selon ses vœux, parmi l’élite des nations.
Transmission en Chine au XIXe siècle
La cinquième partie intitulée « Transmission en Chine au XIXe siècle » (pp. 195-260), de 65 pages, comporte à nouveau trois chapitres ayant respectivement 13, 25 et 23 pages : chapitre XI (La transmission jusqu’en 1860-1865 : pp. 197-210), chapitre XII (La transmission de 1865 à 1885 : pp. 211-236), chapitre XIII (Dernière phase de la transmission en Chine : 1895 à 1911 : pp. 237-260),
Dans les chapitres XI (pp. 197-210), XII (pp. 211-236) et XIII (pp. 237-260), Dominique Lelièvre montre comment la période « jésuite » (XVIIe – XVIIIe siècle), parenthèse bénéfique pour l’empire des Qing alors au faîte de sa puissance, n’a nullement perturbé l’évolution de la Chine. Au XIXe siècle, la menace ne viendrait pas des hauts plateaux d’Asie mais de la mer, sans que « l’Empire du Milieu » chinois ne s’y prépare. Pourtant, débarquements côtiers intempestifs, contrebande d’opium, actes de pirateries, ne cessent de se multiplier, ainsi qu’ambassades insistantes. Le regard des Occidentaux s’est en profondément modifié. Marchands, diplomates et militaires donnent le ton, désormais.
Bureaucratique, terrienne, politiquement centrée au Nord, engluée dans une idéologie multimillénaire, en proie à de profonds désordres, la Chine sera bien plus lente à réagir que le Japon qui endure, comme elle, la pression des Occidentaux. Les étapes de la transmission en Chine, au XIXe siècle, seront plutôt corrélées aux incidents diplomatico-militaires : la première Guerre de l’opium (1840), la seconde en 1860, la défaite face au Japon (1895). Avec la réforme avortée des « Cent Jours » (1898) et la révolte des Boxers (1900), la crise s’accélère encore. Malgré de tardives tentatives de réforme, l’empire est alors comme un géant groggy qui encaisse les coups, jusqu’à sa chute en 1911.
Contrairement à la transmission « jésuite », celle du XIXe siècle s’opère sous la menace des canons et la pression des marchands. Auparavant, les missionnaires ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, avec, comme seule base de repli, la portugaise Macao. Au XIXe siècle, Portugal et Espagne ont cédé la place et les Néerlandais, grands pourfendeurs de Portugais, peinent à suivre. La révolution industrielle est passée par là, accompagnant l’impérialisme, multipliant les moyens des Grandes Puissances et leurs atouts : ouverture du canal de Suez en 1869, développement technique et scientifique, etc. La construction navale va fortement progresser après 1860 : coques en acier, vapeur, hélice. Sur les plans militaire et logistique, l’Europe prend en quelques décennies les commandes.
La transmission du savoir profane d’Alexandrie à la Chine jusqu’au XIXe siècle : ouvrage de référence ?
Finalement, dans sa conclusion générale (pp. 261-264), Dominique Lelièvre résume ainsi la présentation de quelques-unes des principales phases de Transmission du savoir profane en les insérant dans leur contexte, qui montre comment le savoir profane – scientifique et philosophique essentiellement – issu de Méditerranée et d’Orient, transite par Alexandrie, évite Rome, repris qu’il est par les Syriaques, les Arabo-Persans, les Latins, puis, après s’être étoffé à la Renaissance, se greffe sur le riche savoir d’Extrême-Orient (Japon et Chine) ayant, lui, emprunté une autre voie. Les mouvements de transmission choisis se sont tous avérés cruciaux pour l’humanité. Bien des péripéties ont accompagné la transmission du savoir profane au cours de tant de siècles.
Pour conclure de manière provisoire, en ce moment de mondialisation tout azimut, nous ne pouvons que recommander la lecture de cette synthèse inédite écrite pour le grand public profane (érudits) et celui de l’université (étudiants et enseignants-chercheurs), notamment pour l’originalité de sa problématique pertinente, son étendue historique, son éventail géographique et les éclairages qu’elle apporte. Toutefois, quelques remarques mineures : il est dommage que l’éditeur n’ait pas suivi l’auteur qui avait prévu un lexique et, surtout, des cartes qui auraient permis aux lecteurs de visualiser les différents théâtres de transmission des savoirs profanes ; de plus, l’auteur aurait gagné en clarté en donnant, dans la page des conventions, la signification des signes suivants (d., r., c. pour « circum » latin ? voulant dire autour, etc…).